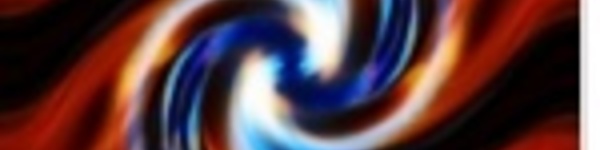Sophie Mendelsohn – Vous vous intéressez depuis plusieurs années aux conséquences de la médicalisation de l’existence pour le sujet contemporain – Roland Gori et Marie-José Del Volgo, La santé totalitaire, essai sur la médicalisation de l'existence, Paris, Denoël, 2005. Un des avatars de cette médicalisation de l’existence, c’est l’invasion actuelle des champs psychiatriques, psychologiques et psychothérapeutiques par le concept de « santé mentale ». On sait depuis Freud que céder sur les mots, c’est aussi céder sur les choses : quels sont selon vous les enjeux de ce glissement, qui n’est donc pas que sémantique, de la psychopathologie clinique vers la santé mentale ?
Roland Gori – Le concept de santé mentale est quelque chose que je déteste, qui est venu se substituer à la psychiatrie ou à la psychopathologie, et témoigne de l’état culturel dans lequel nous sommes pour traiter l’angoisse, la folie, le conflit. C’est-à-dire, pour reprendre ce que M. Foucault disait en 1954 dans « Maladie mentale et psychologie », avant même l'Histoire de la folie à l'âge classique qui date de 1961 : la psychopathologie est un « fait de civilisation ». C’est un point très important : cela vient attester de cette « niche écologique », pour citer I. Hacking, que sont les diagnostics psychiatriques – Hacking en parle à propos de certains troubles psychiques transitoires, comme les personnalités multiples, ou les fugues dites pathologiques. Cette niche écologique montre qu’il y a ce que j’appelle une réalité transactionnelle incessante dans la manière dont les experts permettent aux patients à un moment donné d’exprimer leurs souffrances psychiques en fonction de la culture dans laquelle ils sont tous deux immergés. Il y a des formes culturelles de la pathologie, qui se déduisent d’une négociation incessante entre les enveloppes formelles de la culture, l’histoire de la souffrance psychique d’un sujet et la manière dont on apprend à des experts à poser des diagnostics. Ce que j’appelle « le nouveau sujet de la santé mentale », n’est plus de même nature ontologique et épistémologique que le sujet de la folie ou de la psychiatrie.
Sophie Mendelsohn – Quelles sont les coordonnées de ce « nouveau sujet de la santé mentale » ?
Roland Gori – Il s’agit d’un sujet conçu comme un individu entrepreneur de lui-même, qui possède un capital bio-psycho-social qu’il doit rentabiliser comme une entreprise, au mieux de ses idéaux de performance. L’individu est conçu comme une micro-entreprise libérale, autogérée et ouverte à la concurrence et à la compétition, qui peut produire ce qu’elle veut pour sa propre satisfaction à condition de respecter un certain nombre de règles du marché qui sont sans cesse réajustées. Pour prendre un exemple, on voit bien comment l’identification sexuée, que d’aucuns appellent le genre, a une plus grande marge de tolérance sur le marché des valeurs sociales, dans la postmodernité, que ce ne fut le cas dans les années cinquante ou soixante. On voit bien comment certaines formes d’addiction peuvent être tolérées, par exemple, une addiction à la consommation, aux jeux vidéo, au travail, aux médias, alors que c’est de moins en moins le cas pour le tabac et l’alcool, ou pour des drogues douces ou dures. Ce nouveau sujet de la santé mentale, c’est vraiment le sujet produit par le néo-capitalisme ou le capitalisme financier.
Le sujet de la folie, c’est-à-dire le sujet dans un certain état de la culture, était un sujet divisé. Qu’il s’agisse du fou, pour qui la raison est amenée à se débattre avec la déraison ; que ce soit l’angoisse qui favorise le surgissement de quelque chose qui fait délirer, au sens étymologique, dérailler la raison, ou encore que ce soit la névrose où le sujet conflictualisé doit débattre avec lui-même, négocier avec lui-même en fonction de ses impératifs moraux et de ses prétentions à la jouissance, ce sujet était essentiellement sujet à sa propre division. Avec le sujet de la santé mentale, il s’agit d’autre chose : c’est un sujet propriétaire, qui va négocier son accès à des réseaux de jouissance de plus en plus dématérialisés, virtualisés. C’est ce que Ruskin appelle « l’âge des réseaux ». On va évaluer les troubles des comportements en fonction de deux choses : l’insatisfaction de l’individu face à cette jouissance dématérialisée, volatilisée pour reprendre le vieux terme marxiste, et la synergie possible de cette jouissance avec des troubles définissant une population à risque. Ce nouveau sujet est l’opérateur épistémologique et éthique qui circonscrit le champ d’intervention des contrôleurs de gestion de l’intime à partir de sa plainte à lui d’être déprimé, impuissant, en panne, ou en situation de précarité psychique et social. Une désinsertion individuelle, par exemple, potentialise les risques qui sont des risques par rapport à l’ordre économique et social. Ce n’est donc pas du tout étonnant que la santé mentale regarde conjointement dans deux directions : la biologie, qui vise à une naturalisation des troubles et des inégalités sociales, et à des pratiques de pharmacovigilance des comportements individuels et populationnels ; le social, qui vise le revenu compassionnel minimal social et psychique garanti. Je citerai là A. Badiou : le modèle anthropologique de l’humain, c’est un animal pitoyable. Et le nouveau sujet de la santé mentale est un animal pitoyable.
Pourquoi la phénoménologie a-t-elle quasiment disparue ? Pourquoi la nécessité de comprendre le sens du sujet en fonction de l’histoire qui est la sienne et qui est celle de sa culture et de son milieu est-elle déconsidérée ? Nous avons changé de style anthropologique : le style anthropologique d’une culture, c’est justement la manière dont elle traite le dénuement, la folie, le malade, l’enfant, le vieillard. Le style anthropologique actuel promeut le comportement en tant que coefficient de rentabilité individuelle et sociale. L’individu est réduit à la somme de ses comportements, ce qu’E. Roudinesco appelle « l’homme comportemental ». Il est évident qu’on n’a plus besoin d’un homme tragique, d’un homme divisé, d’un homme conflictualisé, étiré entre ses idéaux surmoïques et ses pulsions sexuelles. La rentabilité comportementale suffit.
Il fallait donc changer nos concepts et nos modèles psychiatriques pour stabiliser ce nouveau style… Le DSM III est arrivé à point nommé pour prendre en compte ces changements. Le DSM III est négocié entre 1970 et 1980 aux Etats-Unis par R. Spitzer et sa bande, qui prend le contrôle de l’APA. La question n’est pas tant celle des « dommages collatéraux » du DSM III que la raison pour laquelle il peut émerger à un moment donné dans notre culture. Comme tout un chacun, je me suis longtemps centré sur ces dommages du DSM III dans le champ de la « santé mentale ». Mais il me semble aujourd’hui que la question est de savoir comment la culture a pu promouvoir socialement et idéologiquement des opérateurs « mous », très conformistes et hyperformalistes, pris dans une logique de profit. Pour moi, le nouveau sujet de la santé mentale est celui des thérapies molles qui viennent assurer la surveillance, la maintenance sociale du quadrillage des populations, leur normalisation. Pour cela, le DSM fournit une classification « flexible ».
Le nouveau sujet de la santé mentale, c’est le sujet des troubles du comportement. Ceux-ci se sont multipliés par 3 ou 4 en vingt ans. Si on rajoute des tiroirs, c’est parce que l’armoire est mal foutue ! Le DSM ne tient pas. Mais en créant de nouveaux troubles du comportement, on crée un marché de plus en plus porteur pour la consommation de psychotropes et de pratiques thérapeutiques. Le DSM III enterre la psychiatrie : il est véritablement « psychiatricide » – bien plus que M. Foucault, qu’Henri Ey avait qualifié ainsi… Ce DSM se veut à la fois pragmatique, efficace, formel, et juridiquement irréprochable. Il se veut athéorique. Dix ans plus tard, le DSM IV a l’arrogance que le III ne pouvait pas avoir, en évacuant la névrose et en rétablissant l’implicite d’une étiologie organique des troubles du comportement. On a démantelé le continent de la névrose. C’était nécessaire pour passer du sujet tragique de la psychiatrie du XIXème et du XXème siècle, au sujet de la santé mentale, il fallait aller vers quelque chose comme l’expertise des comportements, que l’on va suivre à la trace, de manière à la fois de plus en plus précoce, et de plus en plus féroce. On en vient aux expertises de l’Inserm dans le champ de la santé mentale. Ça ne vaut pas grand-chose, mais ça vient donner une légitimité, une rhétorique de propagande aux opérateurs sociaux de validation de cette santé mentale, qui n’est plus que l’ombre de la grande psychiatrie. Cela transforme un rapport de forces en rapport de légitimité… Cela assure une performativité sociale et épistémologique.
Sophie Mendelsohn – Quel est l’impact spécifique de ce concept de « santé mentale » sur la psychopathologie clinique ?
Roland Gori – Il est l’acte de décès de la psychopathologie… Que cette psychopathologie clinique soit mise en œuvre par les psychiatres ou les psychologues cliniciens, elle est leur certificat de décès.
On en revient tout simplement à une conception déficitaire du symptôme. Lacan insistait beaucoup en disant que Freud avait opéré une promotion du symptôme. Que voulait-il dire ? Le symptôme est l’enveloppe par laquelle se manifeste une souffrance avant d’être codée par un savoir médical, c’est-à-dire avant d’être transformée en signe apte à constituer une sémiologie médicale. Pour Freud, il n’y a pas de « défectologie » de la psychiatrie. Or, nous y revenons avec la notion de troubles du comportement. Nous sommes dans quelque chose qui est de l’ordre d’un paradigme déficitaire, comme au bon vieux temps… des théories de la dégénérescence. Lisez les deux dernières expertises collectives et l’Inserm : c’est évident.
La psychologie différentielle, rebaptisée « psychologie de la santé », la psychologie du développement, rebaptisée « neurosciences développementales », la psychologie sociale dans une moindre mesure, peuvent tirer profit de la disparition de la grande psychiatrie et de la psychopathologie clinique. Les experts du comportement peuvent participer à des études qui suivent les individus à la trace. De la même manière, ces psychologues peuvent participer à la normalisation des conduites et à l’encadrement pédagogique (et sanitaire) des populations. C’est à l’intérieur du champ de la psychologie que le problème se pose. La création de la santé mentale se révèle comme un produit idéologique qui surgit dans une culture politique donnée, le néolibéralisme américain, système économico-politique qui vient recomposer le champ des pratiques professionnelles du soin psychique.
Sophie Mendelsohn – Comment expliquer que la psychologie ait accompagné, voire participé à cette mutation du style anthropologique de notre culture ?
Roland Gori – La médecine comme la psychologie ne sont pas seulement des rationalités scientifiques ou des pratiques professionnelles. Elles sont aussi des pratiques sociales qui participent au gouvernement des conduites. Or, c’est la culture qui peut rendre compte de la manière dont émergent ces formes de rationalité. On le sait, depuis la deuxième moitié du XVIIIème siècle, il y a une médicalisation de l’existence. La médecine est appelée à ouvrir les états généraux infinis du contrôle social des populations au nom de la raison sanitaire, de l’hygiène publique. Dans cette médicalisation de l’existence, la psychologisation du social constitue seulement une annexe, une résidence secondaire de la biopolitique.
On a évoqué tout à l’heure le DSM. Ce n’est pas un hasard que la santé mentale soit arrivée en 1980, parce que nous sommes à ce moment-là à une époque où les philosophes, les politiques et les experts se consacrent à ce que Badiou appelle la « Restauration ». Nous sommes en effet, en ce début du XXIe siècle, à l’époque de cette deuxième Restauration.
Le milieu des années quatre-vingt marque effectivement un tournant décisif. Jusque là s’est développé dans toute la France un fort courant de cliniciens qui revendiquait une certaine autonomie par rapport aux critères traditionnels de la psychologie dans les formations et dans les recherches, et la demande sociale comme la demande étudiante se portaient vers eux. La question se posait même de savoir si la psychologie clinique ne devait pas se séparer de la psychologie sans se confondre pour autant avec la psychanalyse et ses dispositifs spécifiques de transmission. Il faut considérer le fait qu’il y a une irrigation extrêmement importante par les psychanalystes des champs de la formation professionnelle des psychiatres et des psychologues cliniciens. Il n’y a pas seulement des enseignements de métapsychologie, de psychopathologie, il y a aussi des TD, des groupes de supervision, des stages cliniques qui sont requis et qui assurent à la dimension clinique de la formation en psychologie une importance de plus en plus déterminante, en s’opposant notamment à ce modèle sans cesse revendiqué par la Nomenklatura de la psychologie, c’est-à-dire une formation généraliste avec tronc commun et zapping des concepts, des méthodes et des pratiques.
L’ouvrage d’un Belge, W. Huber, paru en 1987, permet de se rendre compte à quel point cette situation constitue une exception française : la psychologie clinique en France commence à se distinguer radicalement des psychologies cliniques en Europe, qui se sont « scientifisées », médicalisées, « TCCisées ». C’est alors que commence cette seconde « Restauration ». Le psychologue doit se faire l’instrument, comme disait Canguilhem, d’un pouvoir qui traite l’homme en instrument. On s’éloigne du Panthéon et on descend vers la Préfecture…
Il suffit ensuite de choisir quelques personnes et de les placer dans les instances décisionnaires du Ministère de l’Enseignement Supérieur pour essayer de normaliser le modèle français en l’alignant sur le modèle anglo-saxon. Ils imposent des critères d’évaluation de plus en plus conformistes, qui impliquent une certaine conception de la recherche qui est la même que celle du marché : « Il n’y a que le chiffre qui compte ». L’opérateur conceptuel de cette pensée politique, idéologique se réduit à cela : le nombre de publications, d’étudiants, d’heures de cours, de chercheurs. On est là du côté de la mathématique de la psychologie fonctionnant à partir de statistiques. Foucault rappelle que les statistiques, étymologiquement, c’est d’abord ce qui a trait à l’Etat. Avant d’être une heuristique de la scientificité, les statistiques ont été un opérateur de police sociale prédisposant au rationalisme économique et à ses dérives barbares.
Le modèle de l’ascension universitaire d’une psychologie clinique essentiellement orientée par la psychopathologie clinique traditionnelle, telle que la psychiatrie classique avait largement contribué à la construire, et par la psychanalyse, c’est Paris VII. Le département de Sciences humaines cliniques, d’abord initié par Laplanche au moment de sa création au début des années soixante-dix, puis développé par Fédida, a bénéficié des efforts faits dans l’après-guerre, à Strasbourg, puis à la Sorbonne, par Lagache et Favez-Boutonnier, puis par Anzieu à Nanterre, et bien d’autres encore, pour institutionnaliser la psychologie clinique et l’ancrer dans le cadre épistémologique d’une psychopathologie rigoureuse, qui ne soit pas seulement une sémiologie, mais aussi une éthique de la pratique, tributaire d’une certaine conception du sujet. Avec plus ou moins de compromis, de concessions locales, d’aménagements diplomatiques, ce modèle s’est étendu au niveau national, rapprochant de plus en plus la formation du psychologue clinicien d’activités de soins psychiques dans des services publics.
Ce type de formation promeut un psychologue clinicien moins du côté du conseil ou de l’éducation que du soin psychique en équipe au seuil d’un hôpital psychiatrique, d’un CMP ou dans les milieux socio-éducatifs. Cette « inquiétante familiarité » entre la psychanalyse et la psychologie clinique s’est donc heurtée à une « Restauration » à partir du milieu des années quatre-vingt et dans les années quatre-vingt dix qui procède par une espèce d’homogénéisation, de standardisation des cursus de psychologie clinique alignés sur les autres cursus de psychologie au nom de la science, de la raison universitaire, quand bien même c’est davantage des opportunités sociales, idéologiques, politiques qui ont préparé la tentative de mettre en bière la psychologie clinique. C’est au nom d’une remédicalisation que la santé mentale démolit la psychiatrie et la formation des psychiatres, et c’est au nom de la science psychologique et des critères de la communauté universitaire que la psychologie essaye de démolir la psychologie clinique en créant une psychologie clinique faite par des non-cliniciens et pour des non-cliniciens. Ce désastre, dont Edouard Zarifian qui vient malheureusement de disparaître — cf la nécrologie du Monde du 23 février 2007 — constatait les effets en psychiatrie, risque aujourd'hui même de s’étendre à la psychologie clinique. Précisons.
Dans les années 1990, nous nous apercevons notamment par nos expériences de responsabilités au sein des commissions chargées du recrutement universitaire, comment, à être placée sur le lit de Procuste, la psychologie clinique qui est devenue entre-temps la psychopathologie clinique, c’est-à-dire qui a davantage centré les choses sur la psychopathologie freudienne, la connaissance de la souffrance par la souffrance, va disparaître si on ne réagit pas. La résistance est née en même temps que l’oppression… Dès le début des années quatre-vingt dix, on a essayé de mettre en place des réseaux qui visaient à faire reconnaître socialement nos pratiques avec nos critères et nos exigences, en essayant de ne céder ni sur la spécificité de la méthode clinique et ses objets, ni sur les exigences de la communauté universitaire. On a ainsi essayé de négocier notre existence à l’Université en sachant qu’elle devenait exceptionnelle dans le contexte international, où, en dehors de l’Amérique latine et de quelques oasis européennes, c’était la déferlante cognitivo-comportementale qui prenait le relais puisque on était face à de nouvelles figures de la rationalité biomédicale et biopsychologique permettant l’avènement de la psychologie différentielle, qui devient un outil majeur de traitement des données et de transformation de la recherche en psychologie clinique en un « auxiliariat » de l’épidémiologie. Le soin se décompose ainsi en maintenance sociale, regardant toujours plus vers la Préfecture…
Sophie Mendelsohn – Comment avez-vous organisé cette résistance ?
Roland Gori - En créant en 2000, avec Pierre Fédida, le Séminaire inter-universitaire européen d’enseignement et de recherche en psychopathologie et psychanalyse (SIUEERPP). Notre souci, depuis l’amendement Accoyer et la loi de 2004, a été de protéger les psychologues cliniciens, les psychanalystes, les universitaires de psychopathologie autant que le public, en évitant que s’opère un détournement des buts de cette loi. Elle devait protéger le public des dérives sectaires. A l’occasion de la loi, on a eu l’impression qu’un détournement idéologique et politique était opéré qui tirait les choses du côté d’une recomposition du champ de la santé mentale en remédicalisant davantage la psychologie clinique et la psychiatrie. On s’est opposé très fermement à la première version du cahier des charges de ces décrets d’application de la loi, qui prévoyait une formation aux quatre approches psychothérapiques « scientifiquement validées », la psychanalyse étant l’une d’elles. C’était une double imposture : d’une part, je ne vois pas comment on peut former en quelques dizaines d’heures à une pratique de l’analyse, d’autre part, mettre l’analyse sur le même plan que la psychothérapie intégrative, alors que personne ne sait trop ce que c’est, ou les TCC qui sont bonnes pour les rats, les lapins et les chats, et encore comme dit Winnicott… Ce n’était pas très sérieux.
On a voulu éviter que soit défini un cahier des charges de la formation en psychopathologie qui transformait les choses en psychothérapie d'Etat. On a essayé de faire valoir que le Ministère de la Santé n’avait pas à s’arroger le droit de modifier les formations existantes en psychopathologie clinique. Ce qui risquait de se faire à partir du moment où il y avait dans les décrets d’application les contenus et les modalités de la formation en psychopathologie clinique. Automatiquement, on pouvait craindre une ombre portée de ces décrets sur les formations existantes. On a souligné qu’il y avait une formation en psychopathologie dans le cadre des masters de psychologie clinique. Autrement dit : si vous voulez des prérequis en psychopathologie pour user du titre de psychothérapeute, très bien, alors reconnaissez ce qui existe et n’essayez pas à cette occasion de modifier ce qui n’est pas de votre domaine de compétence. Ce que les autorités universitaires n’étaient pas parvenues à faire, c’est-à-dire à minorer la psychanalyse au profit des TCC, par le biais de la loi, le Ministère de la Santé risquait de l’imposer. Par conséquent, on voit bien comment il pourrait y avoir une restructuration de la formation universitaire à partir d’un détournement possible de la loi en faveur de la médicalisation des psychologues. Et si vous vous rapportez à toutes les expertises collectives de l’Inserm dans le champ de la santé mentale, vous constaterez cette finalité disciplinaire : transformer le soin psychique en rééducation cognitive ou en pédagogie sanitaire et les psychologues (et autres travailleurs sociaux) en paramédicaux ou en auxiliaires sanitaires. Les praticiens ne mesurent pas assez ce danger alors même qu’ils hurlent contre la « médicalisation » des psychologues dès que l’on évoque la possibilité de travailler au sein des Universités médicales… Le problème n’est plus celui d’un « territoire » (géographique) mais de la définition des épistémologies régionales.
Pour en revenir à ce premier projet de décret, il va de soi que la manière dont se constituait ce cahier des charges visait à pallier à la pénurie de psychiatres : le projet Berland préconisait un transfert de compétence, d’exécution de certains actes, des médecins vers les paramédicaux. La France va manquer de psychiatres : d’ici 2012, 40% des psychiatres en exercice seront partis à la retraite, on a pensé déléguer certains actes aux psychologues. Mais ceux-ci ne se révèlent pas suffisamment corvéables, flexibles, malléables, jetables à merci… Donc il y avait là la possibilité de créer un corps de psychothérapeutes, en quelque sorte des sous-officiers de la santé mentale, reconnus et validés par le Ministère de la Santé et médicalement subordonnés. Les exigences de la formation ne seraient plus définies par une équipe de psychopathologues, mais par des administrateurs de santé. La psychanalyse devient le négatif de cette santé mentale dont le paysage politique est fort inquiétant.
Sophie Mendelsohn – Il s’agirait donc de normaliser d’abord les professionnels, pour normaliser ensuite leurs pratiques ?
Roland Gori - Qu’il s’agisse du Ministère de la Santé, de l’Inserm ou des autres instances, l’enjeu est effectivement de procéder, avant même la normalisation des individus, à la normalisation de ceux qui les prennent en charge. Si on veut normaliser les « anomaliques » et surveiller les populations, il faut commencer par normaliser les travailleurs sociaux et les soignants qui les prennent en charge. C’est chaque fois les mêmes opérateurs de normalisation qui sont en jeu, au nom de la science, des exigences universitaires, de la littérature internationale, c’est-à-dire « états-unienne », au nom du système anglo-saxon qui serait le système le plus sophistiqué du progrès. On met en place des critères qui essayent d’en finir avec cet homme tragique, pour promouvoir le sujet de la santé mentale qui n’est rien d’autre qu’un sujet néo-libéralisé.
Les réformes qui évaluent les laboratoires de recherche, les enseignements, se font de la même manière : transformer toute formation et toute recherche en marchandise en opérant par un rationalisme économique qui transforme les expériences vécues en marchandises. L’unité de compte, concept splendide introduit à l’Université par la réforme dite « LMD », implique que tout est équivalent. Et qu’il n’y a pas que le chiffre qui compte, les fameux « crédits européens ». Il s’agit d’en finir avec le caractère incommensurable de l’expérience vécue, qu’il s’agisse du soin ou de la formation. Pour établir une commensurabilité, il faut une raison calculatrice qui liquide définitivement la raison poétique et la rationalité politique.
La normalisation des populations commence par la normalisation de ceux qui les prennent en charge, en particulier les médecins et les psys. Pour ce faire, il faut commencer par normaliser ceux qui sont chargés de « former » les praticiens : les universitaires. Dans le champ des psys, la psychiatrie s’est alignée sur la critériologie de l’EBM (Evidence Based Medecine) et des expertises généralisées. N’en déplaise au Chœur des vierges, cette conformisation des recherches et des pratiques psychiatriques a été redoutablement efficace ! Et la dernière expertise Inserm sur « Les troubles spécifiques de l’apprentissage » ne fait pas exception à cette logique de conformisation : il suffit pour cela de se rendre compte que cette expertise dans le champ de la santé mentale bafoue les principes fondateurs des expertises collectives mises en place en 1993 - ils stipulent en particulier qu’il ne doit pas y avoir de conflits d’intérêts entre les experts et qu’il doit y avoir un pluralisme. Ce qui est loin d’être le cas et a valu à l’Inserm les « remontrances » du CCNE (Comité consultatif national d’éthique) !!
Pour ce qui est de la psychopathologie à l’Université – site encore irrédentiste à l’expertise des comportements – il suffit à l’heure actuelle de DISQUALIFIER les revues du champ (Adolescence, Cliniques méditerranéennes, Psychologie clinique, etc.) pour pouvoir refuser systématiquement tous les dossiers des cliniciens lors des procédures de recrutement et de qualifications. C’est ce à quoi nous allons assister dans les mois qui viennent si notre communauté ne réagit pas fortement face à cette politique de Procuste. L’institution d’une conformisation de la psychopathologie clinique et de la psychologie clinique aux modèles anglo-saxons sera facilitée par la réforme des procédures d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (ANR). Les informations qui nous parviennent sont très claires : les nominations dans ces lieux décisionnels sont congruentes avec ces critères de normalisation. Demain, il ne sera plus possible de « qualifier » ou de recruter un « clinicien » d’orientation psychanalytique. Et dans moins de dix ans, les praticiens seront à l’image de ceux qui les ont formés… Il ne restera plus que les patients pour faire de la résistance aux dispositifs de normalisation, d’instrumentalisation et de contrôle social. Aux Etats-Unis, on a appelé cela « épidémie de T.P.M. (Trouble de la Personnalité Multiple) »… Après tout pourquoi pas ! ? Si le discours du Maître passe aujourd’hui par les signifiants de l’expertise généralisée pour servir les intérêts d’une initiation sociale néolibérale, d’un assujettissement techno-économique des individus et des populations, les symptômes psychiques s’empareront de ces nouvelles normes pour leur faire objection. Attendons les nouveaux symptômes…
Mais si l’on veut éviter le pire, on ne peut plus se passer d’un examen des conditions politiques de nos actions. C’est là où mon expérience avec « Pas de zéro de conduite » s’est révélée à mes yeux exemplaire. On a vu à peu près 200 000 personnes de tous horizons, de toutes professions, dirent : « non, nous ne voulons pas » de cette expertise Inserm qui justifie la « traque des gosses », le suivi à la trace des comportements animaux de nos enfants, leur dépistage précoce et féroce en vue de les soumettre aux TCC et aux psychotropes. Non, nous ne voulons pas que la souffrance psychique s’offre comme le marché le plus prometteur pour ces faux prophètes de la restauration de l’Ordre Moral et Economique qui ne pensent qu’à faire du chiffre… C’est une aventure formidable.
M. Roland Gori est Président du SIUEERPP.
Source : Site Oedipe
Roland Gori – Le concept de santé mentale est quelque chose que je déteste, qui est venu se substituer à la psychiatrie ou à la psychopathologie, et témoigne de l’état culturel dans lequel nous sommes pour traiter l’angoisse, la folie, le conflit. C’est-à-dire, pour reprendre ce que M. Foucault disait en 1954 dans « Maladie mentale et psychologie », avant même l'Histoire de la folie à l'âge classique qui date de 1961 : la psychopathologie est un « fait de civilisation ». C’est un point très important : cela vient attester de cette « niche écologique », pour citer I. Hacking, que sont les diagnostics psychiatriques – Hacking en parle à propos de certains troubles psychiques transitoires, comme les personnalités multiples, ou les fugues dites pathologiques. Cette niche écologique montre qu’il y a ce que j’appelle une réalité transactionnelle incessante dans la manière dont les experts permettent aux patients à un moment donné d’exprimer leurs souffrances psychiques en fonction de la culture dans laquelle ils sont tous deux immergés. Il y a des formes culturelles de la pathologie, qui se déduisent d’une négociation incessante entre les enveloppes formelles de la culture, l’histoire de la souffrance psychique d’un sujet et la manière dont on apprend à des experts à poser des diagnostics. Ce que j’appelle « le nouveau sujet de la santé mentale », n’est plus de même nature ontologique et épistémologique que le sujet de la folie ou de la psychiatrie.
Sophie Mendelsohn – Quelles sont les coordonnées de ce « nouveau sujet de la santé mentale » ?
Roland Gori – Il s’agit d’un sujet conçu comme un individu entrepreneur de lui-même, qui possède un capital bio-psycho-social qu’il doit rentabiliser comme une entreprise, au mieux de ses idéaux de performance. L’individu est conçu comme une micro-entreprise libérale, autogérée et ouverte à la concurrence et à la compétition, qui peut produire ce qu’elle veut pour sa propre satisfaction à condition de respecter un certain nombre de règles du marché qui sont sans cesse réajustées. Pour prendre un exemple, on voit bien comment l’identification sexuée, que d’aucuns appellent le genre, a une plus grande marge de tolérance sur le marché des valeurs sociales, dans la postmodernité, que ce ne fut le cas dans les années cinquante ou soixante. On voit bien comment certaines formes d’addiction peuvent être tolérées, par exemple, une addiction à la consommation, aux jeux vidéo, au travail, aux médias, alors que c’est de moins en moins le cas pour le tabac et l’alcool, ou pour des drogues douces ou dures. Ce nouveau sujet de la santé mentale, c’est vraiment le sujet produit par le néo-capitalisme ou le capitalisme financier.
Le sujet de la folie, c’est-à-dire le sujet dans un certain état de la culture, était un sujet divisé. Qu’il s’agisse du fou, pour qui la raison est amenée à se débattre avec la déraison ; que ce soit l’angoisse qui favorise le surgissement de quelque chose qui fait délirer, au sens étymologique, dérailler la raison, ou encore que ce soit la névrose où le sujet conflictualisé doit débattre avec lui-même, négocier avec lui-même en fonction de ses impératifs moraux et de ses prétentions à la jouissance, ce sujet était essentiellement sujet à sa propre division. Avec le sujet de la santé mentale, il s’agit d’autre chose : c’est un sujet propriétaire, qui va négocier son accès à des réseaux de jouissance de plus en plus dématérialisés, virtualisés. C’est ce que Ruskin appelle « l’âge des réseaux ». On va évaluer les troubles des comportements en fonction de deux choses : l’insatisfaction de l’individu face à cette jouissance dématérialisée, volatilisée pour reprendre le vieux terme marxiste, et la synergie possible de cette jouissance avec des troubles définissant une population à risque. Ce nouveau sujet est l’opérateur épistémologique et éthique qui circonscrit le champ d’intervention des contrôleurs de gestion de l’intime à partir de sa plainte à lui d’être déprimé, impuissant, en panne, ou en situation de précarité psychique et social. Une désinsertion individuelle, par exemple, potentialise les risques qui sont des risques par rapport à l’ordre économique et social. Ce n’est donc pas du tout étonnant que la santé mentale regarde conjointement dans deux directions : la biologie, qui vise à une naturalisation des troubles et des inégalités sociales, et à des pratiques de pharmacovigilance des comportements individuels et populationnels ; le social, qui vise le revenu compassionnel minimal social et psychique garanti. Je citerai là A. Badiou : le modèle anthropologique de l’humain, c’est un animal pitoyable. Et le nouveau sujet de la santé mentale est un animal pitoyable.
Pourquoi la phénoménologie a-t-elle quasiment disparue ? Pourquoi la nécessité de comprendre le sens du sujet en fonction de l’histoire qui est la sienne et qui est celle de sa culture et de son milieu est-elle déconsidérée ? Nous avons changé de style anthropologique : le style anthropologique d’une culture, c’est justement la manière dont elle traite le dénuement, la folie, le malade, l’enfant, le vieillard. Le style anthropologique actuel promeut le comportement en tant que coefficient de rentabilité individuelle et sociale. L’individu est réduit à la somme de ses comportements, ce qu’E. Roudinesco appelle « l’homme comportemental ». Il est évident qu’on n’a plus besoin d’un homme tragique, d’un homme divisé, d’un homme conflictualisé, étiré entre ses idéaux surmoïques et ses pulsions sexuelles. La rentabilité comportementale suffit.
Il fallait donc changer nos concepts et nos modèles psychiatriques pour stabiliser ce nouveau style… Le DSM III est arrivé à point nommé pour prendre en compte ces changements. Le DSM III est négocié entre 1970 et 1980 aux Etats-Unis par R. Spitzer et sa bande, qui prend le contrôle de l’APA. La question n’est pas tant celle des « dommages collatéraux » du DSM III que la raison pour laquelle il peut émerger à un moment donné dans notre culture. Comme tout un chacun, je me suis longtemps centré sur ces dommages du DSM III dans le champ de la « santé mentale ». Mais il me semble aujourd’hui que la question est de savoir comment la culture a pu promouvoir socialement et idéologiquement des opérateurs « mous », très conformistes et hyperformalistes, pris dans une logique de profit. Pour moi, le nouveau sujet de la santé mentale est celui des thérapies molles qui viennent assurer la surveillance, la maintenance sociale du quadrillage des populations, leur normalisation. Pour cela, le DSM fournit une classification « flexible ».
Le nouveau sujet de la santé mentale, c’est le sujet des troubles du comportement. Ceux-ci se sont multipliés par 3 ou 4 en vingt ans. Si on rajoute des tiroirs, c’est parce que l’armoire est mal foutue ! Le DSM ne tient pas. Mais en créant de nouveaux troubles du comportement, on crée un marché de plus en plus porteur pour la consommation de psychotropes et de pratiques thérapeutiques. Le DSM III enterre la psychiatrie : il est véritablement « psychiatricide » – bien plus que M. Foucault, qu’Henri Ey avait qualifié ainsi… Ce DSM se veut à la fois pragmatique, efficace, formel, et juridiquement irréprochable. Il se veut athéorique. Dix ans plus tard, le DSM IV a l’arrogance que le III ne pouvait pas avoir, en évacuant la névrose et en rétablissant l’implicite d’une étiologie organique des troubles du comportement. On a démantelé le continent de la névrose. C’était nécessaire pour passer du sujet tragique de la psychiatrie du XIXème et du XXème siècle, au sujet de la santé mentale, il fallait aller vers quelque chose comme l’expertise des comportements, que l’on va suivre à la trace, de manière à la fois de plus en plus précoce, et de plus en plus féroce. On en vient aux expertises de l’Inserm dans le champ de la santé mentale. Ça ne vaut pas grand-chose, mais ça vient donner une légitimité, une rhétorique de propagande aux opérateurs sociaux de validation de cette santé mentale, qui n’est plus que l’ombre de la grande psychiatrie. Cela transforme un rapport de forces en rapport de légitimité… Cela assure une performativité sociale et épistémologique.
Sophie Mendelsohn – Quel est l’impact spécifique de ce concept de « santé mentale » sur la psychopathologie clinique ?
Roland Gori – Il est l’acte de décès de la psychopathologie… Que cette psychopathologie clinique soit mise en œuvre par les psychiatres ou les psychologues cliniciens, elle est leur certificat de décès.
On en revient tout simplement à une conception déficitaire du symptôme. Lacan insistait beaucoup en disant que Freud avait opéré une promotion du symptôme. Que voulait-il dire ? Le symptôme est l’enveloppe par laquelle se manifeste une souffrance avant d’être codée par un savoir médical, c’est-à-dire avant d’être transformée en signe apte à constituer une sémiologie médicale. Pour Freud, il n’y a pas de « défectologie » de la psychiatrie. Or, nous y revenons avec la notion de troubles du comportement. Nous sommes dans quelque chose qui est de l’ordre d’un paradigme déficitaire, comme au bon vieux temps… des théories de la dégénérescence. Lisez les deux dernières expertises collectives et l’Inserm : c’est évident.
La psychologie différentielle, rebaptisée « psychologie de la santé », la psychologie du développement, rebaptisée « neurosciences développementales », la psychologie sociale dans une moindre mesure, peuvent tirer profit de la disparition de la grande psychiatrie et de la psychopathologie clinique. Les experts du comportement peuvent participer à des études qui suivent les individus à la trace. De la même manière, ces psychologues peuvent participer à la normalisation des conduites et à l’encadrement pédagogique (et sanitaire) des populations. C’est à l’intérieur du champ de la psychologie que le problème se pose. La création de la santé mentale se révèle comme un produit idéologique qui surgit dans une culture politique donnée, le néolibéralisme américain, système économico-politique qui vient recomposer le champ des pratiques professionnelles du soin psychique.
Sophie Mendelsohn – Comment expliquer que la psychologie ait accompagné, voire participé à cette mutation du style anthropologique de notre culture ?
Roland Gori – La médecine comme la psychologie ne sont pas seulement des rationalités scientifiques ou des pratiques professionnelles. Elles sont aussi des pratiques sociales qui participent au gouvernement des conduites. Or, c’est la culture qui peut rendre compte de la manière dont émergent ces formes de rationalité. On le sait, depuis la deuxième moitié du XVIIIème siècle, il y a une médicalisation de l’existence. La médecine est appelée à ouvrir les états généraux infinis du contrôle social des populations au nom de la raison sanitaire, de l’hygiène publique. Dans cette médicalisation de l’existence, la psychologisation du social constitue seulement une annexe, une résidence secondaire de la biopolitique.
On a évoqué tout à l’heure le DSM. Ce n’est pas un hasard que la santé mentale soit arrivée en 1980, parce que nous sommes à ce moment-là à une époque où les philosophes, les politiques et les experts se consacrent à ce que Badiou appelle la « Restauration ». Nous sommes en effet, en ce début du XXIe siècle, à l’époque de cette deuxième Restauration.
Le milieu des années quatre-vingt marque effectivement un tournant décisif. Jusque là s’est développé dans toute la France un fort courant de cliniciens qui revendiquait une certaine autonomie par rapport aux critères traditionnels de la psychologie dans les formations et dans les recherches, et la demande sociale comme la demande étudiante se portaient vers eux. La question se posait même de savoir si la psychologie clinique ne devait pas se séparer de la psychologie sans se confondre pour autant avec la psychanalyse et ses dispositifs spécifiques de transmission. Il faut considérer le fait qu’il y a une irrigation extrêmement importante par les psychanalystes des champs de la formation professionnelle des psychiatres et des psychologues cliniciens. Il n’y a pas seulement des enseignements de métapsychologie, de psychopathologie, il y a aussi des TD, des groupes de supervision, des stages cliniques qui sont requis et qui assurent à la dimension clinique de la formation en psychologie une importance de plus en plus déterminante, en s’opposant notamment à ce modèle sans cesse revendiqué par la Nomenklatura de la psychologie, c’est-à-dire une formation généraliste avec tronc commun et zapping des concepts, des méthodes et des pratiques.
L’ouvrage d’un Belge, W. Huber, paru en 1987, permet de se rendre compte à quel point cette situation constitue une exception française : la psychologie clinique en France commence à se distinguer radicalement des psychologies cliniques en Europe, qui se sont « scientifisées », médicalisées, « TCCisées ». C’est alors que commence cette seconde « Restauration ». Le psychologue doit se faire l’instrument, comme disait Canguilhem, d’un pouvoir qui traite l’homme en instrument. On s’éloigne du Panthéon et on descend vers la Préfecture…
Il suffit ensuite de choisir quelques personnes et de les placer dans les instances décisionnaires du Ministère de l’Enseignement Supérieur pour essayer de normaliser le modèle français en l’alignant sur le modèle anglo-saxon. Ils imposent des critères d’évaluation de plus en plus conformistes, qui impliquent une certaine conception de la recherche qui est la même que celle du marché : « Il n’y a que le chiffre qui compte ». L’opérateur conceptuel de cette pensée politique, idéologique se réduit à cela : le nombre de publications, d’étudiants, d’heures de cours, de chercheurs. On est là du côté de la mathématique de la psychologie fonctionnant à partir de statistiques. Foucault rappelle que les statistiques, étymologiquement, c’est d’abord ce qui a trait à l’Etat. Avant d’être une heuristique de la scientificité, les statistiques ont été un opérateur de police sociale prédisposant au rationalisme économique et à ses dérives barbares.
Le modèle de l’ascension universitaire d’une psychologie clinique essentiellement orientée par la psychopathologie clinique traditionnelle, telle que la psychiatrie classique avait largement contribué à la construire, et par la psychanalyse, c’est Paris VII. Le département de Sciences humaines cliniques, d’abord initié par Laplanche au moment de sa création au début des années soixante-dix, puis développé par Fédida, a bénéficié des efforts faits dans l’après-guerre, à Strasbourg, puis à la Sorbonne, par Lagache et Favez-Boutonnier, puis par Anzieu à Nanterre, et bien d’autres encore, pour institutionnaliser la psychologie clinique et l’ancrer dans le cadre épistémologique d’une psychopathologie rigoureuse, qui ne soit pas seulement une sémiologie, mais aussi une éthique de la pratique, tributaire d’une certaine conception du sujet. Avec plus ou moins de compromis, de concessions locales, d’aménagements diplomatiques, ce modèle s’est étendu au niveau national, rapprochant de plus en plus la formation du psychologue clinicien d’activités de soins psychiques dans des services publics.
Ce type de formation promeut un psychologue clinicien moins du côté du conseil ou de l’éducation que du soin psychique en équipe au seuil d’un hôpital psychiatrique, d’un CMP ou dans les milieux socio-éducatifs. Cette « inquiétante familiarité » entre la psychanalyse et la psychologie clinique s’est donc heurtée à une « Restauration » à partir du milieu des années quatre-vingt et dans les années quatre-vingt dix qui procède par une espèce d’homogénéisation, de standardisation des cursus de psychologie clinique alignés sur les autres cursus de psychologie au nom de la science, de la raison universitaire, quand bien même c’est davantage des opportunités sociales, idéologiques, politiques qui ont préparé la tentative de mettre en bière la psychologie clinique. C’est au nom d’une remédicalisation que la santé mentale démolit la psychiatrie et la formation des psychiatres, et c’est au nom de la science psychologique et des critères de la communauté universitaire que la psychologie essaye de démolir la psychologie clinique en créant une psychologie clinique faite par des non-cliniciens et pour des non-cliniciens. Ce désastre, dont Edouard Zarifian qui vient malheureusement de disparaître — cf la nécrologie du Monde du 23 février 2007 — constatait les effets en psychiatrie, risque aujourd'hui même de s’étendre à la psychologie clinique. Précisons.
Dans les années 1990, nous nous apercevons notamment par nos expériences de responsabilités au sein des commissions chargées du recrutement universitaire, comment, à être placée sur le lit de Procuste, la psychologie clinique qui est devenue entre-temps la psychopathologie clinique, c’est-à-dire qui a davantage centré les choses sur la psychopathologie freudienne, la connaissance de la souffrance par la souffrance, va disparaître si on ne réagit pas. La résistance est née en même temps que l’oppression… Dès le début des années quatre-vingt dix, on a essayé de mettre en place des réseaux qui visaient à faire reconnaître socialement nos pratiques avec nos critères et nos exigences, en essayant de ne céder ni sur la spécificité de la méthode clinique et ses objets, ni sur les exigences de la communauté universitaire. On a ainsi essayé de négocier notre existence à l’Université en sachant qu’elle devenait exceptionnelle dans le contexte international, où, en dehors de l’Amérique latine et de quelques oasis européennes, c’était la déferlante cognitivo-comportementale qui prenait le relais puisque on était face à de nouvelles figures de la rationalité biomédicale et biopsychologique permettant l’avènement de la psychologie différentielle, qui devient un outil majeur de traitement des données et de transformation de la recherche en psychologie clinique en un « auxiliariat » de l’épidémiologie. Le soin se décompose ainsi en maintenance sociale, regardant toujours plus vers la Préfecture…
Sophie Mendelsohn – Comment avez-vous organisé cette résistance ?
Roland Gori - En créant en 2000, avec Pierre Fédida, le Séminaire inter-universitaire européen d’enseignement et de recherche en psychopathologie et psychanalyse (SIUEERPP). Notre souci, depuis l’amendement Accoyer et la loi de 2004, a été de protéger les psychologues cliniciens, les psychanalystes, les universitaires de psychopathologie autant que le public, en évitant que s’opère un détournement des buts de cette loi. Elle devait protéger le public des dérives sectaires. A l’occasion de la loi, on a eu l’impression qu’un détournement idéologique et politique était opéré qui tirait les choses du côté d’une recomposition du champ de la santé mentale en remédicalisant davantage la psychologie clinique et la psychiatrie. On s’est opposé très fermement à la première version du cahier des charges de ces décrets d’application de la loi, qui prévoyait une formation aux quatre approches psychothérapiques « scientifiquement validées », la psychanalyse étant l’une d’elles. C’était une double imposture : d’une part, je ne vois pas comment on peut former en quelques dizaines d’heures à une pratique de l’analyse, d’autre part, mettre l’analyse sur le même plan que la psychothérapie intégrative, alors que personne ne sait trop ce que c’est, ou les TCC qui sont bonnes pour les rats, les lapins et les chats, et encore comme dit Winnicott… Ce n’était pas très sérieux.
On a voulu éviter que soit défini un cahier des charges de la formation en psychopathologie qui transformait les choses en psychothérapie d'Etat. On a essayé de faire valoir que le Ministère de la Santé n’avait pas à s’arroger le droit de modifier les formations existantes en psychopathologie clinique. Ce qui risquait de se faire à partir du moment où il y avait dans les décrets d’application les contenus et les modalités de la formation en psychopathologie clinique. Automatiquement, on pouvait craindre une ombre portée de ces décrets sur les formations existantes. On a souligné qu’il y avait une formation en psychopathologie dans le cadre des masters de psychologie clinique. Autrement dit : si vous voulez des prérequis en psychopathologie pour user du titre de psychothérapeute, très bien, alors reconnaissez ce qui existe et n’essayez pas à cette occasion de modifier ce qui n’est pas de votre domaine de compétence. Ce que les autorités universitaires n’étaient pas parvenues à faire, c’est-à-dire à minorer la psychanalyse au profit des TCC, par le biais de la loi, le Ministère de la Santé risquait de l’imposer. Par conséquent, on voit bien comment il pourrait y avoir une restructuration de la formation universitaire à partir d’un détournement possible de la loi en faveur de la médicalisation des psychologues. Et si vous vous rapportez à toutes les expertises collectives de l’Inserm dans le champ de la santé mentale, vous constaterez cette finalité disciplinaire : transformer le soin psychique en rééducation cognitive ou en pédagogie sanitaire et les psychologues (et autres travailleurs sociaux) en paramédicaux ou en auxiliaires sanitaires. Les praticiens ne mesurent pas assez ce danger alors même qu’ils hurlent contre la « médicalisation » des psychologues dès que l’on évoque la possibilité de travailler au sein des Universités médicales… Le problème n’est plus celui d’un « territoire » (géographique) mais de la définition des épistémologies régionales.
Pour en revenir à ce premier projet de décret, il va de soi que la manière dont se constituait ce cahier des charges visait à pallier à la pénurie de psychiatres : le projet Berland préconisait un transfert de compétence, d’exécution de certains actes, des médecins vers les paramédicaux. La France va manquer de psychiatres : d’ici 2012, 40% des psychiatres en exercice seront partis à la retraite, on a pensé déléguer certains actes aux psychologues. Mais ceux-ci ne se révèlent pas suffisamment corvéables, flexibles, malléables, jetables à merci… Donc il y avait là la possibilité de créer un corps de psychothérapeutes, en quelque sorte des sous-officiers de la santé mentale, reconnus et validés par le Ministère de la Santé et médicalement subordonnés. Les exigences de la formation ne seraient plus définies par une équipe de psychopathologues, mais par des administrateurs de santé. La psychanalyse devient le négatif de cette santé mentale dont le paysage politique est fort inquiétant.
Sophie Mendelsohn – Il s’agirait donc de normaliser d’abord les professionnels, pour normaliser ensuite leurs pratiques ?
Roland Gori - Qu’il s’agisse du Ministère de la Santé, de l’Inserm ou des autres instances, l’enjeu est effectivement de procéder, avant même la normalisation des individus, à la normalisation de ceux qui les prennent en charge. Si on veut normaliser les « anomaliques » et surveiller les populations, il faut commencer par normaliser les travailleurs sociaux et les soignants qui les prennent en charge. C’est chaque fois les mêmes opérateurs de normalisation qui sont en jeu, au nom de la science, des exigences universitaires, de la littérature internationale, c’est-à-dire « états-unienne », au nom du système anglo-saxon qui serait le système le plus sophistiqué du progrès. On met en place des critères qui essayent d’en finir avec cet homme tragique, pour promouvoir le sujet de la santé mentale qui n’est rien d’autre qu’un sujet néo-libéralisé.
Les réformes qui évaluent les laboratoires de recherche, les enseignements, se font de la même manière : transformer toute formation et toute recherche en marchandise en opérant par un rationalisme économique qui transforme les expériences vécues en marchandises. L’unité de compte, concept splendide introduit à l’Université par la réforme dite « LMD », implique que tout est équivalent. Et qu’il n’y a pas que le chiffre qui compte, les fameux « crédits européens ». Il s’agit d’en finir avec le caractère incommensurable de l’expérience vécue, qu’il s’agisse du soin ou de la formation. Pour établir une commensurabilité, il faut une raison calculatrice qui liquide définitivement la raison poétique et la rationalité politique.
La normalisation des populations commence par la normalisation de ceux qui les prennent en charge, en particulier les médecins et les psys. Pour ce faire, il faut commencer par normaliser ceux qui sont chargés de « former » les praticiens : les universitaires. Dans le champ des psys, la psychiatrie s’est alignée sur la critériologie de l’EBM (Evidence Based Medecine) et des expertises généralisées. N’en déplaise au Chœur des vierges, cette conformisation des recherches et des pratiques psychiatriques a été redoutablement efficace ! Et la dernière expertise Inserm sur « Les troubles spécifiques de l’apprentissage » ne fait pas exception à cette logique de conformisation : il suffit pour cela de se rendre compte que cette expertise dans le champ de la santé mentale bafoue les principes fondateurs des expertises collectives mises en place en 1993 - ils stipulent en particulier qu’il ne doit pas y avoir de conflits d’intérêts entre les experts et qu’il doit y avoir un pluralisme. Ce qui est loin d’être le cas et a valu à l’Inserm les « remontrances » du CCNE (Comité consultatif national d’éthique) !!
Pour ce qui est de la psychopathologie à l’Université – site encore irrédentiste à l’expertise des comportements – il suffit à l’heure actuelle de DISQUALIFIER les revues du champ (Adolescence, Cliniques méditerranéennes, Psychologie clinique, etc.) pour pouvoir refuser systématiquement tous les dossiers des cliniciens lors des procédures de recrutement et de qualifications. C’est ce à quoi nous allons assister dans les mois qui viennent si notre communauté ne réagit pas fortement face à cette politique de Procuste. L’institution d’une conformisation de la psychopathologie clinique et de la psychologie clinique aux modèles anglo-saxons sera facilitée par la réforme des procédures d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (ANR). Les informations qui nous parviennent sont très claires : les nominations dans ces lieux décisionnels sont congruentes avec ces critères de normalisation. Demain, il ne sera plus possible de « qualifier » ou de recruter un « clinicien » d’orientation psychanalytique. Et dans moins de dix ans, les praticiens seront à l’image de ceux qui les ont formés… Il ne restera plus que les patients pour faire de la résistance aux dispositifs de normalisation, d’instrumentalisation et de contrôle social. Aux Etats-Unis, on a appelé cela « épidémie de T.P.M. (Trouble de la Personnalité Multiple) »… Après tout pourquoi pas ! ? Si le discours du Maître passe aujourd’hui par les signifiants de l’expertise généralisée pour servir les intérêts d’une initiation sociale néolibérale, d’un assujettissement techno-économique des individus et des populations, les symptômes psychiques s’empareront de ces nouvelles normes pour leur faire objection. Attendons les nouveaux symptômes…
Mais si l’on veut éviter le pire, on ne peut plus se passer d’un examen des conditions politiques de nos actions. C’est là où mon expérience avec « Pas de zéro de conduite » s’est révélée à mes yeux exemplaire. On a vu à peu près 200 000 personnes de tous horizons, de toutes professions, dirent : « non, nous ne voulons pas » de cette expertise Inserm qui justifie la « traque des gosses », le suivi à la trace des comportements animaux de nos enfants, leur dépistage précoce et féroce en vue de les soumettre aux TCC et aux psychotropes. Non, nous ne voulons pas que la souffrance psychique s’offre comme le marché le plus prometteur pour ces faux prophètes de la restauration de l’Ordre Moral et Economique qui ne pensent qu’à faire du chiffre… C’est une aventure formidable.
M. Roland Gori est Président du SIUEERPP.
Source : Site Oedipe