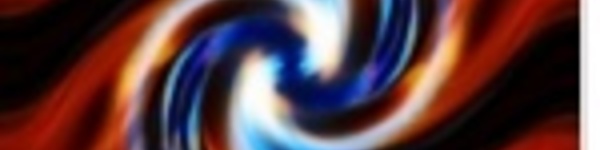Intervention de Lacan, le 16 février 1966, au Collège de médecine sur « La place de la psychanalyse dans la médecine ».
Vous me permettrez, sur certaines questions qui viennent d’être posées, de m’en tenir aux réponses de Mme Aubry qui me semblent très suffisamment pertinentes. Je ne vois pas que démocratiser l’enseignement de la psychanalyse pose d’autre problème que celui de la définition de notre démocratie. C’en est une, mais il y en a plusieurs espèces concevables et l’avenir nous mène vers une autre.
Ce que je croyais avoir à apporter à une réunion comme celle-ci caractérisée par qui la convoque, c’est-à-dire le Collège de médecine, c’était très précisément d’aborder un sujet que je n’ai jamais eu à traiter dans mon enseignement, celui de la place de la psychanalyse dans la médecine.
Actuellement cette place est marginale et comme je l’ai écrit à plusieurs reprises, extra-territoriale. Elle est marginale de fait de la position de la médecine vis-à-vis de la psychanalyse, qui l’admet comme une sorte d’aide extérieure, comparable à celle des psychologues et de différents autres assistants thérapeutiques. Elle est extra-territoriale du fait des psychanalystes qui, sans doute, ont leurs raisons pour vouloir conserver cette extra-territorialité. Ce ne sont pas les miennes, mais à la vérité, je ne pense pas que mon seul vœu là-dessus suffira à changer les choses. Elles trouveront place en leur temps, c’est-à-dire extrêmement vite à considérer la sorte d’accélération que nous vivons quant à la part de la science dans la vie commune.
Cette place de la psychanalyse dans la médecine, je voudrais aujourd’hui la considérer du point de vue du médecin et du très rapide changement qui est en train de se produire dans ce que j’appellerai la fonction du médecin, et dans son personnage puisqu’aussi bien c’est là un élément important de sa fonction.
Pendant toute la période de l’histoire que nous connaissons et pouvons qualifier comme telle, cette fonction, ce personnage du médecin sont restés d’une grande constance jusqu’à une époque récente.
Il faut cependant remarquer que la pratique de la médecine n’est jamais allée sans un grand accompagnement de doctrines. Que pendant un temps assez court, au 19e siècle, les doctrines se soient réclamées de la science, ne les a pas rendues plus scientifiques pour autant. Je veux dire que les doctrines scientifiques invoquées dans la médecine étaient toujours, jusqu’à une époque récente, reprises de quelque acquis scientifique, mais avec un retard de vingt ans au moins. Ceci montre bien que ce recours n’a fonctionné que comme substitut et pour masquer ce qu’antérieurement il faut bien plutôt repérer comme une sorte de philosophie.
À considérer l’histoire du médecin à travers les âges, le grand médecin, le médecin type était un homme de prestige et d’autorité. Ce qui se passe entre le médecin et le malade, facilement illustré maintenant par des remarques comme celle de Balint, que le médecin en prescrivant se prescrit lui-même, s’est toujours passé : ainsi l’empereur Marc-Aurèle convoquait Galien pour qu’il fût versé de ses mains la thériaque. C’est d’ailleurs Galien qui a écrit le traité De historia philosophica, que le médecin, dans son meilleur, est aussi un philosophe, où ce mot ne se limite pas au sens tardif de philosophie de la nature.
Mais donnez à ce mot le sens que vous voudrez, la question qu’il s’agit de situer s’éclairera d’autres repères. Je pense qu’ici, bien que dans une assistance en majorité médicale, on ne me demande pas d’indiquer ce que M. Foucault nous apporte, dans son grand ouvrage, d’une méthode historico-critique pour situer la responsabilité de la médecine dans la grande crise éthique (c’est-à-dire touchant la définition de l’homme) qu’il centre autour de l’isolation de la folie ; non plus que d’introduire cet autre ouvrage Naissance de la clinique en tant qu’y est fixé ce que comporte la promotion par Bichat d’un regard qui se fixe sur le champ du corps dans ce court temps où il subsiste comme rendu à la mort, c’est-à-dire le cadavre.
Les deux franchissements sont ainsi marqués, par quoi la médecine consomme pour sa part la fermeture des portes d’un antique Janus, celui qui redoublait irretrouvablement tout geste humain d’une figure sacrée. La médecine est une corrélation de ce franchissement. Le passage de la médecine sur le plan de la science et même le fait que l’exigence de la condition expérimentale ait été induite dans la médecine par Claude Bernard et ses consorts, ce n’est pas cela qui compte à soi seul, la balance est ailleurs.
La médecine est entrée dans sa phase scientifique, pour autant qu’un monde est né qui désormais exige les conditionnements nécessités dans la vie de chacun à mesure de la part qu’il prend à la science, présente à tous en ses effets.
Les fonctions de l’organisme humain ont toujours fait l’objet d’une mise à l’épreuve selon le contexte social. Mais d’être prises en fonction serve dans les organisations hautement différenciées qui ne seraient pas nées sans la science, elles s’offrent au médecin dans le laboratoire déjà constitué en quelque sorte, voire déjà fourni des crédits sans limites, qu’il va employer à réduire ces fonctions à des montages équivalents à ceux de ces autres organisations, c’est-à-dire ayant statut de subsistance scientifique.
Citons simplement ici, pour éclairer notre lanterne, ce que doit notre progrès dans la formalisation fonctionnelle de l’appareil cardio-vasculaire et de l’appareil respiratoire non seulement à la nécessité de l’opérer, mais à l’appareil même de leur inscription, en tant qu’ils s’imposent à partir du logement des sujets de ces réactions dans des « satellites » ; soit ce qu’on peut considérer comme de formidables poumons d’acier, dont la construction elle-même est liée à leur destination de supports de certaines orbites, orbites qu’on aurait bien tort d’appeler cosmiques, puisque ces orbites, le cosmos ne les « connaissait » pas. Pour tout dire, c’est du même pas dont se révèle la surprenante tolérance de l’homme à des conditions acosmiques, voire le paradoxe qui l’y fait apparaître en quelque sorte « adapté », qu’il s’avère que cet acosmisme est ce que la science construit. Qui pouvait imaginer que l’homme supporterait très bien l’apesanteur, qui pouvait prédire ce qu’il adviendrait de l’homme dans ces conditions à s’en tenir aux métaphores philosophiques, à celle par exemple de Simone Weill que faisait de la pesanteur une des dimensions d’une telle métaphore ?
C’est dans la mesure où les exigences sociales sont conditionnées par l’apparition d’un homme servant les conditions d’un monde scientifique que, nanti de pouvoirs nouveaux d’investigation et de recherche, le médecin se trouve affronté à des problèmes nouveaux. Je veux dire que le médecin n’a plus rien de privilégié dans l’ordre de cette équipe de savants diversement spécialisés dans les différentes branches scientifiques. C’est de l’extérieur de sa fonction, nommément dans l’organisation industrielle, que lui sont fournis les moyens en même temps que les questions pour introduire les mesures de contrôle quantitatif, les graphiques, les échelles, les données statistiques par où s’établissent jusqu’à l’échelle microscopique les constantes biologiques et que s’instaure dans son domaine ce décollement de l’évidence de la réussite, qui est la condition de l’avènement des faits.
La collaboration médicale sera considérée comme la bienvenue pour programmer les opérations nécessaires à maintenir le fonctionnement de tel ou tel appareil de l’organisme humain, dans des conditions déterminées, mais après tout, en quoi cela a-t-il à faire avec ce que nous appelons la position traditionnelle du médecin ?
Le médecin est requis dans la fonction du savant physiologiste mais il subit d’autres appels encore : le monde scientifique déverse entre ses mains le nombre infini de ce qu’il peut produire comme agents thérapeutiques nouveaux chimiques ou biologiques, qu’il met à la disposition du public et il demande au médecin, comme à un agent distributeur, de les mettre à l’épreuve. Où est la limite où le médecin doit agir et à quoi doit-il répondre ? À quelque chose qui s’appelle la demande.
Je dirai que c’est dans la mesure de ce glissement, de cette évolution, qui change la position du médecin au regard de ceux qui s’adressent à lui, que vient à s’individualiser, à se spécifier, à se mettre rétroactivement en valeur, ce qu’il y a d’original dans cette demande au médecin. Ce développement scientifique inaugure et met de plus en plus au premier plan ce nouveau droit de l’homme à la santé, qui existe et se motive déjà dans une organisation mondiale. Dans la mesure où le registre du rapport médicale à la santé se modifie, où cette sorte de pouvoir généralisé qu’est le pouvoir de la science, donne à tous la possibilité de venir demander au médecin son ticket de bienfait dans un but précis immédiat, nous voyons se dessiner l’originalité d’une dimension que j’appelle la demande. C’est dans le registre du mode de réponse à la demande du malade qu’est la chance de survie de la position proprement médicale.
Répondre que le malade vient vous demander la guérison n’est rien répondre du tout, car chaque fois que la tâche précise, qui est à accomplir d’urgence, ne répond pas purement et simplement à une possibilité qui se trouve à la portée de la main, mettons un appareillage chirurgicale ou l’administration d’antibiotiques - et même dans ces cas il reste à savoir ce qui en résulte pour l’avenir. Il y a hors du champ de ce qui est modifié par le bienfait thérapeutique quelque chose qui reste constant et tout médecin sait bien de quoi il s’agit.
Quand le malade est envoyé au médecin ou quand il l’aborde, ne dites pas qu’il en attend purement et simplement la guérison. Il met le médecin à l’épreuve de le sortir de sa condition de malade, ce qui est tout à fait différent, car ceci peut impliquer qu’il est tout à fait attaché à l’idée de la conserver. Il vient parfois nous demander de l’authentifier comme malade, dans bien d’autres cas il vient, de la façon la plus manifeste, vous demander de le préserver dans sa maladie, de le traiter de la façon qui lui convient à lui, celle qui lui permettra de continuer d’être un malade bien installé dans sa maladie. Ai-je besoin d’évoquer mon expérience la plus récente : un formidable état de dépression anxieuse permanente, durant déjà plus de 20 ans, le malade venait me trouver dans la terreur que je fis la moindre chose. À la seule proposition de me revoir 48 heures plus tard, déjà, la mère, redoutable, qui était pendant ce temps campée dans mon salon d’attente avait réussi à prendre des dispositions pour qu’il n’en fût rien.
Ceci est d’expérience banale, je ne l’évoque que pour vous rappeler la signification de la demande, dimension où s’exerce à proprement parler la fonction médicale, et pour introduire ce qui semble facile à toucher et pourtant n’a été sérieusement interrogé que dans mon école, à savoir la structure de la faille qui existe entre la demande et le désir.
Dès qu’on a fait cette remarque, il apparaît qu’il n’est pas nécessaire d’être psychanalyste, ni même médecin, pour savoir que lorsque quiconque, notre meilleur ami, qu’il soit du sexe mâle ou femelle, nous demande quelque chose, ce n’est pas du tout identique et même parfois diamétralement opposé à ce qu’il désire.
Je voudrais reprendre ici les choses à un autre point et faire remarquer que s’il est concevable que nous parvenions à une extension de plus en plus efficace de nos procédés d’intervention concernant le corps humain, sur la base des progrès scientifiques, le problème ne saurait être résolu au niveau de la psychologie du médecin, d’une question qui rafraîchirait le terme de psycho-somatique. Permettez-moi d’épingler plutôt comme faille épistémo-somatique, l’effet que va avoir le progrès de la science sur la relation de la médecine avec le corps.
Là encore la situation est pour la médecine subvertie du dehors. Et c’est pourquoi, ce qui, avant certaines ruptures restait confus, voilé, mêlé, embrouillé, apparaît avec éclat.
Car ce qui est exclu du rapport épistémo-somatique, est justement ce qui va proposer à la médecine le corps dans son registre purifié ; ce qui se présente ainsi se présente en pauvre à la fête où le corps rayonnait tout à l’heure d’être entièrement photographié, radiographié, calibré, diagrammatisé et possible à conditionner, étant donné les ressources vraiment extraordinaires qu’il recèle, mais peut-être aussi ce pauvre lui apporte-t-il une chance qui revient de loin, à savoir de l’exil où a proscrit le corps la dichotomie cartésienne de la pensée et de l’étendue, laquelle laisse complètement choir de sa saisie, ce qu’il en est non pas du corps qu’elle imagine, mais du corps vrai dans sa nature.
Ce corps n’est pas simplement caractérisé par la dimension de l’étendue : un corps est quelque chose qui est fait pour jouir, jouir de soi-même. La dimension de la jouissance est complètement exclue de ce que j’ai appelé le rapport épistémo-somatique. Car le science n’est pas incapable de savoir ce qu’elle peut, mais elle, pas plus que le sujet qu’elle engendre, ne peut avoir ce qu’elle veut. Du moins ce qu’elle veut surgit-il d’une avancée dont la marche accélérée, de nos jours, nous permet de toucher qu’elle dépasse ses propres prévisions.
Pouvons-nous en préjuger, par exemple de ce que notre espace, qu’il soit planétaire ou transplanétaire pullule de quelque chose qu’il faut bien appeler des voix humaines, animant le code qu’elles trouvent en des ondes dont l’entrecroisement nous suggère une toute autre image de l’espace que celle où les tourbillons cartésiens faisaient leur ménage. Pourquoi ne pas parler aussi du regard qui est maintenant omniprésent, sous la forme d’appareils qui voient pour nous aux mêmes lieux : soit quelque chose qui n’est pas un œil et qui isole le regard comme présent. Tout ceci, nous pouvons le mettre à l’actif de la science, mais cela nous fait-il atteindre ce qui là nous concerne, je ne dirai pas comme être humain, car en vérité, Dieu sait ce qu’on agite derrière ce fantoche qu’on appelle l’homme, l’être humain, ou la dignité humaine ou quelle que soit la dénomination sous laquelle chacun met ce qu’il entend de ses propres idéologies plus ou moins révolutionnaires ou réactionnaires…
Nous demanderons plutôt en quoi est-ce que cela concerne ce qui existe, à savoir nos corps ? Des voix, des regards qui se promènent, c’est bien quelque chose qui vient des corps, mais ce sont de curieux prolongements qui, au premier aspect et même au second ou au troisième, n’ont que peu de rapports avec ce que j’appelle la dimension de la jouissance. Il est important de la placer comme pôle opposé, car là aussi la science est en train de déverser certains effets qui ne sont pas sans comporter quelques enjeux. Matérialisons-les sous la forme des divers produits qui vont des tranquillisants jusqu’aux hallucinogènes. Cela complique singulièrement le problème de ce qu’on a jusque là qualifié d’une manière purement policière de toxicomanie. Pour peu qu’un jour nous soyons en possession d’un produit qui nous permette de recueillir des informations sur le monde extérieur, je vois mal comment une contention policière pourrait s’exercer.
Mais quelle sera la position du médecin pour définir ces effets à propos desquels jusqu’ici il a montré une audace nourrie surtout de prétextes, car du point de vue de la jouissance, qu’est-ce qu’un usage ordonné de ce qu’on appelle plus ou moins proprement des toxiques, peut avoir de répréhensible, sauf si le médecin entre franchement dans ce qui est la deuxième dimension caractéristique de sa présence au monde, à savoir la dimension éthique. Ces remarques qui peuvent sembler banales, ont tout de même l’intérêt de démontrer que la dimension éthique est celle qui s’étend dans la direction de la jouissance.
Voilà donc deux repères, premièrement la demande du malade, deuxièmement la jouissance du corps. D’une façon elles confinent sur cette dimension éthique, mais ne les confondons pas trop vite, car ici intervient ce que j’appellerai tout simplement la théorie psychanalytique, qui vient à temps et non pas bien sûr par hasard, au moment de l’entrée en jeu de la science, avec ce léger devancement qui est toujours caractéristique des inventions de Freud. De même que Freud a inventé la théorie du fascisme avant qu’il paraisse, de même, trente ans avant, il a inventé ce qui devait répondre à la subversion de la position du médecin par la montée de la science.
J’ai tout à l’heure suffisamment indiqué la différence qu’il y a entre la demande et le désir. Seule la théorie linguistique peut rendre compte d’une pareille aperception, et elle le peut d’autant plus facilement que c’est Freud qui de la façon la plus vivante et la plus inattaquable en a précisément montré la distance au niveau de l’inconscient. C’est dans la mesure où il est structuré comme un langage qu’il est l’inconscient découvert par Freud. J’ai lu avec étonnement dans un écrit fort bien patronné que l’inconscient était monotone. Je n’invoquerai pas ici mon expérience, je prie simplement qu’on ouvre les trois premières œuvres de Freud, les plus fondamentales et qu’on voie si c’est la monotonie qui caractérise l’analyse des rêves, les actes manqués et les lapsus. Bien au contraire l’inconscient me paraît non seulement extrêmement particularisé, plus encore que varié, d’un sujet à un autre, mais encore très futé et spirituel, puisque c’est justement là que le mot d’esprit a révélé ses véritables dimensions et ses véritables structures. Il n’y a pas un inconscient parce qu’il y aurait un désir inconscient, obtus, lourd, caliban, voire animal, désir inconscient levé des profondeurs, qui serait primitif et aurait à s’élever au niveau supérieur du conscient. Bien au contraire il y a un désir parce qu’il y a de l’inconscient, c’est-à-dire du langage qui échappe au sujet dans sa structure et ses effets, et qu’il y a toujours au niveau du langage quelque chose qui est au-delà de la conscience, et c’est là que peut se situer la fonction du désir.
C’est pourquoi il est nécessaire de faire intervenir ce lieu que j’ai appelé le lieu de l’Autre, concernant tout ce qui est du sujet. C’est en substance le champ où se repèrent ces excès de langage dont le sujet tient une marque qui échappe à sa propre maîtrise. C’est dans ce champ que se fait la jonction avec ce que j’ai appelé le pôle de la jouissance.
Car s’y valorise ce que Freud à propos du principe du plaisir et dont on s’est jamais avisé, à savoir que le plaisir est une barrière à la jouissance, en quoi Freud reprend les conditions dont de très vieilles écoles de pensée avaient fait leur loi. Que nous dit-on du plaisir ? Que c’est la moindre excitation, ce qui fait disparaître la tension, la tempère le plus, donc ce qui nous arrête nécessairement à un point d’éloignement, de distance très respectueuse de la jouissance. Car ce que j’appelle jouissance au sens où le corps s’éprouve, est toujours de l’ordre de la tension, du forçage, de la dépense, voire de l’exploit. Il y a incontestablement jouissance au niveau où commence d’apparaître la douleur, et nous savons que c’est seulement à ce niveau de la douleur que peut s’éprouver toute une dimension de l’organisme qui autrement reste voilée.
Qu’est-ce que le désir ? Le désir est en quelque sorte le point de compromis, l’échelle de la dimension de la jouissance, dans la mesure où d’une certaine façon il permet de porter plus loin le niveau de la barrière du plaisir. Mais c’est là un point fantasmatique, je veux dire où intervient le registre de la dimension imaginaire, qui fait que le désir est suspendu à quelque chose dont il n’est pas de sa nature d’exiger véritablement la réalisation.
Pourquoi est-ce que je viens parler ici de ce qui de toutes façons n’est qu’un échantillonnage minuscule de cette dimension que je développe depuis 15 ans dans mon séminaire ? C’est pour évoquer l’idée d’une topologie du sujet. C’est par rapport à ses surfaces, à ses limites fondamentales, à leurs relations réciproques, à la façon dont elles s’entrecroisent et dont elles se nouent que peuvent se poser des problèmes, qui ne sont pas non plus de purs et simples problèmes d’interpsychologie, mais bien ceux d’une structure concernant le sujet dans son double rapport avec le savoir.
Le savoir continue à rester pour lui marqué d’une valeur nodale, pour ceci dont on oublie le caractère central dans la pensée, c’est que le désir sexuel dans la psychanalyse n’est pas l’image que nous devons nous faire d’après un mythe de la tendance organique : c’est quelque chose d’infiniment plus élevé et noué d’abord précisément au langage, en tant que c’est le langage qui lui fait d’abord sa place, et que sa première apparition dans le développement de l’individu se manifeste au niveau du désir de savoir. Si on ne voit pas que c’est là le point central qui enracine la théorie de la libido de Freud, on perd tout simplement la corde. C’est perdre la corde que de vouloir rejoindre les cadres préformés d’une prétendue psychologie générale, élaborée au cours des siècles pour répondre à des besoins extrêmement divers, mais qui constitue le déchet de la suite des théories philosophiques. C’est perdre la corde aussi que de ne pas voir quelle reperspectivation, quel changement total de point de vue est introduit par la théorie de Freud, car on en perd alors à la fois la pratique et la fécondité.
Tel de mes élèves extérieur au champ de l’analyse m’a bien souvent demandé : « Croyez-vous qu’il suffise d’expliquer cela aux philosophes, qu’il vous suffise de poser sur un tableau le schéma de votre graphe pour qu’ils réagissent et comprennent ? » Je n’avais là-dessus, bien sûr pas la moindre illusion et trop de preuves du contraire. Malgré cela, les idées se promènent et dans la position où nous sommes par rapport à la diffusion du langage et le minimum d’imprimés nécessaires pour qu’une chose dure, cela suffit. Il suffit que cela ait été dit quelque part et qu’une oreille sur 200 l’ait entendu pour que dans un avenir assez proche ses effets soient assurés.
Ce que j’indique en parlant de la position que peut occuper le psychanalyste, c’est qu’actuellement c’est la seule d’où le médecin puisse maintenir l’originalité de toujours de sa position, c’est-à-dire de celui qui a à répondre à une demande de savoir, encore qu’on ne puisse le faire qu’à amener à tourner du côté opposé aux idées qu’il émet pour présenter cette demande. Si l’inconscient est ce qu’il est, non pas une chose monotone, mais au contraire une serrure aussi précise que possible et dont le maniement n’est rien d’autre que d’ouvrir de la façon inverse d’une clé ce qui est au-delà d’un chiffre, cette ouverture ne peut que servir le sujet dans sa demande de savoir. Ce qui est inattendu, c’est que le sujet avoue lui-même sa vérité et qu’il avoue sans le savoir.
L’exercice et la formation de la pensée sont les préliminaires nécessaires à une telle opération : il faut que le médecin soit rompu à poser les problèmes au niveau d’une série de thèmes dont il doit connaître les connections, les nœuds et qui ne sont pas les thèmes courants de la philosophie et de la psychologie. Ceux qui sont en cours dans une certaine pratique investigatrice qui s’appelle psycho-technique, où les réponses sont déterminées en fonction de certaines questions elles-mêmes registrées sur un plan utilitaire, ont leur prix et leur valeur dans des limites définies qui n’ont rien avec le fond de ce qu’il en est dans la demande du malade.
Au bout de cette demande, la fonction du rapport au sujet supposé savoir, révèle ce que nous appelons « transfert ». Dans la mesure où plus que jamais la science a la parole, plus que jamais se supporte ce mythe du sujet supposé savoir, et c’est cela qui permet l’existence du phénomène du transfert en tant qu’il renvoie au plus primitif, au plus enraciné du désir de savoir.
Dans l’âge scientifique, le médecin se trouve dans une double position : d’une part, il a affaire à un investissement énergétique dont il ne soupçonne pas le pouvoir si on ne lui explique pas, d’autre part il doit mettre cet investissement entre parenthèses en raison même des pouvoirs dont il dispose, de ceux qu’il doit distribuer, du plan scientifique où il est situé. Qu’il le veuille ou non, le médecin est intégré à ce mouvement mondial de l’organisation d’une santé qui devient publique et de ce fait, de nouvelles questions lui seront posées.
Il ne saura en aucun cas motiver le maintien de sa fonction proprement médicale au nom d’un « privé », qui serait de ressort de ce qu’on appelle le secret professionnel, et ne parlons pas trop de la façon dont il est observé, je veux dire dans la pratique de la vie à l’heure où on boit le cognac. Mais ce n’est pas cela le ressort du secret professionnel, car si c’était de l’ordre du privé, ce serait de l’ordre des mêmes fluctuations qui socialement ont accompagné la généralisation dans le monde de la pratique de l’impôt sur le revenu. C’est d’autre chose qu’il s’agit ; c’est proprement de cette lecture par laquelle le médecin est capable de conduire le sujet à ce qu’il en est d’une certaine parenthèse, celle qui commence à la naissance, qui finit à la mort et qui comporte les questions que comportent l’une et l’autre.
Au nom de quoi les médecins auront-ils à statuer du droit ou non à la naissance ? Comment répondront-ils aux exigences qui conflueront très rapidement aux exigences de la productivité ? Car si la santé devient l’objet d’une organisation mondiale, il s’agira de savoir dans quelle mesure elle est productive. Que pourra opposer le médecin aux impératifs qui feraient de lui l’employé de cette entreprise universelle de la productivité ? Il n’a d’autre terrain que ce rapport par lequel il est le médecin, à savoir la demande du malade. C’est à l’intérieur de ce rapport ferme où se produisent tant de choses qu’est la révélation de cette dimension dans sa valeur originelle, qui n’a rien d’idéaliste mais qui est exactement ce que j’ai dit le rapport à la jouissance du corps.
Qu’avez-vous à dire, médecins, sur le plus scandaleux de ce qui va suivre ? Car s’il était exceptionnel, le cas où l’homme jusqu’ici proférait : « Si ton œil ta scandalise, arrache-le », que direz-vous du slogan : « Si ton œil se vend bien, donne-le ». Au nom de quoi, aurez-vous à parler, sinon précisément de cette dimension de la jouissance de son corps et de ce qu’elle commande de participation à tout ce qu’il en est dans le monde ?
Si le médecin doit rester quelque chose qui ne saurait être l’héritage de son antique fonction qui était une fonction sacrée, c’est pour moi, à poursuivre et maintenir dans sa vie propre la découverte de Freud. C’est toujours comme missionnaire du médecin que je me suis considéré : la fonction du médecin comme celle du prêtre ne se limite pas au temps qu’on y emploie.
Vous me permettrez, sur certaines questions qui viennent d’être posées, de m’en tenir aux réponses de Mme Aubry qui me semblent très suffisamment pertinentes. Je ne vois pas que démocratiser l’enseignement de la psychanalyse pose d’autre problème que celui de la définition de notre démocratie. C’en est une, mais il y en a plusieurs espèces concevables et l’avenir nous mène vers une autre.
Ce que je croyais avoir à apporter à une réunion comme celle-ci caractérisée par qui la convoque, c’est-à-dire le Collège de médecine, c’était très précisément d’aborder un sujet que je n’ai jamais eu à traiter dans mon enseignement, celui de la place de la psychanalyse dans la médecine.
Actuellement cette place est marginale et comme je l’ai écrit à plusieurs reprises, extra-territoriale. Elle est marginale de fait de la position de la médecine vis-à-vis de la psychanalyse, qui l’admet comme une sorte d’aide extérieure, comparable à celle des psychologues et de différents autres assistants thérapeutiques. Elle est extra-territoriale du fait des psychanalystes qui, sans doute, ont leurs raisons pour vouloir conserver cette extra-territorialité. Ce ne sont pas les miennes, mais à la vérité, je ne pense pas que mon seul vœu là-dessus suffira à changer les choses. Elles trouveront place en leur temps, c’est-à-dire extrêmement vite à considérer la sorte d’accélération que nous vivons quant à la part de la science dans la vie commune.
Cette place de la psychanalyse dans la médecine, je voudrais aujourd’hui la considérer du point de vue du médecin et du très rapide changement qui est en train de se produire dans ce que j’appellerai la fonction du médecin, et dans son personnage puisqu’aussi bien c’est là un élément important de sa fonction.
Pendant toute la période de l’histoire que nous connaissons et pouvons qualifier comme telle, cette fonction, ce personnage du médecin sont restés d’une grande constance jusqu’à une époque récente.
Il faut cependant remarquer que la pratique de la médecine n’est jamais allée sans un grand accompagnement de doctrines. Que pendant un temps assez court, au 19e siècle, les doctrines se soient réclamées de la science, ne les a pas rendues plus scientifiques pour autant. Je veux dire que les doctrines scientifiques invoquées dans la médecine étaient toujours, jusqu’à une époque récente, reprises de quelque acquis scientifique, mais avec un retard de vingt ans au moins. Ceci montre bien que ce recours n’a fonctionné que comme substitut et pour masquer ce qu’antérieurement il faut bien plutôt repérer comme une sorte de philosophie.
À considérer l’histoire du médecin à travers les âges, le grand médecin, le médecin type était un homme de prestige et d’autorité. Ce qui se passe entre le médecin et le malade, facilement illustré maintenant par des remarques comme celle de Balint, que le médecin en prescrivant se prescrit lui-même, s’est toujours passé : ainsi l’empereur Marc-Aurèle convoquait Galien pour qu’il fût versé de ses mains la thériaque. C’est d’ailleurs Galien qui a écrit le traité De historia philosophica, que le médecin, dans son meilleur, est aussi un philosophe, où ce mot ne se limite pas au sens tardif de philosophie de la nature.
Mais donnez à ce mot le sens que vous voudrez, la question qu’il s’agit de situer s’éclairera d’autres repères. Je pense qu’ici, bien que dans une assistance en majorité médicale, on ne me demande pas d’indiquer ce que M. Foucault nous apporte, dans son grand ouvrage, d’une méthode historico-critique pour situer la responsabilité de la médecine dans la grande crise éthique (c’est-à-dire touchant la définition de l’homme) qu’il centre autour de l’isolation de la folie ; non plus que d’introduire cet autre ouvrage Naissance de la clinique en tant qu’y est fixé ce que comporte la promotion par Bichat d’un regard qui se fixe sur le champ du corps dans ce court temps où il subsiste comme rendu à la mort, c’est-à-dire le cadavre.
Les deux franchissements sont ainsi marqués, par quoi la médecine consomme pour sa part la fermeture des portes d’un antique Janus, celui qui redoublait irretrouvablement tout geste humain d’une figure sacrée. La médecine est une corrélation de ce franchissement. Le passage de la médecine sur le plan de la science et même le fait que l’exigence de la condition expérimentale ait été induite dans la médecine par Claude Bernard et ses consorts, ce n’est pas cela qui compte à soi seul, la balance est ailleurs.
La médecine est entrée dans sa phase scientifique, pour autant qu’un monde est né qui désormais exige les conditionnements nécessités dans la vie de chacun à mesure de la part qu’il prend à la science, présente à tous en ses effets.
Les fonctions de l’organisme humain ont toujours fait l’objet d’une mise à l’épreuve selon le contexte social. Mais d’être prises en fonction serve dans les organisations hautement différenciées qui ne seraient pas nées sans la science, elles s’offrent au médecin dans le laboratoire déjà constitué en quelque sorte, voire déjà fourni des crédits sans limites, qu’il va employer à réduire ces fonctions à des montages équivalents à ceux de ces autres organisations, c’est-à-dire ayant statut de subsistance scientifique.
Citons simplement ici, pour éclairer notre lanterne, ce que doit notre progrès dans la formalisation fonctionnelle de l’appareil cardio-vasculaire et de l’appareil respiratoire non seulement à la nécessité de l’opérer, mais à l’appareil même de leur inscription, en tant qu’ils s’imposent à partir du logement des sujets de ces réactions dans des « satellites » ; soit ce qu’on peut considérer comme de formidables poumons d’acier, dont la construction elle-même est liée à leur destination de supports de certaines orbites, orbites qu’on aurait bien tort d’appeler cosmiques, puisque ces orbites, le cosmos ne les « connaissait » pas. Pour tout dire, c’est du même pas dont se révèle la surprenante tolérance de l’homme à des conditions acosmiques, voire le paradoxe qui l’y fait apparaître en quelque sorte « adapté », qu’il s’avère que cet acosmisme est ce que la science construit. Qui pouvait imaginer que l’homme supporterait très bien l’apesanteur, qui pouvait prédire ce qu’il adviendrait de l’homme dans ces conditions à s’en tenir aux métaphores philosophiques, à celle par exemple de Simone Weill que faisait de la pesanteur une des dimensions d’une telle métaphore ?
C’est dans la mesure où les exigences sociales sont conditionnées par l’apparition d’un homme servant les conditions d’un monde scientifique que, nanti de pouvoirs nouveaux d’investigation et de recherche, le médecin se trouve affronté à des problèmes nouveaux. Je veux dire que le médecin n’a plus rien de privilégié dans l’ordre de cette équipe de savants diversement spécialisés dans les différentes branches scientifiques. C’est de l’extérieur de sa fonction, nommément dans l’organisation industrielle, que lui sont fournis les moyens en même temps que les questions pour introduire les mesures de contrôle quantitatif, les graphiques, les échelles, les données statistiques par où s’établissent jusqu’à l’échelle microscopique les constantes biologiques et que s’instaure dans son domaine ce décollement de l’évidence de la réussite, qui est la condition de l’avènement des faits.
La collaboration médicale sera considérée comme la bienvenue pour programmer les opérations nécessaires à maintenir le fonctionnement de tel ou tel appareil de l’organisme humain, dans des conditions déterminées, mais après tout, en quoi cela a-t-il à faire avec ce que nous appelons la position traditionnelle du médecin ?
Le médecin est requis dans la fonction du savant physiologiste mais il subit d’autres appels encore : le monde scientifique déverse entre ses mains le nombre infini de ce qu’il peut produire comme agents thérapeutiques nouveaux chimiques ou biologiques, qu’il met à la disposition du public et il demande au médecin, comme à un agent distributeur, de les mettre à l’épreuve. Où est la limite où le médecin doit agir et à quoi doit-il répondre ? À quelque chose qui s’appelle la demande.
Je dirai que c’est dans la mesure de ce glissement, de cette évolution, qui change la position du médecin au regard de ceux qui s’adressent à lui, que vient à s’individualiser, à se spécifier, à se mettre rétroactivement en valeur, ce qu’il y a d’original dans cette demande au médecin. Ce développement scientifique inaugure et met de plus en plus au premier plan ce nouveau droit de l’homme à la santé, qui existe et se motive déjà dans une organisation mondiale. Dans la mesure où le registre du rapport médicale à la santé se modifie, où cette sorte de pouvoir généralisé qu’est le pouvoir de la science, donne à tous la possibilité de venir demander au médecin son ticket de bienfait dans un but précis immédiat, nous voyons se dessiner l’originalité d’une dimension que j’appelle la demande. C’est dans le registre du mode de réponse à la demande du malade qu’est la chance de survie de la position proprement médicale.
Répondre que le malade vient vous demander la guérison n’est rien répondre du tout, car chaque fois que la tâche précise, qui est à accomplir d’urgence, ne répond pas purement et simplement à une possibilité qui se trouve à la portée de la main, mettons un appareillage chirurgicale ou l’administration d’antibiotiques - et même dans ces cas il reste à savoir ce qui en résulte pour l’avenir. Il y a hors du champ de ce qui est modifié par le bienfait thérapeutique quelque chose qui reste constant et tout médecin sait bien de quoi il s’agit.
Quand le malade est envoyé au médecin ou quand il l’aborde, ne dites pas qu’il en attend purement et simplement la guérison. Il met le médecin à l’épreuve de le sortir de sa condition de malade, ce qui est tout à fait différent, car ceci peut impliquer qu’il est tout à fait attaché à l’idée de la conserver. Il vient parfois nous demander de l’authentifier comme malade, dans bien d’autres cas il vient, de la façon la plus manifeste, vous demander de le préserver dans sa maladie, de le traiter de la façon qui lui convient à lui, celle qui lui permettra de continuer d’être un malade bien installé dans sa maladie. Ai-je besoin d’évoquer mon expérience la plus récente : un formidable état de dépression anxieuse permanente, durant déjà plus de 20 ans, le malade venait me trouver dans la terreur que je fis la moindre chose. À la seule proposition de me revoir 48 heures plus tard, déjà, la mère, redoutable, qui était pendant ce temps campée dans mon salon d’attente avait réussi à prendre des dispositions pour qu’il n’en fût rien.
Ceci est d’expérience banale, je ne l’évoque que pour vous rappeler la signification de la demande, dimension où s’exerce à proprement parler la fonction médicale, et pour introduire ce qui semble facile à toucher et pourtant n’a été sérieusement interrogé que dans mon école, à savoir la structure de la faille qui existe entre la demande et le désir.
Dès qu’on a fait cette remarque, il apparaît qu’il n’est pas nécessaire d’être psychanalyste, ni même médecin, pour savoir que lorsque quiconque, notre meilleur ami, qu’il soit du sexe mâle ou femelle, nous demande quelque chose, ce n’est pas du tout identique et même parfois diamétralement opposé à ce qu’il désire.
Je voudrais reprendre ici les choses à un autre point et faire remarquer que s’il est concevable que nous parvenions à une extension de plus en plus efficace de nos procédés d’intervention concernant le corps humain, sur la base des progrès scientifiques, le problème ne saurait être résolu au niveau de la psychologie du médecin, d’une question qui rafraîchirait le terme de psycho-somatique. Permettez-moi d’épingler plutôt comme faille épistémo-somatique, l’effet que va avoir le progrès de la science sur la relation de la médecine avec le corps.
Là encore la situation est pour la médecine subvertie du dehors. Et c’est pourquoi, ce qui, avant certaines ruptures restait confus, voilé, mêlé, embrouillé, apparaît avec éclat.
Car ce qui est exclu du rapport épistémo-somatique, est justement ce qui va proposer à la médecine le corps dans son registre purifié ; ce qui se présente ainsi se présente en pauvre à la fête où le corps rayonnait tout à l’heure d’être entièrement photographié, radiographié, calibré, diagrammatisé et possible à conditionner, étant donné les ressources vraiment extraordinaires qu’il recèle, mais peut-être aussi ce pauvre lui apporte-t-il une chance qui revient de loin, à savoir de l’exil où a proscrit le corps la dichotomie cartésienne de la pensée et de l’étendue, laquelle laisse complètement choir de sa saisie, ce qu’il en est non pas du corps qu’elle imagine, mais du corps vrai dans sa nature.
Ce corps n’est pas simplement caractérisé par la dimension de l’étendue : un corps est quelque chose qui est fait pour jouir, jouir de soi-même. La dimension de la jouissance est complètement exclue de ce que j’ai appelé le rapport épistémo-somatique. Car le science n’est pas incapable de savoir ce qu’elle peut, mais elle, pas plus que le sujet qu’elle engendre, ne peut avoir ce qu’elle veut. Du moins ce qu’elle veut surgit-il d’une avancée dont la marche accélérée, de nos jours, nous permet de toucher qu’elle dépasse ses propres prévisions.
Pouvons-nous en préjuger, par exemple de ce que notre espace, qu’il soit planétaire ou transplanétaire pullule de quelque chose qu’il faut bien appeler des voix humaines, animant le code qu’elles trouvent en des ondes dont l’entrecroisement nous suggère une toute autre image de l’espace que celle où les tourbillons cartésiens faisaient leur ménage. Pourquoi ne pas parler aussi du regard qui est maintenant omniprésent, sous la forme d’appareils qui voient pour nous aux mêmes lieux : soit quelque chose qui n’est pas un œil et qui isole le regard comme présent. Tout ceci, nous pouvons le mettre à l’actif de la science, mais cela nous fait-il atteindre ce qui là nous concerne, je ne dirai pas comme être humain, car en vérité, Dieu sait ce qu’on agite derrière ce fantoche qu’on appelle l’homme, l’être humain, ou la dignité humaine ou quelle que soit la dénomination sous laquelle chacun met ce qu’il entend de ses propres idéologies plus ou moins révolutionnaires ou réactionnaires…
Nous demanderons plutôt en quoi est-ce que cela concerne ce qui existe, à savoir nos corps ? Des voix, des regards qui se promènent, c’est bien quelque chose qui vient des corps, mais ce sont de curieux prolongements qui, au premier aspect et même au second ou au troisième, n’ont que peu de rapports avec ce que j’appelle la dimension de la jouissance. Il est important de la placer comme pôle opposé, car là aussi la science est en train de déverser certains effets qui ne sont pas sans comporter quelques enjeux. Matérialisons-les sous la forme des divers produits qui vont des tranquillisants jusqu’aux hallucinogènes. Cela complique singulièrement le problème de ce qu’on a jusque là qualifié d’une manière purement policière de toxicomanie. Pour peu qu’un jour nous soyons en possession d’un produit qui nous permette de recueillir des informations sur le monde extérieur, je vois mal comment une contention policière pourrait s’exercer.
Mais quelle sera la position du médecin pour définir ces effets à propos desquels jusqu’ici il a montré une audace nourrie surtout de prétextes, car du point de vue de la jouissance, qu’est-ce qu’un usage ordonné de ce qu’on appelle plus ou moins proprement des toxiques, peut avoir de répréhensible, sauf si le médecin entre franchement dans ce qui est la deuxième dimension caractéristique de sa présence au monde, à savoir la dimension éthique. Ces remarques qui peuvent sembler banales, ont tout de même l’intérêt de démontrer que la dimension éthique est celle qui s’étend dans la direction de la jouissance.
Voilà donc deux repères, premièrement la demande du malade, deuxièmement la jouissance du corps. D’une façon elles confinent sur cette dimension éthique, mais ne les confondons pas trop vite, car ici intervient ce que j’appellerai tout simplement la théorie psychanalytique, qui vient à temps et non pas bien sûr par hasard, au moment de l’entrée en jeu de la science, avec ce léger devancement qui est toujours caractéristique des inventions de Freud. De même que Freud a inventé la théorie du fascisme avant qu’il paraisse, de même, trente ans avant, il a inventé ce qui devait répondre à la subversion de la position du médecin par la montée de la science.
J’ai tout à l’heure suffisamment indiqué la différence qu’il y a entre la demande et le désir. Seule la théorie linguistique peut rendre compte d’une pareille aperception, et elle le peut d’autant plus facilement que c’est Freud qui de la façon la plus vivante et la plus inattaquable en a précisément montré la distance au niveau de l’inconscient. C’est dans la mesure où il est structuré comme un langage qu’il est l’inconscient découvert par Freud. J’ai lu avec étonnement dans un écrit fort bien patronné que l’inconscient était monotone. Je n’invoquerai pas ici mon expérience, je prie simplement qu’on ouvre les trois premières œuvres de Freud, les plus fondamentales et qu’on voie si c’est la monotonie qui caractérise l’analyse des rêves, les actes manqués et les lapsus. Bien au contraire l’inconscient me paraît non seulement extrêmement particularisé, plus encore que varié, d’un sujet à un autre, mais encore très futé et spirituel, puisque c’est justement là que le mot d’esprit a révélé ses véritables dimensions et ses véritables structures. Il n’y a pas un inconscient parce qu’il y aurait un désir inconscient, obtus, lourd, caliban, voire animal, désir inconscient levé des profondeurs, qui serait primitif et aurait à s’élever au niveau supérieur du conscient. Bien au contraire il y a un désir parce qu’il y a de l’inconscient, c’est-à-dire du langage qui échappe au sujet dans sa structure et ses effets, et qu’il y a toujours au niveau du langage quelque chose qui est au-delà de la conscience, et c’est là que peut se situer la fonction du désir.
C’est pourquoi il est nécessaire de faire intervenir ce lieu que j’ai appelé le lieu de l’Autre, concernant tout ce qui est du sujet. C’est en substance le champ où se repèrent ces excès de langage dont le sujet tient une marque qui échappe à sa propre maîtrise. C’est dans ce champ que se fait la jonction avec ce que j’ai appelé le pôle de la jouissance.
Car s’y valorise ce que Freud à propos du principe du plaisir et dont on s’est jamais avisé, à savoir que le plaisir est une barrière à la jouissance, en quoi Freud reprend les conditions dont de très vieilles écoles de pensée avaient fait leur loi. Que nous dit-on du plaisir ? Que c’est la moindre excitation, ce qui fait disparaître la tension, la tempère le plus, donc ce qui nous arrête nécessairement à un point d’éloignement, de distance très respectueuse de la jouissance. Car ce que j’appelle jouissance au sens où le corps s’éprouve, est toujours de l’ordre de la tension, du forçage, de la dépense, voire de l’exploit. Il y a incontestablement jouissance au niveau où commence d’apparaître la douleur, et nous savons que c’est seulement à ce niveau de la douleur que peut s’éprouver toute une dimension de l’organisme qui autrement reste voilée.
Qu’est-ce que le désir ? Le désir est en quelque sorte le point de compromis, l’échelle de la dimension de la jouissance, dans la mesure où d’une certaine façon il permet de porter plus loin le niveau de la barrière du plaisir. Mais c’est là un point fantasmatique, je veux dire où intervient le registre de la dimension imaginaire, qui fait que le désir est suspendu à quelque chose dont il n’est pas de sa nature d’exiger véritablement la réalisation.
Pourquoi est-ce que je viens parler ici de ce qui de toutes façons n’est qu’un échantillonnage minuscule de cette dimension que je développe depuis 15 ans dans mon séminaire ? C’est pour évoquer l’idée d’une topologie du sujet. C’est par rapport à ses surfaces, à ses limites fondamentales, à leurs relations réciproques, à la façon dont elles s’entrecroisent et dont elles se nouent que peuvent se poser des problèmes, qui ne sont pas non plus de purs et simples problèmes d’interpsychologie, mais bien ceux d’une structure concernant le sujet dans son double rapport avec le savoir.
Le savoir continue à rester pour lui marqué d’une valeur nodale, pour ceci dont on oublie le caractère central dans la pensée, c’est que le désir sexuel dans la psychanalyse n’est pas l’image que nous devons nous faire d’après un mythe de la tendance organique : c’est quelque chose d’infiniment plus élevé et noué d’abord précisément au langage, en tant que c’est le langage qui lui fait d’abord sa place, et que sa première apparition dans le développement de l’individu se manifeste au niveau du désir de savoir. Si on ne voit pas que c’est là le point central qui enracine la théorie de la libido de Freud, on perd tout simplement la corde. C’est perdre la corde que de vouloir rejoindre les cadres préformés d’une prétendue psychologie générale, élaborée au cours des siècles pour répondre à des besoins extrêmement divers, mais qui constitue le déchet de la suite des théories philosophiques. C’est perdre la corde aussi que de ne pas voir quelle reperspectivation, quel changement total de point de vue est introduit par la théorie de Freud, car on en perd alors à la fois la pratique et la fécondité.
Tel de mes élèves extérieur au champ de l’analyse m’a bien souvent demandé : « Croyez-vous qu’il suffise d’expliquer cela aux philosophes, qu’il vous suffise de poser sur un tableau le schéma de votre graphe pour qu’ils réagissent et comprennent ? » Je n’avais là-dessus, bien sûr pas la moindre illusion et trop de preuves du contraire. Malgré cela, les idées se promènent et dans la position où nous sommes par rapport à la diffusion du langage et le minimum d’imprimés nécessaires pour qu’une chose dure, cela suffit. Il suffit que cela ait été dit quelque part et qu’une oreille sur 200 l’ait entendu pour que dans un avenir assez proche ses effets soient assurés.
Ce que j’indique en parlant de la position que peut occuper le psychanalyste, c’est qu’actuellement c’est la seule d’où le médecin puisse maintenir l’originalité de toujours de sa position, c’est-à-dire de celui qui a à répondre à une demande de savoir, encore qu’on ne puisse le faire qu’à amener à tourner du côté opposé aux idées qu’il émet pour présenter cette demande. Si l’inconscient est ce qu’il est, non pas une chose monotone, mais au contraire une serrure aussi précise que possible et dont le maniement n’est rien d’autre que d’ouvrir de la façon inverse d’une clé ce qui est au-delà d’un chiffre, cette ouverture ne peut que servir le sujet dans sa demande de savoir. Ce qui est inattendu, c’est que le sujet avoue lui-même sa vérité et qu’il avoue sans le savoir.
L’exercice et la formation de la pensée sont les préliminaires nécessaires à une telle opération : il faut que le médecin soit rompu à poser les problèmes au niveau d’une série de thèmes dont il doit connaître les connections, les nœuds et qui ne sont pas les thèmes courants de la philosophie et de la psychologie. Ceux qui sont en cours dans une certaine pratique investigatrice qui s’appelle psycho-technique, où les réponses sont déterminées en fonction de certaines questions elles-mêmes registrées sur un plan utilitaire, ont leur prix et leur valeur dans des limites définies qui n’ont rien avec le fond de ce qu’il en est dans la demande du malade.
Au bout de cette demande, la fonction du rapport au sujet supposé savoir, révèle ce que nous appelons « transfert ». Dans la mesure où plus que jamais la science a la parole, plus que jamais se supporte ce mythe du sujet supposé savoir, et c’est cela qui permet l’existence du phénomène du transfert en tant qu’il renvoie au plus primitif, au plus enraciné du désir de savoir.
Dans l’âge scientifique, le médecin se trouve dans une double position : d’une part, il a affaire à un investissement énergétique dont il ne soupçonne pas le pouvoir si on ne lui explique pas, d’autre part il doit mettre cet investissement entre parenthèses en raison même des pouvoirs dont il dispose, de ceux qu’il doit distribuer, du plan scientifique où il est situé. Qu’il le veuille ou non, le médecin est intégré à ce mouvement mondial de l’organisation d’une santé qui devient publique et de ce fait, de nouvelles questions lui seront posées.
Il ne saura en aucun cas motiver le maintien de sa fonction proprement médicale au nom d’un « privé », qui serait de ressort de ce qu’on appelle le secret professionnel, et ne parlons pas trop de la façon dont il est observé, je veux dire dans la pratique de la vie à l’heure où on boit le cognac. Mais ce n’est pas cela le ressort du secret professionnel, car si c’était de l’ordre du privé, ce serait de l’ordre des mêmes fluctuations qui socialement ont accompagné la généralisation dans le monde de la pratique de l’impôt sur le revenu. C’est d’autre chose qu’il s’agit ; c’est proprement de cette lecture par laquelle le médecin est capable de conduire le sujet à ce qu’il en est d’une certaine parenthèse, celle qui commence à la naissance, qui finit à la mort et qui comporte les questions que comportent l’une et l’autre.
Au nom de quoi les médecins auront-ils à statuer du droit ou non à la naissance ? Comment répondront-ils aux exigences qui conflueront très rapidement aux exigences de la productivité ? Car si la santé devient l’objet d’une organisation mondiale, il s’agira de savoir dans quelle mesure elle est productive. Que pourra opposer le médecin aux impératifs qui feraient de lui l’employé de cette entreprise universelle de la productivité ? Il n’a d’autre terrain que ce rapport par lequel il est le médecin, à savoir la demande du malade. C’est à l’intérieur de ce rapport ferme où se produisent tant de choses qu’est la révélation de cette dimension dans sa valeur originelle, qui n’a rien d’idéaliste mais qui est exactement ce que j’ai dit le rapport à la jouissance du corps.
Qu’avez-vous à dire, médecins, sur le plus scandaleux de ce qui va suivre ? Car s’il était exceptionnel, le cas où l’homme jusqu’ici proférait : « Si ton œil ta scandalise, arrache-le », que direz-vous du slogan : « Si ton œil se vend bien, donne-le ». Au nom de quoi, aurez-vous à parler, sinon précisément de cette dimension de la jouissance de son corps et de ce qu’elle commande de participation à tout ce qu’il en est dans le monde ?
Si le médecin doit rester quelque chose qui ne saurait être l’héritage de son antique fonction qui était une fonction sacrée, c’est pour moi, à poursuivre et maintenir dans sa vie propre la découverte de Freud. C’est toujours comme missionnaire du médecin que je me suis considéré : la fonction du médecin comme celle du prêtre ne se limite pas au temps qu’on y emploie.