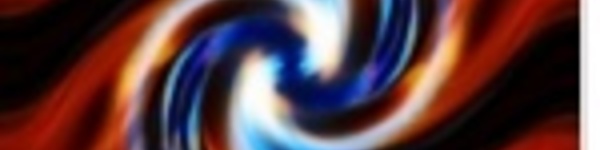Dans la semaine du 1er septembre 2005, le Nouvel Observateur publiait sous le titre " Faut-il en finir avec la psychanalyse ? », un dossier largement consacré à un ouvrage récent, le "Livre noir de la psychanalyse". Juriste et criminologue de formation, actif depuis très longtemps dans le champ de la santé mentale (et notamment dans les domaines de l'usage des drogues et de l'abus sexuel), je suis également collègue d'un des auteurs, Mr. Van Rillaer. La lecture de ce dossier, celle du livre en question et la connaissance de certains écrits de Mr. Van Rillaer (dont son ouvrage de référence, "La Gestion de soi" (1992) et un autre plus récent, « Psychologie de la vie quotidienne » (2003), m'amènent à vous proposer les réflexions suivantes :
1.Le "Livre noir" est présenté par ses auteurs comme le bilan critique de la psychanalyse le plus exhaustif publié en langue française. Ce livre doit "passer en revue les principales facettes de la théorie et de la pratique freudienne" pour mieux les confondre. On s'attend donc à un débat argumenté et sérieux sur les principaux apports de la découverte freudienne dans cet ouvrage écrit à plusieurs mains qui, nous dit-on en guise de publicité, « pèse plus d’un kilo… » . A cet égard, si la publicité de l’ouvrage innove – c’est la première fois que la science se vend au kilo -, la déception est à la hauteur du poids annoncé : comme l'a bien souligné le Monde dans son édition du 9 septembre 2005, l'entreprise cherche plus à disqualifier l'adversaire qu'à en discuter les thèses : recourant aux armes du pamphlet (titres spectaculaires, images assassines et dénonciations ad hominem), il procède encore régulièrement par citations d’auteurs, plus ou moins illustres et plus ou moins anciennes, plutôt que de recourir aux vertus de l'argumentation raisonnée qu’exigerait un débat sur le fond. On pourrait dire que, jusque-là, il n’y a pas de quoi fouetter un chat. Le recours au pamphlet n'est pas illégitime, pour autant qu’il soit clairement assumé comme tel. De même, il n’y a aucune raison à ce que le(s) discour(s) analytique(s) échappe(nt) à la critique. Ce qui est plus dérangeant ici, c'est l'appel régulier à la science et à la rigueur du raisonnement scientifique pour légitimer une démarche qui n’en respecte pas les règles minimales.
L'amalgame des genres flirte avec la malhonnêteté intellectuelle, quand l'invocation de la "science" cherche à légitimer et à faire passer pour vérités des assertions purement hypothétiques ou des accusations hasardeuses sans fondement empirique sérieux. La dérive, bien mise en lumière par L. Muccielli dans un autre champ conflictuel, celui de la déviance, n’est pas nouvelle. Si elle est sans doute encouragée par les lois du marketing contemporain et le souci de « faire un coup » éditorial, elle n'en reste pas moins détestable et dangereuse pour la crédibilité même de la démarche scientifique.
2. Certains reproches faits par les auteurs aux psychanalystes ne valent guère qu'on s'y attarde. On est en dessous de la ceinture quand on ravale en bloc et sans nuances une catégorie entière de cliniciens au rang de profiteurs cupides (P.J. Swales). Tous les analystes ne pratiquent pas la « séance courte » dans le 16e arrondissement à Paris et le propos est injurieux pour nombre d’entre eux qui travaillent dans le secteur de la santé mentale avec des populations largement démunies, atteintes de plein fouet par la férocité du monde social.
L’affirmation ne témoigne pas non plus de cette "rigueur scientifique" que les auteurs dénient à leurs adversaires du jour pour mieux s'en attribuer le monopole. Plus grave par contre est de rendre les psychanalystes globalement responsables d'une « catastrophe humaine » dans le champ de la toxicomanie, parce qu'ils se seraient opposés aux traitements de substitution (J.J. Deglon). Cela témoigne d'abord d'une vue un peu courte du champ :
d’une part, certains psychanalystes se sont très tôt érigés en défenseurs des produits de substitution, même s’ils n’étaient pas majoritaires ; d'autre part, d’autres se sont très largement battus pour imposer une vision déstigmatisante des usagers de drogues et leur faire une place dans la cité ("le toxicomane n'existe pas" de M. Zafiropoulos). A l’époque, Mr. Van Rillaer, dans la Gestion de soi, ne témoignait pas d'une telle lucidité sur la question, présentant sans aucunement l’interroger une image classiquement diabolisante du toxicomane que n'auraient pas désavoués les prohibitionnistes les plus aigus. Par ailleurs, le texte de Mr. Deglon, qui nous vend une image idyllique des produits de substitution commercialisés aux Etats-Unis dès les années 1960 – au nom de ce que ce pays aurait été par la suite épargné par les ravages évoqués ? - , fait complètement l'impasse sur la complexité et les enjeux tant culturels que sociaux de la problématique des usages de drogues. Pour rappel, le débat sur les produits de substitution à la fin du siècle passé fût aussi celui du passage progressif d'un idéal de "guérison" à celui d'"accompagnement" en Santé Mentale, tout comme il traduisait l'émergence progressive de sociétés médicalement ou chimiquement assistées, avec l’aide amicale et qu’on imagine largement désintéressée des lobbys pharmaceutiques. En langue française, on ne saurait trop conseiller aux auteurs de lire, sur ces points, les travaux du sociologue A. Ehrenberg, notamment « L'individu incertain » et « La fatigue d'être soi », qui les amèneraient peut-être à nuancer leur propos.
3. Un autre type de dénonciation, portant sur la scientificité de l’entreprise freudienne, pose la question du potentiel heuristique des deux démarches en présence. Freud manque de rigueur et recourt à des mensonges pour faire "marcher" certaines hypothèses; il prend appui sans le dire sur une tradition antérieure et n'aurait, en fait, rien inventé; la complexité de son langage s'apparenterait à une sorte de rideau de fumée destiné à mieux cacher ses faiblesses conceptuelles... La dénonciation n'est pas très neuve, elle nourrit une bonne partie du livre de Mr. Van Rillaer, Psychologie de la vie quotidienne. Que Freud ait quelque peu arrangé les choses ici et là, je suis incapable d’en juger. Mais, à supposer que ce soit le cas, Freud ne serait pas un cas unique, loin de là. Deux siècles plus tard, cela invalide-t-il l’ensemble de la démarche et de ses résultats? Quant à la difficulté du langage, y échappe-t on dès lors que l’on cherche à construire une théorie à partir de réalités complexes ? Freud a emprunté à d’autres avant lui… La belle affaire ! Quel est le discours scientifique - à supposer que Freud ait prétendu faire « oeuvre scientifique » - qui puisse se passer d'une généalogie ?
Quand une pensée se construit, elle le fait rarement dans le vide et on en trouve presque toujours des traces ailleurs. Où est le problème ? La force d'un Freud – comme celle d’autres grands repères dans l’histoire de la pensée - est d'avoir réussi à donner corps, consistance et cohérence à un corpus d'idées dont il ne fût évidemment pas le seul "inventeur". Sur ces divers plans, le procès vise l’homme plus que la pensée. Il ressemble assez à celui que certains historiens ont fait à Foucault il y a quelques années : lui aussi fût accusé d’avoir pris des libertés avec les rigueurs de la démarche historique, d’avoir « tronqué » la vérité pour donner corps à des intuitions, utilisé un langage ésotérique (qu’il revendiquait d’ailleurs)...
Faut-il en finir avec Foucault pour autant ? L'important est-il le medium ou le message ?
Freud comme Foucault nous laissent-ils, oui ou non, des instruments utiles pour penser la question de l'humain et du social ? A cet égard, la comparaison avec les outils cognitivocomportementalistes présentés par Mr. Van Rillaer dans ses ouvrages est sans appel : la "boite à outil" freudienne est d'une richesse heuristique incomparablement plus grande que les repères d'une "psychologie scientifique" dont les arguments s'apparentent régulièrement à des truismes confondants (en cas de dépression, il vaut mieux avoir une famille, des relations sociales, des activités agréables, ce qui rapproche les dépressifs des "normaux"), à un moralisme de bon aloi (il vaut mieux se marier, le mariage étant globalement positif en termes de "coûts-bénéfices" sur le plan mental), ou encore à un catalogue de stratégies ou de "trucs" adaptatifs dont la normativité n’est jamais interrogée (celui qui abuse d'alcool doit se passer le "film" d'une beuverie qui s'est mal terminée; celui qui est tenté par l'usage de drogues doit "autoverbaliser" et se dire : stop! Attention, du calme..., etc, ). Sans être spécialiste, on a par ailleurs un peu de peine à croire à l’efficacité de ce type de stratégies adaptatives pour des pathologies plus lourdes (psychoses, dépressions, addictions sérieuses,..), dont on sait qu’elles se multiplient aujourd’hui dans un contexte croissant de déreliction du lien social. Compense-t-on alors la relative faiblesse des protocoles adaptatifs par le recours massif aux médicaments ? Probablement et ceci pourrait amener une autre question : quel est le rôle joué, dans cette bataille, par les lobbys pharmaceutiques ?
4. A l'inverse de la psychanalyse, les thérapies cognitivo-comportementales seraient "efficaces" et « scientifiquement fondées ». Dans son interview au Nouvel Observateur comme dans ses deux livres, Mr. Van Rillaer affiche sa confiance dans la rigueur méthodologique de la « psychologie scientifique » dont il fait le gage de l'efficacité thérapeutique. A contrario, il renvoie la psychanalyse du côté des "pseudo-sciences", voire de la philosophie, une discipline que l’auteur ne tient manifestement pas en grande estime, les philosophes étant parfois qualifiés sur d’autres scènes de "Filousophes". Sur l'efficacité, on pourrait discuter des heures, se renvoyer exemples et contre-exemples de "réussite" ou "d'échecs" à l'infini. Mais qu'est ce qu'être "efficace" dans le champ de la santé mentale ? Supprimer un symptôme ? Aider à mieux vivre avec celui-ci ? Qui définit et fixe les seuils d’efficacité ? La science ? Le thérapeute ? Le sujet ? Sont-ils identiques d'un individu à l'autre, d'un type de souffrance à l'autre ? Peut-on seulement les fixer ? On ne sait trop, sinon que l'efficacité est garantie par la scientificité de la démarche : à la différence de la psychanalyse, la psychologie scientifique reposerait sur des protocoles neutres et rigoureux, des hypothèses ou vérités falsifiables que l’on hésiterait pas à jeter à la poubelle si elles sont falsifiées par l’expérience. Introduit par K. Popper, le critère de "falsifiabilité" comme gage de scientificité est largement utilisé en sciences exactes et en sciences sociales. Mais ce critère est-il pertinent dans le champ de la santé mentale ? Quelle est ici la proposition scientifique, explicative ou normative, à n’avoir jamais été falsifiée par un cas particulier ?
La singularité de l'humain n'est-elle pas de mettre radicalement en échec toute tentative d'énonciation de règle à vocation générale le concernant ? Il y a toujours un humain pour faire autrement…L'humain, et c'est bien le problème qu'il pose à sa mise en boîte scientifique, est toujours à côté de la règle. Le problème n’échappe pas toujours à Mr. Van Rillaer qui le résout toutefois d’une manière curieuse : lorsqu’il évoque l’échec possible de propositions thérapeutiques cognitivo-comportementalistes scientifiquement fondées, l’auteur en attribue la responsabilité au sujet. S’il y a échec, c’est que le patient ne suit pas de manière assez assidue le protocole proposé, qu’il est dominé par des « émotions négatives », etc. Bref, si ça ne marche pas, ce n’est pas la science qui a tort, c’est la faute au patient…
5. La question ou le fond du différend sur ce plan est sans doute de savoir s'il est bien raisonnable de vouloir "faire science" avec l’humain. Sur ce plan, le positivisme scientifique dont fait preuve Mr. Van Rillaer ainsi que certains de ses collègues fleure bon la fin du 19e siècle. L'épistémologie des sciences a beau souligner depuis des années le caractère de construction sociale de la science, décrire le jeu des acteurs, des intérêts et des valeurs à l’oeuvre derrière la démarche scientifique (y compris en laboratoire), rien n’y fait : la psychologie scientifique croit toujours dur comme fer à la possibilité d'une science neutre, dégagée de tout rapport social ou de tout investissement subjectif, une science capable d'observer et de dire "ce qui est", d'"objectiver" les faits pour en énoncer la vérité « vraie », fût-elle provisoire. Echappant aux pièges de l’'herméneutique – ce serait sortir de la "psychologie scientifique" pour retomber dans la "psychologie philosophique" - , la psychologie scientifique nous fait revivre le rêve d'une science "pure" détachée des contingences du social, développant ses hypothèses, ses protocoles et ses preuves dans un monde de laboratoire perçu comme univers clos. Cartographiant le réel de l’âme humaine comme la médecine le corps humain, elle renoue par la même occasion avec cette "clinique du regard" dont Foucault faisait crédit à Freud de l’avoir radicalement invalidée. Ce positivisme extrême est déconcertant pour le juriste et le chercheur en sciences sociales que je suis : il y a belle lurette que les juristes ont fait leur deuil d'une "science pure du droit", relégué aux oubliettes le fantasme moderne d'une représentation de leur discipline comme ensemble neutre et rigoureux de règles gouvernées par le seul empire objectif de la Raison scientifique. Le juriste sait, parce que le droit en action ne lui laisse pas le choix, que la vérité d’une règle « scientifiquement construite » est très relative et que sa rationalité est régulièrement reconstruite a posteriori à partir de son application, soit au cas par cas. Quant au chercheur en sciences sociales, il sait que toute démarche scientifique repose sur des présupposés épistémologiques, une construction d'objet et des cadres interprétatifs qui altèrent inéluctablement la neutralité de la démarche comme ils déterminent l’orientation des résultats.
Si cette prise de conscience ne va pas sans poser de nouveaux problèmes - comment penser un "relativisme non relativiste" ? -, il ne permet plus cette croyance dogmatique ou mystique dans le pouvoir mythologique de la science qui, pour des raisons qui m’échappent, ne semble plus subsister que dans le monde de la médecine, de la psychiatrie et de la psychologie scientifique.
6. On tend à faire de l'offensive des TCC un épisode de la "guerre des psy ». C'est sans doute vrai, mais aussi profondément réducteur. On est certainement confronté à deux visions différentes de l'humain. D'un côté, un sujet pris dans le langage, renvoyé à sa liberté et à sa vérité, invité à questionner le sens de son histoire et à interroger sa part de responsabilité dans ce qui lui arrive. Un sujet marqué par le manque et le désir, une part d’incontrôlable qui le rend inapte à être totalement éduqué, contrôlé, normé. De l'autre, une vision de l’individu comme "mammifère social", oscillant entre self-management et self control, dominé par la quête du bien-être, quitte à se maintenir dans l'illusion si la stratégie est payante. Un acteur rationnel, capable de calculs coûts-bénéfices, en mesure de combler ses manques, individu que l’on peut éduquer au bonheur grâce à des protocoles dont les normativités implicites ne sont pas interrogées. Là où la psychanalyse propose une vision de l’homme qui résiste à la planification autoritaire – on sait (et on comprend) qu’elle n’a jamais été aimée par les projets politiques totalitaires -, l’approche cognitivo comportementaliste propose une vision beaucoup plus fonctionnelle et normative. A l’être de désordre revendiqué par la première répond le projet d’ordre et d’adaptation de l’autre.
Ce n’est pas la même chose et on comprend, qu’au-delà d’une opposition de style, l'écart entre ces deux représentations a des répercussions fondamentalement politiques.
7. La politique, les auteurs du « Livre Noir » y font directement référence. Dans la présentation de leur ouvrage, ils éprouvent le besoin de se démarquer fortement de la droite, voire de l'extrême-droite américaine. Serait-ce qu'ils pressentent les liens entre leur discours et un certain nombre de valeurs que, classiquement, on associe à la droite ? C'est probable et j'en propose deux illustrations :
1°) S'il est une valeur « de gauche », c'est bien la question du sens, promue par la psychanalyse, délaissée par les cognitivo-comportementalistes qui lui préfèrent l'idéal d'efficacité ou d’efficience. En cela, le discours cognitivo-comportementaliste est parfaitement en phase avec un projet, symbolisé jusqu’à la caricature par la droite américaine, qui disqualifie la question du sens ou de la légitimité de l’action au nom de la seule "efficacité stratégique" à court terme. La gestion de crise irakienne par l’équipe Bush est emblématique à cet égard. De même, ce désintérêt pour le sens est congruent avec l'évolution de nos sociétés télé-médiatiques, marqués par l'avènement du "prêt à non penser" made in TF1. On connaît le message du patron de TF1 qui n’en fait pas mystère : ne pas faire réfléchir, mais éduquer, adapter et conformer les gens aux normes de la consommation.
Si je prends cet exemple ce n’est pas au hasard : derrière la disqualification du sens, c’est la question de la culture qui est en jeu. Autrement dit, il y a bien un enjeu politique majeur qui sépare psychanalystes et cognitivo-comportementalistes autour de la (dis)qualification de la pensée en tant que valeur, du primat de la culture comme fondement du lien social, de la promotion ou non d’un "sujet réflexif" et critique, dont le sociologue A. Giddens fait la caractéristique de la « deuxième modernité ».
2°) Le néo-libéralisme contemporain impose désormais les figures du managérialisme dans l'ensemble des relations sociales, y compris dans les secteurs a priori non-marchands de l'enseignement ou de la santé. Efficacité et efficience des dispositifs, gestion et autocontrôle, rapidité et visibilité de résultats à court terme, grilles scientifiques d'évaluation et sacralisation des chiffres font désormais partie du langage courant et des instruments de la vie publique. Le langage et les présupposés du cognitivo-comportementalisme sont largement identiques et son idéal d'intervention très fonctionnel pour le projet managérial.
Avec sa croyance aveugle dans les grilles et les procédures techniques du discours scientifique, son idéal d'efficacité à court terme, son souci de conformité aux normes et de revalidation fonctionnelle, la « psychologie scientifique » dessine un cadre qui colle parfaitement aux standards orthopédiques du management contemporain. A cet égard, par contre, la psychanalyse ferait plutôt de la résistance. Sa logique du "cas par cas" et sa conception du sujet de l’inconscient s'opposent assez radicalement au bureaucratisme managérial et à ses rêves de formatage techniciens. Les débats récents ou actuels, tant en France qu'en Belgique, sur la question de l'évaluation en Santé mentale, en témoignent à suffisance. Elle est en outre, depuis Freud, porteuse d'une démarche fondamentalement politique en tant qu'elle interroge les mutations du lien social et leur répercussions sur le malaise dans la civilisation. Cherchant plus qu'auparavant ces dernières années, à interroger les liens entre pathologies sociales et souffrances individuelles, la psychanalyse pose la question des rapports entre clinique et politique. C’est bien une scène de "gauche" où les représentants TCC me paraissent nettement moins présents.
Yves Cartuyvels
Doyen de la Faculté de droit
Facultés universitaires Saint-Louis
43 Bvd. du Jardin Botanique
Bruxelles
02/211 79 62
Email: cartuyvels@fusl.ac.be
1.Le "Livre noir" est présenté par ses auteurs comme le bilan critique de la psychanalyse le plus exhaustif publié en langue française. Ce livre doit "passer en revue les principales facettes de la théorie et de la pratique freudienne" pour mieux les confondre. On s'attend donc à un débat argumenté et sérieux sur les principaux apports de la découverte freudienne dans cet ouvrage écrit à plusieurs mains qui, nous dit-on en guise de publicité, « pèse plus d’un kilo… » . A cet égard, si la publicité de l’ouvrage innove – c’est la première fois que la science se vend au kilo -, la déception est à la hauteur du poids annoncé : comme l'a bien souligné le Monde dans son édition du 9 septembre 2005, l'entreprise cherche plus à disqualifier l'adversaire qu'à en discuter les thèses : recourant aux armes du pamphlet (titres spectaculaires, images assassines et dénonciations ad hominem), il procède encore régulièrement par citations d’auteurs, plus ou moins illustres et plus ou moins anciennes, plutôt que de recourir aux vertus de l'argumentation raisonnée qu’exigerait un débat sur le fond. On pourrait dire que, jusque-là, il n’y a pas de quoi fouetter un chat. Le recours au pamphlet n'est pas illégitime, pour autant qu’il soit clairement assumé comme tel. De même, il n’y a aucune raison à ce que le(s) discour(s) analytique(s) échappe(nt) à la critique. Ce qui est plus dérangeant ici, c'est l'appel régulier à la science et à la rigueur du raisonnement scientifique pour légitimer une démarche qui n’en respecte pas les règles minimales.
L'amalgame des genres flirte avec la malhonnêteté intellectuelle, quand l'invocation de la "science" cherche à légitimer et à faire passer pour vérités des assertions purement hypothétiques ou des accusations hasardeuses sans fondement empirique sérieux. La dérive, bien mise en lumière par L. Muccielli dans un autre champ conflictuel, celui de la déviance, n’est pas nouvelle. Si elle est sans doute encouragée par les lois du marketing contemporain et le souci de « faire un coup » éditorial, elle n'en reste pas moins détestable et dangereuse pour la crédibilité même de la démarche scientifique.
2. Certains reproches faits par les auteurs aux psychanalystes ne valent guère qu'on s'y attarde. On est en dessous de la ceinture quand on ravale en bloc et sans nuances une catégorie entière de cliniciens au rang de profiteurs cupides (P.J. Swales). Tous les analystes ne pratiquent pas la « séance courte » dans le 16e arrondissement à Paris et le propos est injurieux pour nombre d’entre eux qui travaillent dans le secteur de la santé mentale avec des populations largement démunies, atteintes de plein fouet par la férocité du monde social.
L’affirmation ne témoigne pas non plus de cette "rigueur scientifique" que les auteurs dénient à leurs adversaires du jour pour mieux s'en attribuer le monopole. Plus grave par contre est de rendre les psychanalystes globalement responsables d'une « catastrophe humaine » dans le champ de la toxicomanie, parce qu'ils se seraient opposés aux traitements de substitution (J.J. Deglon). Cela témoigne d'abord d'une vue un peu courte du champ :
d’une part, certains psychanalystes se sont très tôt érigés en défenseurs des produits de substitution, même s’ils n’étaient pas majoritaires ; d'autre part, d’autres se sont très largement battus pour imposer une vision déstigmatisante des usagers de drogues et leur faire une place dans la cité ("le toxicomane n'existe pas" de M. Zafiropoulos). A l’époque, Mr. Van Rillaer, dans la Gestion de soi, ne témoignait pas d'une telle lucidité sur la question, présentant sans aucunement l’interroger une image classiquement diabolisante du toxicomane que n'auraient pas désavoués les prohibitionnistes les plus aigus. Par ailleurs, le texte de Mr. Deglon, qui nous vend une image idyllique des produits de substitution commercialisés aux Etats-Unis dès les années 1960 – au nom de ce que ce pays aurait été par la suite épargné par les ravages évoqués ? - , fait complètement l'impasse sur la complexité et les enjeux tant culturels que sociaux de la problématique des usages de drogues. Pour rappel, le débat sur les produits de substitution à la fin du siècle passé fût aussi celui du passage progressif d'un idéal de "guérison" à celui d'"accompagnement" en Santé Mentale, tout comme il traduisait l'émergence progressive de sociétés médicalement ou chimiquement assistées, avec l’aide amicale et qu’on imagine largement désintéressée des lobbys pharmaceutiques. En langue française, on ne saurait trop conseiller aux auteurs de lire, sur ces points, les travaux du sociologue A. Ehrenberg, notamment « L'individu incertain » et « La fatigue d'être soi », qui les amèneraient peut-être à nuancer leur propos.
3. Un autre type de dénonciation, portant sur la scientificité de l’entreprise freudienne, pose la question du potentiel heuristique des deux démarches en présence. Freud manque de rigueur et recourt à des mensonges pour faire "marcher" certaines hypothèses; il prend appui sans le dire sur une tradition antérieure et n'aurait, en fait, rien inventé; la complexité de son langage s'apparenterait à une sorte de rideau de fumée destiné à mieux cacher ses faiblesses conceptuelles... La dénonciation n'est pas très neuve, elle nourrit une bonne partie du livre de Mr. Van Rillaer, Psychologie de la vie quotidienne. Que Freud ait quelque peu arrangé les choses ici et là, je suis incapable d’en juger. Mais, à supposer que ce soit le cas, Freud ne serait pas un cas unique, loin de là. Deux siècles plus tard, cela invalide-t-il l’ensemble de la démarche et de ses résultats? Quant à la difficulté du langage, y échappe-t on dès lors que l’on cherche à construire une théorie à partir de réalités complexes ? Freud a emprunté à d’autres avant lui… La belle affaire ! Quel est le discours scientifique - à supposer que Freud ait prétendu faire « oeuvre scientifique » - qui puisse se passer d'une généalogie ?
Quand une pensée se construit, elle le fait rarement dans le vide et on en trouve presque toujours des traces ailleurs. Où est le problème ? La force d'un Freud – comme celle d’autres grands repères dans l’histoire de la pensée - est d'avoir réussi à donner corps, consistance et cohérence à un corpus d'idées dont il ne fût évidemment pas le seul "inventeur". Sur ces divers plans, le procès vise l’homme plus que la pensée. Il ressemble assez à celui que certains historiens ont fait à Foucault il y a quelques années : lui aussi fût accusé d’avoir pris des libertés avec les rigueurs de la démarche historique, d’avoir « tronqué » la vérité pour donner corps à des intuitions, utilisé un langage ésotérique (qu’il revendiquait d’ailleurs)...
Faut-il en finir avec Foucault pour autant ? L'important est-il le medium ou le message ?
Freud comme Foucault nous laissent-ils, oui ou non, des instruments utiles pour penser la question de l'humain et du social ? A cet égard, la comparaison avec les outils cognitivocomportementalistes présentés par Mr. Van Rillaer dans ses ouvrages est sans appel : la "boite à outil" freudienne est d'une richesse heuristique incomparablement plus grande que les repères d'une "psychologie scientifique" dont les arguments s'apparentent régulièrement à des truismes confondants (en cas de dépression, il vaut mieux avoir une famille, des relations sociales, des activités agréables, ce qui rapproche les dépressifs des "normaux"), à un moralisme de bon aloi (il vaut mieux se marier, le mariage étant globalement positif en termes de "coûts-bénéfices" sur le plan mental), ou encore à un catalogue de stratégies ou de "trucs" adaptatifs dont la normativité n’est jamais interrogée (celui qui abuse d'alcool doit se passer le "film" d'une beuverie qui s'est mal terminée; celui qui est tenté par l'usage de drogues doit "autoverbaliser" et se dire : stop! Attention, du calme..., etc, ). Sans être spécialiste, on a par ailleurs un peu de peine à croire à l’efficacité de ce type de stratégies adaptatives pour des pathologies plus lourdes (psychoses, dépressions, addictions sérieuses,..), dont on sait qu’elles se multiplient aujourd’hui dans un contexte croissant de déreliction du lien social. Compense-t-on alors la relative faiblesse des protocoles adaptatifs par le recours massif aux médicaments ? Probablement et ceci pourrait amener une autre question : quel est le rôle joué, dans cette bataille, par les lobbys pharmaceutiques ?
4. A l'inverse de la psychanalyse, les thérapies cognitivo-comportementales seraient "efficaces" et « scientifiquement fondées ». Dans son interview au Nouvel Observateur comme dans ses deux livres, Mr. Van Rillaer affiche sa confiance dans la rigueur méthodologique de la « psychologie scientifique » dont il fait le gage de l'efficacité thérapeutique. A contrario, il renvoie la psychanalyse du côté des "pseudo-sciences", voire de la philosophie, une discipline que l’auteur ne tient manifestement pas en grande estime, les philosophes étant parfois qualifiés sur d’autres scènes de "Filousophes". Sur l'efficacité, on pourrait discuter des heures, se renvoyer exemples et contre-exemples de "réussite" ou "d'échecs" à l'infini. Mais qu'est ce qu'être "efficace" dans le champ de la santé mentale ? Supprimer un symptôme ? Aider à mieux vivre avec celui-ci ? Qui définit et fixe les seuils d’efficacité ? La science ? Le thérapeute ? Le sujet ? Sont-ils identiques d'un individu à l'autre, d'un type de souffrance à l'autre ? Peut-on seulement les fixer ? On ne sait trop, sinon que l'efficacité est garantie par la scientificité de la démarche : à la différence de la psychanalyse, la psychologie scientifique reposerait sur des protocoles neutres et rigoureux, des hypothèses ou vérités falsifiables que l’on hésiterait pas à jeter à la poubelle si elles sont falsifiées par l’expérience. Introduit par K. Popper, le critère de "falsifiabilité" comme gage de scientificité est largement utilisé en sciences exactes et en sciences sociales. Mais ce critère est-il pertinent dans le champ de la santé mentale ? Quelle est ici la proposition scientifique, explicative ou normative, à n’avoir jamais été falsifiée par un cas particulier ?
La singularité de l'humain n'est-elle pas de mettre radicalement en échec toute tentative d'énonciation de règle à vocation générale le concernant ? Il y a toujours un humain pour faire autrement…L'humain, et c'est bien le problème qu'il pose à sa mise en boîte scientifique, est toujours à côté de la règle. Le problème n’échappe pas toujours à Mr. Van Rillaer qui le résout toutefois d’une manière curieuse : lorsqu’il évoque l’échec possible de propositions thérapeutiques cognitivo-comportementalistes scientifiquement fondées, l’auteur en attribue la responsabilité au sujet. S’il y a échec, c’est que le patient ne suit pas de manière assez assidue le protocole proposé, qu’il est dominé par des « émotions négatives », etc. Bref, si ça ne marche pas, ce n’est pas la science qui a tort, c’est la faute au patient…
5. La question ou le fond du différend sur ce plan est sans doute de savoir s'il est bien raisonnable de vouloir "faire science" avec l’humain. Sur ce plan, le positivisme scientifique dont fait preuve Mr. Van Rillaer ainsi que certains de ses collègues fleure bon la fin du 19e siècle. L'épistémologie des sciences a beau souligner depuis des années le caractère de construction sociale de la science, décrire le jeu des acteurs, des intérêts et des valeurs à l’oeuvre derrière la démarche scientifique (y compris en laboratoire), rien n’y fait : la psychologie scientifique croit toujours dur comme fer à la possibilité d'une science neutre, dégagée de tout rapport social ou de tout investissement subjectif, une science capable d'observer et de dire "ce qui est", d'"objectiver" les faits pour en énoncer la vérité « vraie », fût-elle provisoire. Echappant aux pièges de l’'herméneutique – ce serait sortir de la "psychologie scientifique" pour retomber dans la "psychologie philosophique" - , la psychologie scientifique nous fait revivre le rêve d'une science "pure" détachée des contingences du social, développant ses hypothèses, ses protocoles et ses preuves dans un monde de laboratoire perçu comme univers clos. Cartographiant le réel de l’âme humaine comme la médecine le corps humain, elle renoue par la même occasion avec cette "clinique du regard" dont Foucault faisait crédit à Freud de l’avoir radicalement invalidée. Ce positivisme extrême est déconcertant pour le juriste et le chercheur en sciences sociales que je suis : il y a belle lurette que les juristes ont fait leur deuil d'une "science pure du droit", relégué aux oubliettes le fantasme moderne d'une représentation de leur discipline comme ensemble neutre et rigoureux de règles gouvernées par le seul empire objectif de la Raison scientifique. Le juriste sait, parce que le droit en action ne lui laisse pas le choix, que la vérité d’une règle « scientifiquement construite » est très relative et que sa rationalité est régulièrement reconstruite a posteriori à partir de son application, soit au cas par cas. Quant au chercheur en sciences sociales, il sait que toute démarche scientifique repose sur des présupposés épistémologiques, une construction d'objet et des cadres interprétatifs qui altèrent inéluctablement la neutralité de la démarche comme ils déterminent l’orientation des résultats.
Si cette prise de conscience ne va pas sans poser de nouveaux problèmes - comment penser un "relativisme non relativiste" ? -, il ne permet plus cette croyance dogmatique ou mystique dans le pouvoir mythologique de la science qui, pour des raisons qui m’échappent, ne semble plus subsister que dans le monde de la médecine, de la psychiatrie et de la psychologie scientifique.
6. On tend à faire de l'offensive des TCC un épisode de la "guerre des psy ». C'est sans doute vrai, mais aussi profondément réducteur. On est certainement confronté à deux visions différentes de l'humain. D'un côté, un sujet pris dans le langage, renvoyé à sa liberté et à sa vérité, invité à questionner le sens de son histoire et à interroger sa part de responsabilité dans ce qui lui arrive. Un sujet marqué par le manque et le désir, une part d’incontrôlable qui le rend inapte à être totalement éduqué, contrôlé, normé. De l'autre, une vision de l’individu comme "mammifère social", oscillant entre self-management et self control, dominé par la quête du bien-être, quitte à se maintenir dans l'illusion si la stratégie est payante. Un acteur rationnel, capable de calculs coûts-bénéfices, en mesure de combler ses manques, individu que l’on peut éduquer au bonheur grâce à des protocoles dont les normativités implicites ne sont pas interrogées. Là où la psychanalyse propose une vision de l’homme qui résiste à la planification autoritaire – on sait (et on comprend) qu’elle n’a jamais été aimée par les projets politiques totalitaires -, l’approche cognitivo comportementaliste propose une vision beaucoup plus fonctionnelle et normative. A l’être de désordre revendiqué par la première répond le projet d’ordre et d’adaptation de l’autre.
Ce n’est pas la même chose et on comprend, qu’au-delà d’une opposition de style, l'écart entre ces deux représentations a des répercussions fondamentalement politiques.
7. La politique, les auteurs du « Livre Noir » y font directement référence. Dans la présentation de leur ouvrage, ils éprouvent le besoin de se démarquer fortement de la droite, voire de l'extrême-droite américaine. Serait-ce qu'ils pressentent les liens entre leur discours et un certain nombre de valeurs que, classiquement, on associe à la droite ? C'est probable et j'en propose deux illustrations :
1°) S'il est une valeur « de gauche », c'est bien la question du sens, promue par la psychanalyse, délaissée par les cognitivo-comportementalistes qui lui préfèrent l'idéal d'efficacité ou d’efficience. En cela, le discours cognitivo-comportementaliste est parfaitement en phase avec un projet, symbolisé jusqu’à la caricature par la droite américaine, qui disqualifie la question du sens ou de la légitimité de l’action au nom de la seule "efficacité stratégique" à court terme. La gestion de crise irakienne par l’équipe Bush est emblématique à cet égard. De même, ce désintérêt pour le sens est congruent avec l'évolution de nos sociétés télé-médiatiques, marqués par l'avènement du "prêt à non penser" made in TF1. On connaît le message du patron de TF1 qui n’en fait pas mystère : ne pas faire réfléchir, mais éduquer, adapter et conformer les gens aux normes de la consommation.
Si je prends cet exemple ce n’est pas au hasard : derrière la disqualification du sens, c’est la question de la culture qui est en jeu. Autrement dit, il y a bien un enjeu politique majeur qui sépare psychanalystes et cognitivo-comportementalistes autour de la (dis)qualification de la pensée en tant que valeur, du primat de la culture comme fondement du lien social, de la promotion ou non d’un "sujet réflexif" et critique, dont le sociologue A. Giddens fait la caractéristique de la « deuxième modernité ».
2°) Le néo-libéralisme contemporain impose désormais les figures du managérialisme dans l'ensemble des relations sociales, y compris dans les secteurs a priori non-marchands de l'enseignement ou de la santé. Efficacité et efficience des dispositifs, gestion et autocontrôle, rapidité et visibilité de résultats à court terme, grilles scientifiques d'évaluation et sacralisation des chiffres font désormais partie du langage courant et des instruments de la vie publique. Le langage et les présupposés du cognitivo-comportementalisme sont largement identiques et son idéal d'intervention très fonctionnel pour le projet managérial.
Avec sa croyance aveugle dans les grilles et les procédures techniques du discours scientifique, son idéal d'efficacité à court terme, son souci de conformité aux normes et de revalidation fonctionnelle, la « psychologie scientifique » dessine un cadre qui colle parfaitement aux standards orthopédiques du management contemporain. A cet égard, par contre, la psychanalyse ferait plutôt de la résistance. Sa logique du "cas par cas" et sa conception du sujet de l’inconscient s'opposent assez radicalement au bureaucratisme managérial et à ses rêves de formatage techniciens. Les débats récents ou actuels, tant en France qu'en Belgique, sur la question de l'évaluation en Santé mentale, en témoignent à suffisance. Elle est en outre, depuis Freud, porteuse d'une démarche fondamentalement politique en tant qu'elle interroge les mutations du lien social et leur répercussions sur le malaise dans la civilisation. Cherchant plus qu'auparavant ces dernières années, à interroger les liens entre pathologies sociales et souffrances individuelles, la psychanalyse pose la question des rapports entre clinique et politique. C’est bien une scène de "gauche" où les représentants TCC me paraissent nettement moins présents.
Yves Cartuyvels
Doyen de la Faculté de droit
Facultés universitaires Saint-Louis
43 Bvd. du Jardin Botanique
Bruxelles
02/211 79 62
Email: cartuyvels@fusl.ac.be