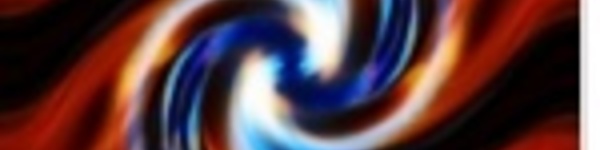En vingt ans, la fonction des psychologues exerçant en médecine gériatrique s’est transformée en activité psychométrique, souvent « prescrite » au détriment d’une approche clinique subjective à l’écoute des éprouvés. Cette politique, à caractère idéologique, touche les milieux de santé et risque d’instrumentaliser la profession si elle ne se donne pas les moyens d’infléchir cette tendance, désastreuse pour tout le monde.
Sous l’impulsion des nouvelles technologies appliquées au domaine des sciences médicales, on assiste à un bouleversement des valeurs qui concernent non seulement la vie somatique, mais aussi la vie psychique et par conséquent l’approche de la personne malade.
On considère désormais que la pensée relève de fonctions cérébrales et que toute perturbation, intellectuelle ou comportementale, serait due à une lésion du cerveau. L’objectif prioritaire n’est donc plus de comprendre la dynamique qui s’établit entre un trouble et une souffrance psychique, mais d’évaluer les dysfonctions et les symptômes pathologiques!
L’approche clinique, considérée comme moins utile que les techniques d’évaluation, est «ordonnancée» sur ce principe, basé sur des critères «objectifs» !
Le domaine gérontologique est exemplaire de ce revirement des fondamentaux qui conduit à placer l’activité des psychologues, bon gré, mal gré, sous responsabilité médicale. La fonction des psychologues se réduisant désormais, pour l’essentiel, à rendre compte des déficits afin de « contribuer » aux diagnostics et aux traitements médicaux, à l’aide de rééducations ou de stimulations cognitive!
Le bénéfice que les personnes malades en retirent n’est pourtant pas si évident. D’une part, les échanges médecins-psychologues ont lieu dans un seul sens et au détriment d’une approche globale du patient. D’autre part, à qui les malades et leurs familles pourront-ils s’adresser quand ils expriment le besoin d’être entendu par rapport à un vécu dont le sens profond leurs échappent,?
L’absence de la dimension psychique et symbolique liée à la maladie contribue à isoler la personne de ses propres affects. La souffrance et les changements de comportements ne trouvent alors plus sens que dans les symptômes et les troubles pathologiques.
L’absence d’une approche clinique « intersubjective », sur laquelle est portée un lourd discrédit, est donc une question cruciale !
« Des psychologues en gériatrie ! Pourquoi faire ? (Sic) »
Le concept de maladie d’Alzheimer occupe désormais toute la problématique du vieillissement. Les notions de syndromes, ou de démences séniles, qui suggéraient l’implication d’une souffrance psychique, disparaissent. On ne voit donc plus ce que la psychologie peut en « dire » ou ce qu’elle vient « faire» dans ce domaine… sinon des tests !
Par rapport aux diagnostic et aux traitements médicaux, l’approche clinique, apparaît donc injustifiée, voire même gênant la prise en charge rationnelle du malade pour certains.
Dans son éditorial de la "Revue de gériatrie" J.M VETEL (T.23, N°6, juin 1998) invite tout simplement ses collègues à ré-organiser les pratiques des psychologues, conformément à une démarche bio-logique sensée dicter les priorités et la manière de travailler.
Il en résume les enjeux actuels en réclamant de bons « collaborateurs » ! Ainsi les « psychomotriciens et les neuropsychologues» sont jugés «efficaces et utiles» par rapport aux « psychologues cliniciens » qui ne s’inscrivent pas dans la même logique et à ce titre, se comporteraient comme des «électrons libres » qu’il faut : «ordonnancer» !
Un tel « contrôle » devrait même s’étendre aux psychothérapies qui, de ce point de vue, relèvent de la médecine.
On voit bien que, posés en termes de pouvoir, ces propos réduisent la psychologie à ses méthodes « objectives » et ignorent délibérément les liens existants entre la vie psychique et somatique. Ce discours somato-normé est de plus en plus partagé dans les milieux de santé. On l’observe non seulement en gériatrie mais également en pédiatrie et en psychiatrie, où le prima de l’organique et du fonctionnel sur les processus psychiques, réduit l’affectif à un épiphénomène!
Les questions relatives à la douleur, dissociée des affects, rendent compte de cette écoute « somatique » :
«Elle se plaint pour rien. Elle n’a pas de raison d’avoir mal ! Ce n’est pas une vraie douleur!» Le mal, la souffrance, doivent être visualisés, situés au niveau du corps, pour être crédible, pour exister. Ce qui permet de les réduire… chimiquement !
Le patient, qui est dans l’attente d’être soulagé, perd le contact avec son propre mal, avec ce qu’il vit, et même sa manière de réagir lui est étrangère …
Dans cet ordre à penser, l’angoisse qui étouffe ou donne des palpitations [ijusqu’à la nausée]i, ne peut résulter que de troubles fonctionnels. Si la psyché, traumatisée par des pertes existentielles, ne s’y retrouve plus, la désorientation, l’agitation, évoquent la maladie d’Alzheimer…
Plus le discours se recentre sur la composante organique, plus l’écoute des éprouvés disparaît, et plus l’hypothèse de la maladie semble confirmée, au point qu’il suffit parfois de simples plaintes mnésiques pour avancer le diagnostic....
La hiérarchisation des tâches, les conduites à tenir et le rôle de chacun, en sont désormais tributaires et les psychologues sont invités à s’y conformer en se débarrassant des vieilles lunes de la psychanalyse, afin de « collaborer » aux évaluations et réaliser les « soutiens » prescrits.
Bon gré, mal gré, la profession est revisitée dans ce sens uniquement, à travers une succession de dispositions plus ou moins légales.
Comment ordonnancer les psychologues?
La question de la responsabilité et de la hiérarchie est une constante, souvent posée par les administrations en réponse aux sollicitations médicales désirant confirmer le rôle d’évaluateur et de ré éducateur attribué aux psychologues :
A l’échelon national, le très officiel « programme d’actions destine aux personnes souffrant de maladie d’alzheimer et maladies apparentees » (Oct. 2001) recommande de recruter :
i[- «de préférence des neuropsychologues [afin de…] pratiquer des tests et des rééducations sur demandes médicales » ! ]iAu plan local, un projet institutionnel préconise :
«l’augmentation des moyens de rééducation (masseur-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, neuropsychologues et… psychologues)» !
Certains milieux universitaires contribuent, à leur manière, au formatage de la profession, dispersée dans des options spécialisantes qui l’invitent à se fondre dans le tronc commun de la santé. On en arrive à privilégier un enseignement médical, plutôt que de faire appel à l’expérience clinique de psychologues de terrain !
Or, adapter nos méthodes aux besoins d’autres professions a des conséquences dramatiques sur l’activité clinique. Elle nous prive, en effet, de la possibilité d’être acteur à part entière dans la conduite des entretiens et des projets de traitements. N’est-ce pas se tromper d’objectifs et confondre le fait d’être utile aux milieux de soins et celui d’être utile envers les personnes en souffrance ? Faut-il sacrifier la clinique pour répondre aux demandes des milieux de santé et afin que les étudiants aient un travail ? Certaines universités se sont déjà orientées vers des formations de psychotechniciens ! La question est de savoir pour quoi faire ?
Est-ce toujours une formation de psychologue ? Et alors qu’est-ce qu’un psychologue ? A quoi sert-il dans un domaine où le psychisme est une fonction ?
On en mesure la portée dans les « mal-entendus » qui entourent notre activité, y compris d’ordre psychothérapeutique :
i[«Vraiment c’est formidable ! [s’exclame une patiente, hospitalisée pour des angoisses irréductibles, après un mois de soutien] J’avais essayé tous les anxiolytiques sans succès et maintenant ça va beaucoup mieux…
Enfin, on a trouvé la bonne molécule…]iIl semble, en effet, inconcevable, dans le contexte actuel, que le psychisme soit actif, travaille, élabore des pensées, sans une aide médicamenteuse !
Des enjeux avant tout d’ordre éthique.
Instrumentaliser ainsi la psychologie, représente donc un enjeu qui dépasse des considérations d’ordre professionnel.
Mais de quelle profession parlons nous ?
La logique, qui conduit à oublier l’angoisse de vieillir derrière des symptômes mesurés par des techniques d’investigation (images cérébrales ou tests), constitue selon J.MAISONDIEU un :
i[ - «... interdit à penser autrement qu’en terme biologique [et ainsi] le projet thérapeutique ne peut être que de faire disparaître ces lésions ou faire cesser ces dysfonctions »… ]i
Que devient une fonction du psychologue sans la capacité d’écouter les éprouvés qui se situent au delà des symptômes, des plaintes corporelles, et ainsi rendre compte d’une problématique psychodynamique en vue d’un projet thérapeutique ?
En gériatrie, prisonnière de la médiatisation tout azimut sur la maladie d’Alzheimer, il devient impossible d’envisager les comportements agités, anxieux ou plaintifs, autrement qu’en termes pathologiques !
Ainsi, les personnes âgées perturbées (elles disent déboussolées) par la perte du conjoint ou la perte de leur autonomie, éprouvent des angoisses au point de perdre la notion du temps, d’oublier, de «perdre la tête» ! Or, elles sont généralement perçues comme des malades, quelque soit la souffrance psychique qui est particulièrement active dans ces circonstances !
Bien des plaintes, ou un comportement de dépendance exprimant un désarroi et un vide affectif, sont réduites à des symptômes neurologique et parfois psychiatrique!
Le besoin d’un étayage affectif et le sentiment d’abandon ne trouvent sens qu’au travers des « troubles du comportement » qu’ils occasionnent :
Chaque jour, des personnes comme Me T. sont hospitalisées après une chute et une fracture. Désorientées, confuses (perdues dans leurs pensées), elles se révoltent contre une réalité insupportable, qu’elles se refusent à admettre, comme elles refusent de s’alimenter ou d’être soignées.
Comment donner sens à la perte de repères et au sentiment « affolant » de tout perdre, dans les milieux de soins désensibilisés à la dimension psychique ?
Appréhender les comportements signifiants : « je n’en peux plus ! Je voudrais tout oublier ! Je ne sais plus où j’en suis ! Qu’est-ce que je vais devenir ? » uniquement sous l’angle de symptômes pathologiques, ne rend pas compte du bouleversement psychique, de la crise qui a lieu autour des 80 ans et de ses conséquences !
Pourtant, cette tendance s’accroît, bien que de nombreux cliniciens le constatent, comme ce médecin âgé et désabusé par cette évolution :
- « On ne sait plus écouter un malade. On lit les résultats d’examen. On interprète des chiffres, des tracés sans âme, sans chaleur humaine ».
L’approche technologique de l’humain s’inscrit dans un contexte social volontier amnésique du côté psychoaffectif. Il semble donner l’illusion de la maîtrise et de la toute puissance, par rapport à une situation sur laquelle il est difficile d’avoir prise et que l’on préfèrerait oublier ou cacher sous des pommades « anti-rides » !
Fuite en avant qui fait parfois dire :
- «La meilleure des vies à mon âge, c’est de tout oublier! »
ou
- « Le plus effroyable, est de se rappeler ce que l’on était ! Je préférerais avoir le cerveau à plat !». Il s’avère néanmoins quasiment impossible de mener à bien des études confirmant (ou non) ces hypothèses cliniques, et donc de mettre en place des psychothérapies visant à soutenir le travail psychique qui s’opère dans la douleur et des angoisses conduisant fréquemment à l’oubli d’un présent intolérable !
Comment rester passif face à une mutation de notre activité qui tend à « délier » la pensée de sa dimension psycho-affective, de l’inconscient et de la symbolique?
La dé-afférentation du lien psychique !
Nous assistons à la normalisation des professions exerçant dans le domaine de la santé autour de concepts organiques auxquels la psychologie devrait se ranger.
Elle modifie la manière de concevoir et d’aborder la maladie, comme la manière d’appréhender, d’écouter et de soigner la personne malade.
Quand le rapport existant entre la maladie et ce qui a été vécu, ce qui est éprouvé sur le plan affectif, est perdu de vue, la souffrance est clivée, dé-afférentée (pour reprendre un terme d’anesthésiologie) de son substrat psychique.
Certains milieux de la psychologie, sans doute fascinés par les neurosciences et leurs promesses, en négligent ce renversement des valeurs. Si la psychologie suivait la voie neuro-logique la privant de la dimension psychoaffective, elle y perdrait sa « substantifique moelle ». La psychologie qui s’est construite sur deux rapports à la réalité, objectif et subjectif, se trouverait hémiplégique du côté symbolique, selon l’expression de F.DOLTO.
La capacité à remplir une fonction de psychologue sur la base d’une approche globale et le caractère généraliste d’une activité visant à écouter, analyser les différents aspects d’une situation en vue d’un projet thérapeutique, sont donc en question. Et celle-ci se pose en terme de responsabilité !
Que pourrons nous répondre aux professionnels de santé, comme aux malades et aux familles en quête de sens par rapport à la souffrance, aux angoisses et aux comportements auxquels ils sont confrontés et dont ils perçoivent la nature psychique ?
De nombreux témoignages évoquent « l’ordonnancement » d’une fonction morcelée dans une multitudes d’activités et un rôle d’exécutant, comme le prouvent les nouvelles définitions du Répertoire Opérationnel des Métiers...
Par quel moyen pouvons nous endiguer cette évolution aux enjeux considérables?
L’échec de la Fédération laisse un goût amer. Elle a pourtant fait apparaître la nécessité de se doter d’une instance légale et officielle, capable de nous représenter!
L’organisation collégiale et associative en réseaux peut palier au plus urgent, mais restera d’une portée limitée.
Les enjeux sont tels qu’ils devraient nous inciter à repenser notre fonction, nos responsabilités par rapport au « cadre » dans lequel nous souhaitons travailler, quitte à recourir à une instance de type ordinal !
Avons nous le choix ? Ce qui se passe dans le secteur gériatrique illustre la situation à laquelle l’ensemble de la profession est, ou sera confrontée.
Les plus motivés d’entre nous s’épuisent dans des démarches, souvent sans espoir, faute d’un appuis, d’un cadre juridique (voir : «Les psychologues, un statut juridique à la croisée des chemins » Yann DURMARQUE. Ed. TEC&TOC, 2001).
Toutefois, malgré l’urgence, malgré l’accumulation de situations (parfois terribles quand elles relèvent du harcèlement par exemple) la crainte d’entrer dans une organisation professionnelle semble la plus forte ! C’est une crainte qui renvoie à « l’ordre », aux limites qui nous seraient imposées !
Il n’est toutefois pas interdit d’en inventer, d’en concevoir la dynamique et d’en faire un outil démocratique, apte à faire respecter notre code de déontologie comme les textes en vigueur et ainsi pouvoir nous entretenir avec les pouvoirs publics. Il est assez paradoxale que la psychologie, et en particulier sa branche clinique se réclamant de la «loi» dans le cadre de son activité, en fasse tout à coup abstraction dans son mode de fonctionnement!
Ha ! Pouvoir ! Vieux démon ! Pourtant il existe, mais comment l’employer, le domestiquer, afin de pouvoir tout simplement exercer dans des conditions normales : répondre aux demandes d’ordre psychologique ?
Bruno CADEC. Psychologue. Dr en Psychologie Clinique. Président de l’Association des Psychologue de Gérontologie (Apsygé) en Isère.
Couriel : BCadec@chu-grenoble.fr
Publié dans le Journal des psychologues, N° 256 d'avril 2008
Sous l’impulsion des nouvelles technologies appliquées au domaine des sciences médicales, on assiste à un bouleversement des valeurs qui concernent non seulement la vie somatique, mais aussi la vie psychique et par conséquent l’approche de la personne malade.
On considère désormais que la pensée relève de fonctions cérébrales et que toute perturbation, intellectuelle ou comportementale, serait due à une lésion du cerveau. L’objectif prioritaire n’est donc plus de comprendre la dynamique qui s’établit entre un trouble et une souffrance psychique, mais d’évaluer les dysfonctions et les symptômes pathologiques!
L’approche clinique, considérée comme moins utile que les techniques d’évaluation, est «ordonnancée» sur ce principe, basé sur des critères «objectifs» !
Le domaine gérontologique est exemplaire de ce revirement des fondamentaux qui conduit à placer l’activité des psychologues, bon gré, mal gré, sous responsabilité médicale. La fonction des psychologues se réduisant désormais, pour l’essentiel, à rendre compte des déficits afin de « contribuer » aux diagnostics et aux traitements médicaux, à l’aide de rééducations ou de stimulations cognitive!
Le bénéfice que les personnes malades en retirent n’est pourtant pas si évident. D’une part, les échanges médecins-psychologues ont lieu dans un seul sens et au détriment d’une approche globale du patient. D’autre part, à qui les malades et leurs familles pourront-ils s’adresser quand ils expriment le besoin d’être entendu par rapport à un vécu dont le sens profond leurs échappent,?
L’absence de la dimension psychique et symbolique liée à la maladie contribue à isoler la personne de ses propres affects. La souffrance et les changements de comportements ne trouvent alors plus sens que dans les symptômes et les troubles pathologiques.
L’absence d’une approche clinique « intersubjective », sur laquelle est portée un lourd discrédit, est donc une question cruciale !
« Des psychologues en gériatrie ! Pourquoi faire ? (Sic) »
Le concept de maladie d’Alzheimer occupe désormais toute la problématique du vieillissement. Les notions de syndromes, ou de démences séniles, qui suggéraient l’implication d’une souffrance psychique, disparaissent. On ne voit donc plus ce que la psychologie peut en « dire » ou ce qu’elle vient « faire» dans ce domaine… sinon des tests !
Par rapport aux diagnostic et aux traitements médicaux, l’approche clinique, apparaît donc injustifiée, voire même gênant la prise en charge rationnelle du malade pour certains.
Dans son éditorial de la "Revue de gériatrie" J.M VETEL (T.23, N°6, juin 1998) invite tout simplement ses collègues à ré-organiser les pratiques des psychologues, conformément à une démarche bio-logique sensée dicter les priorités et la manière de travailler.
Il en résume les enjeux actuels en réclamant de bons « collaborateurs » ! Ainsi les « psychomotriciens et les neuropsychologues» sont jugés «efficaces et utiles» par rapport aux « psychologues cliniciens » qui ne s’inscrivent pas dans la même logique et à ce titre, se comporteraient comme des «électrons libres » qu’il faut : «ordonnancer» !
Un tel « contrôle » devrait même s’étendre aux psychothérapies qui, de ce point de vue, relèvent de la médecine.
On voit bien que, posés en termes de pouvoir, ces propos réduisent la psychologie à ses méthodes « objectives » et ignorent délibérément les liens existants entre la vie psychique et somatique. Ce discours somato-normé est de plus en plus partagé dans les milieux de santé. On l’observe non seulement en gériatrie mais également en pédiatrie et en psychiatrie, où le prima de l’organique et du fonctionnel sur les processus psychiques, réduit l’affectif à un épiphénomène!
Les questions relatives à la douleur, dissociée des affects, rendent compte de cette écoute « somatique » :
«Elle se plaint pour rien. Elle n’a pas de raison d’avoir mal ! Ce n’est pas une vraie douleur!» Le mal, la souffrance, doivent être visualisés, situés au niveau du corps, pour être crédible, pour exister. Ce qui permet de les réduire… chimiquement !
Le patient, qui est dans l’attente d’être soulagé, perd le contact avec son propre mal, avec ce qu’il vit, et même sa manière de réagir lui est étrangère …
Dans cet ordre à penser, l’angoisse qui étouffe ou donne des palpitations [ijusqu’à la nausée]i, ne peut résulter que de troubles fonctionnels. Si la psyché, traumatisée par des pertes existentielles, ne s’y retrouve plus, la désorientation, l’agitation, évoquent la maladie d’Alzheimer…
Plus le discours se recentre sur la composante organique, plus l’écoute des éprouvés disparaît, et plus l’hypothèse de la maladie semble confirmée, au point qu’il suffit parfois de simples plaintes mnésiques pour avancer le diagnostic....
La hiérarchisation des tâches, les conduites à tenir et le rôle de chacun, en sont désormais tributaires et les psychologues sont invités à s’y conformer en se débarrassant des vieilles lunes de la psychanalyse, afin de « collaborer » aux évaluations et réaliser les « soutiens » prescrits.
Bon gré, mal gré, la profession est revisitée dans ce sens uniquement, à travers une succession de dispositions plus ou moins légales.
Comment ordonnancer les psychologues?
La question de la responsabilité et de la hiérarchie est une constante, souvent posée par les administrations en réponse aux sollicitations médicales désirant confirmer le rôle d’évaluateur et de ré éducateur attribué aux psychologues :
A l’échelon national, le très officiel « programme d’actions destine aux personnes souffrant de maladie d’alzheimer et maladies apparentees » (Oct. 2001) recommande de recruter :
i[- «de préférence des neuropsychologues [afin de…] pratiquer des tests et des rééducations sur demandes médicales » ! ]iAu plan local, un projet institutionnel préconise :
«l’augmentation des moyens de rééducation (masseur-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, neuropsychologues et… psychologues)» !
Certains milieux universitaires contribuent, à leur manière, au formatage de la profession, dispersée dans des options spécialisantes qui l’invitent à se fondre dans le tronc commun de la santé. On en arrive à privilégier un enseignement médical, plutôt que de faire appel à l’expérience clinique de psychologues de terrain !
Or, adapter nos méthodes aux besoins d’autres professions a des conséquences dramatiques sur l’activité clinique. Elle nous prive, en effet, de la possibilité d’être acteur à part entière dans la conduite des entretiens et des projets de traitements. N’est-ce pas se tromper d’objectifs et confondre le fait d’être utile aux milieux de soins et celui d’être utile envers les personnes en souffrance ? Faut-il sacrifier la clinique pour répondre aux demandes des milieux de santé et afin que les étudiants aient un travail ? Certaines universités se sont déjà orientées vers des formations de psychotechniciens ! La question est de savoir pour quoi faire ?
Est-ce toujours une formation de psychologue ? Et alors qu’est-ce qu’un psychologue ? A quoi sert-il dans un domaine où le psychisme est une fonction ?
On en mesure la portée dans les « mal-entendus » qui entourent notre activité, y compris d’ordre psychothérapeutique :
i[«Vraiment c’est formidable ! [s’exclame une patiente, hospitalisée pour des angoisses irréductibles, après un mois de soutien] J’avais essayé tous les anxiolytiques sans succès et maintenant ça va beaucoup mieux…
Enfin, on a trouvé la bonne molécule…]iIl semble, en effet, inconcevable, dans le contexte actuel, que le psychisme soit actif, travaille, élabore des pensées, sans une aide médicamenteuse !
Des enjeux avant tout d’ordre éthique.
Instrumentaliser ainsi la psychologie, représente donc un enjeu qui dépasse des considérations d’ordre professionnel.
Mais de quelle profession parlons nous ?
La logique, qui conduit à oublier l’angoisse de vieillir derrière des symptômes mesurés par des techniques d’investigation (images cérébrales ou tests), constitue selon J.MAISONDIEU un :
i[ - «... interdit à penser autrement qu’en terme biologique [et ainsi] le projet thérapeutique ne peut être que de faire disparaître ces lésions ou faire cesser ces dysfonctions »… ]i
Que devient une fonction du psychologue sans la capacité d’écouter les éprouvés qui se situent au delà des symptômes, des plaintes corporelles, et ainsi rendre compte d’une problématique psychodynamique en vue d’un projet thérapeutique ?
En gériatrie, prisonnière de la médiatisation tout azimut sur la maladie d’Alzheimer, il devient impossible d’envisager les comportements agités, anxieux ou plaintifs, autrement qu’en termes pathologiques !
Ainsi, les personnes âgées perturbées (elles disent déboussolées) par la perte du conjoint ou la perte de leur autonomie, éprouvent des angoisses au point de perdre la notion du temps, d’oublier, de «perdre la tête» ! Or, elles sont généralement perçues comme des malades, quelque soit la souffrance psychique qui est particulièrement active dans ces circonstances !
Bien des plaintes, ou un comportement de dépendance exprimant un désarroi et un vide affectif, sont réduites à des symptômes neurologique et parfois psychiatrique!
Le besoin d’un étayage affectif et le sentiment d’abandon ne trouvent sens qu’au travers des « troubles du comportement » qu’ils occasionnent :
Chaque jour, des personnes comme Me T. sont hospitalisées après une chute et une fracture. Désorientées, confuses (perdues dans leurs pensées), elles se révoltent contre une réalité insupportable, qu’elles se refusent à admettre, comme elles refusent de s’alimenter ou d’être soignées.
Comment donner sens à la perte de repères et au sentiment « affolant » de tout perdre, dans les milieux de soins désensibilisés à la dimension psychique ?
Appréhender les comportements signifiants : « je n’en peux plus ! Je voudrais tout oublier ! Je ne sais plus où j’en suis ! Qu’est-ce que je vais devenir ? » uniquement sous l’angle de symptômes pathologiques, ne rend pas compte du bouleversement psychique, de la crise qui a lieu autour des 80 ans et de ses conséquences !
Pourtant, cette tendance s’accroît, bien que de nombreux cliniciens le constatent, comme ce médecin âgé et désabusé par cette évolution :
- « On ne sait plus écouter un malade. On lit les résultats d’examen. On interprète des chiffres, des tracés sans âme, sans chaleur humaine ».
L’approche technologique de l’humain s’inscrit dans un contexte social volontier amnésique du côté psychoaffectif. Il semble donner l’illusion de la maîtrise et de la toute puissance, par rapport à une situation sur laquelle il est difficile d’avoir prise et que l’on préfèrerait oublier ou cacher sous des pommades « anti-rides » !
Fuite en avant qui fait parfois dire :
- «La meilleure des vies à mon âge, c’est de tout oublier! »
ou
- « Le plus effroyable, est de se rappeler ce que l’on était ! Je préférerais avoir le cerveau à plat !». Il s’avère néanmoins quasiment impossible de mener à bien des études confirmant (ou non) ces hypothèses cliniques, et donc de mettre en place des psychothérapies visant à soutenir le travail psychique qui s’opère dans la douleur et des angoisses conduisant fréquemment à l’oubli d’un présent intolérable !
Comment rester passif face à une mutation de notre activité qui tend à « délier » la pensée de sa dimension psycho-affective, de l’inconscient et de la symbolique?
La dé-afférentation du lien psychique !
Nous assistons à la normalisation des professions exerçant dans le domaine de la santé autour de concepts organiques auxquels la psychologie devrait se ranger.
Elle modifie la manière de concevoir et d’aborder la maladie, comme la manière d’appréhender, d’écouter et de soigner la personne malade.
Quand le rapport existant entre la maladie et ce qui a été vécu, ce qui est éprouvé sur le plan affectif, est perdu de vue, la souffrance est clivée, dé-afférentée (pour reprendre un terme d’anesthésiologie) de son substrat psychique.
Certains milieux de la psychologie, sans doute fascinés par les neurosciences et leurs promesses, en négligent ce renversement des valeurs. Si la psychologie suivait la voie neuro-logique la privant de la dimension psychoaffective, elle y perdrait sa « substantifique moelle ». La psychologie qui s’est construite sur deux rapports à la réalité, objectif et subjectif, se trouverait hémiplégique du côté symbolique, selon l’expression de F.DOLTO.
La capacité à remplir une fonction de psychologue sur la base d’une approche globale et le caractère généraliste d’une activité visant à écouter, analyser les différents aspects d’une situation en vue d’un projet thérapeutique, sont donc en question. Et celle-ci se pose en terme de responsabilité !
Que pourrons nous répondre aux professionnels de santé, comme aux malades et aux familles en quête de sens par rapport à la souffrance, aux angoisses et aux comportements auxquels ils sont confrontés et dont ils perçoivent la nature psychique ?
De nombreux témoignages évoquent « l’ordonnancement » d’une fonction morcelée dans une multitudes d’activités et un rôle d’exécutant, comme le prouvent les nouvelles définitions du Répertoire Opérationnel des Métiers...
Par quel moyen pouvons nous endiguer cette évolution aux enjeux considérables?
L’échec de la Fédération laisse un goût amer. Elle a pourtant fait apparaître la nécessité de se doter d’une instance légale et officielle, capable de nous représenter!
L’organisation collégiale et associative en réseaux peut palier au plus urgent, mais restera d’une portée limitée.
Les enjeux sont tels qu’ils devraient nous inciter à repenser notre fonction, nos responsabilités par rapport au « cadre » dans lequel nous souhaitons travailler, quitte à recourir à une instance de type ordinal !
Avons nous le choix ? Ce qui se passe dans le secteur gériatrique illustre la situation à laquelle l’ensemble de la profession est, ou sera confrontée.
Les plus motivés d’entre nous s’épuisent dans des démarches, souvent sans espoir, faute d’un appuis, d’un cadre juridique (voir : «Les psychologues, un statut juridique à la croisée des chemins » Yann DURMARQUE. Ed. TEC&TOC, 2001).
Toutefois, malgré l’urgence, malgré l’accumulation de situations (parfois terribles quand elles relèvent du harcèlement par exemple) la crainte d’entrer dans une organisation professionnelle semble la plus forte ! C’est une crainte qui renvoie à « l’ordre », aux limites qui nous seraient imposées !
Il n’est toutefois pas interdit d’en inventer, d’en concevoir la dynamique et d’en faire un outil démocratique, apte à faire respecter notre code de déontologie comme les textes en vigueur et ainsi pouvoir nous entretenir avec les pouvoirs publics. Il est assez paradoxale que la psychologie, et en particulier sa branche clinique se réclamant de la «loi» dans le cadre de son activité, en fasse tout à coup abstraction dans son mode de fonctionnement!
Ha ! Pouvoir ! Vieux démon ! Pourtant il existe, mais comment l’employer, le domestiquer, afin de pouvoir tout simplement exercer dans des conditions normales : répondre aux demandes d’ordre psychologique ?
Bruno CADEC. Psychologue. Dr en Psychologie Clinique. Président de l’Association des Psychologue de Gérontologie (Apsygé) en Isère.
Couriel : BCadec@chu-grenoble.fr
Publié dans le Journal des psychologues, N° 256 d'avril 2008