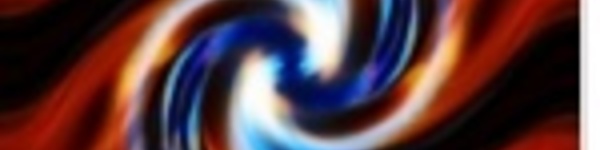Pouvez-vous à grands traits résumer votre diagnostic de l’évolution du système judiciaire et carcéral des Etats-Unis et sur le processus de dépérissement de l'Etat social au profit d'un Etat pénal hypertrophié, et notamment préciser l’origine de ce basculement historique?
Les Etats-Unis ont été secoués, et sous bien des angles transformés, dans les années 60 par l'ascension d’un faisceau de mouvements progressistes, qu’il s’agisse du mouvement de revendication noir en faveur des droits civiques, du mouvement étudiant, de l’opposition à la guerre contre le Vietnam, des mobilisations des récipiendaires d’aide sociale, ou encore du mouvement des femmes (l’histoire de ces divers mouvements est retracée dans un beau livre de Frances Fox Piven et Richard Cloward qui s’intitule justement Poor People’s Movements). De sorte qu’au début des années 70 on voit s’amorcer une relative réduction des inégalités économiques et sociales et le développement d’un embryon d’Etatprovidence indispensable pour mettre à bas le régime des castes imposé aux Noirs américains plus d’un siècle après l’abolition de l’esclavage. Ces derniers semblent alors à la veille de forcer la société étatsunikenne à les accepter enfin comme citoyens à part entière.
Mais le milieu de la décennie 70 marque une cassure très nette, qui traduit un triple mouvement de réaction sociale, raciale et anti-étatique – au sens de mouvement visant à restaurer un ordre antérieur. Il s’agit d’abord d’une réaction de classe contre l’expansion des droits sociaux et contre l’amélioration lente mais réelle de la condition salariale, suite à une très forte mobilisation du patronat.
C’est durant cette période qu’éclosent les « think tanks » néoconservateurs, ces fameux instituts de conseil en politique publique qui vont mener le réarmement idéologique de la droite et développer un nouveau discours d’apparence savante visant à museler, puis de démanteler pan à pan l’Etatprovidence et à déréguler le marché du travail. Résultat, les Etats-Unis entrent dans une période d’un quart de siècle durant laquelle le salaire minimum baisse fortement en valeur réelle (il est encore aujourd’hui de 20% inférieur à celui de 1968), le salaire ouvrier moyen s’érode et le revenu familial moyen stagne. Pour arriver à maintenir son niveau de vie, la classe moyenne doit augmenter le nombre de salariés par ménage et tout le monde accroître les heures ouvrées durant l’année (d’après une enquête récente du Bureau International du Travail, l’Amérique est le seul pays avancé dans lequel les gens travaillent plus aujourd’hui qu’il y a vingt-cinq ans, beaucoup plus même puisqu’ils sont entretemps passés devant le Japon en la matière). La désyndicalisation est très brutale : les secteurs traditionnellement syndiqués, notamment, subissent des licenciements massifs, les salariés restants se soumettent par peur de perdre leur boulot et le patronat recours systématiquement à des officines juridiques spécialisées dans l’obstruction aux organisations salariales. Résultat, l'emploi précaire, le chômage de masse et le sous-emploi se développent, puis, à partir de la fin des années 80, le travail désocialisé s’institutionnalise, devient « normal » pour tous ceux qui n'ont pas les titres scolaires permettant de postuler aux emplois qualifiés encore protégés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les deux tiers des salariés américains situés au bas de l'échelle socioprofessionnelle (dans des emplois ne requérant pas de diplome) travaillent sans couverture médicale et quatre sur cinq ne cotisent pas pour une retraite.
Et, globalement, les ouvriers étatsuniens gagnent aujourd’hui 44% de moins que leurs homologues européens. Ces conditions d’emploi dites « flexibles », que certains souhaitent importer en Europe sous couvert de « modernité » et sous prétexte de « mondialisation » sont un retour, à l’orée du vint-etunième siècle, au salariat sauvage de la fin du dix-neuvième.
Le deuxième retournement s’effectue sur le plan racial : c’est une réaction de rejet continué des Noirs Américains, qui voient une fois encore l’horizon de l’ « intégration » se reculer au fur et à mesure qu’ils s’avancent. Ils accèdent certes au vote avec la Voting Rights Bill de 1965; la discrimination et la ségrégation ne sont désormais plus soutenues ou tolérées par la loi. Sur le plan des principes affichés, les Blancs acceptent de reconnaître leur égalité civique mais dans la pratique ils s’évertuent avec une vigueur redoublée à les tenir à distance sociale, spatiale et symbolique. On assiste ainsi à une extraordinaire migration de millions de Blancs des villes vers les banlieues où ils reconstituent un espace prospère et protégé de la « contamination » d’un groupe jugé indésirable. Les Blancs retirent leurs enfants des écoles publiques, qui s’enfoncent dans la spirale du déclin, et cherchent de plus en plus à se fournir en « biens publics », sécurité, santé, culture, transport, sur le marché privé plutôt qu’auprès de l’Etat local, qu’ils jugent désormais trop dispendieux. Au total, la division raciale rigide de la société américaine survit au soulèvement noir des années 60, comme le montre deux indicateurs frappants: la ségrégation raciale de l’habitat n’a pas bougé pas en 50 ans, alors que les taux de ségrégation sont supérieurs à 70 dans les métropoles (sur une échelle ou 100 indique l’apartheid parfait); le taux d'intermariaged des Noirs, indicateur de mixité, reste extraordinairement bas. Pensez qu’en France, un jeune sur deux issu de l'immigration maghrébine vit maritalement ou se marie hors de son groupe d'origine alors qu’aux Etats-Unis 97% des femmes noires épousent un Noir. L’endogamie de caste reste la règle en dépit du brouhaha médiatique autour de la multiplication des unions dites « multiraciales » : elles représentent 2,5 % des unions contre 0,5 % il y a trente ans. Pourquoi les Noirs continuent-ils d’être ostracisés de la sorte ? Parce qu’ils portent un stigmate indélébile – aux yeux des Blancs et des autres immigrés qui apprennent vite le mépris racial qui sous-tend la culture nationale – du fait qu’ils sont arrivé dans le Nouveau Monde par le biais de l'esclavage, donc asservis dans un pays qui se pense comme celui de la liberté ; ils ont été privés du droit de vote jusqu'en 1965 dans le berceau de la démocracie ; et ils sont dépourvus d’honneur ethnique (dont Max Weber notait avec justesse qu’il est l’ « honneur des masses ») parce qu’ils ont été déracinés, au sens littéral, et qu’ils ne se rattachent à aucune nation identifiable.
La réaction sociale et raciale qui transforme l’Amérique est redoublée par une formidable réaction anti-étatique. Tandis que le patronat se mobilise contre un Etat régulateur qui protège les salariés des sanctions du marché du travail, les Blancs se mobilisent contre le volant assistantiel de l’Etat. Car les aides sociales sont perçues comme étant des privilèges accordés principalement à la population noire et qui tendent à perpétuer ses vices. Ces privilèges sont doublement indus puisqu’ils seraient octroyés sur un critère ethnique et qu’ils récompensent voire encouragent les émeutes et autres troubles urbains causés par les Noirs des villes (la sociologue Jill Quadagno le montre dans un livre au titre là encore révélateur, The Color of Welfare). Les classes moyennes et supérieures, les plus mobilisées électoralement, vont donc exiger que l’Etat réduise ses activités et ses financement sur le front social, afin de cesser de « pomper » leurs impots pour subvenir aux besoins des « mauvais pauvres » des ghettos. La campaigne de « dégraissage » de l’Etat social, lancée par Reagan au début des années 80 va s’amplifier jusqu’à l’abolition du droit à l’aide sociale, inscrite dans la loi depuis 1935, avec « Loi sur la Responsabilité personnelle et le travail » de 1996, rédigée par les fractions les plus réactionnaires du Parti Républicain et paraphée par Clinton, Président d’apparence démocrate.
Quelle est l’ampleur de ce phénomène et comment est-il lié à l’expansion du secteur pénal de l’Etat?
Le recul de l’Etat social aux Etats-Unis est tout à fait spectaculaire. La couverture des allocations chômage couvrait les deux tiers des salariés licenciés en 1975 ; ce n’est plus qu’un tiers vingt ans plus tard. Le nombre des exclus de la couverture médicale ne cesse de grimper pour atteindre 45 millions aujourd’hui. L’allocation aux femmes démunies avec des enfants, par exemple, diminue de 50 % en valeur entre 1975 et 1996, année où elle est remplacée par un programme d’ « aide temporaire pour les familles dans le besoin » qui oblige les récipiendiaires à accepter un emploi sous-payé (c’est le fameux workfare) en contrepartie de leur allocation et qui limite à cinq ans au maximum tout au long d’une vie la durée des aides publiques. Il s’agit par ce mécanisme de pousser les plus vulnérables sur les segments inférieurs du marché du travail, dans des conditions dérogatoires au droit du travail, au droit salarial et au droit social (les titulaires d’un emploi de workfare peuvent être payés en dessous du Smic, par exemple).
Cette double réaction raciale et sociale va s’accompagner et s’amplifier par une vaste campagne dite de « loi et d’ordre » qui devient le thème-clé des politiciens conservateurs à la fin des années soixante puis des démocrates dix ans plus tard. Cette politique sécuritaire va servir à « restaurer » l’ordre dans la rue et dans les quartiers déshérités, c’est-à-dire à réprimer les mouvements de protestation des pauvres. Elle fournit en outre un exutoire commode à une hostilité raciale persistente qui ne peut plus se manifester de manière ouverte. Désormais illégitime et même sanctionné légalement, le sentiment anti-noir va pouvoir s’exprimer de manière indirecte à travers la démonisation et le dénigrement public des criminels et des prisonniers, rapidement identifié au tueur ou violeur noir (à l’image de Willie Horton, ce criminel rendu célèbre par les publicités de George Bush lors de sa campagne présidentielle de 1988). C’est là le paradoxe de l’Etat pénal néolibéral : il s’affirme et se développe alors même que, sur le marché du travail et en matière de protection sociale, la force publique se dit impuissante et entend réduire son action. Le moins d’Etat économique et social appelle et nécessite le plus d’Etat pénal, auquel on demande d’endiguer les désordres générés par la dérégulation économique et le délitement du filet de protection sociale – et, dans le cas des Etats-Unis, de restabiliser un régime des castes en grand danger. Et les prisons font leur retour sur le devant de la scène.
Le dernier quart de siècle a vu une croissance astronomique des arrestations par la police, des condamnations pénales par les tribunaux et des mises sous écrou en Amérique. Dans une période où la criminalité reste en gros stagnante puis décline fortement, le nombre de personnes incarcérées est multiplé par cinq: on passe de quelques 400.000 détenus en 1975 à 2 millions aujourd’hui. A cela s’ajoute l’expansion latérale de l’Etat pénal : 4,5 millions d'américains sont condamnés à la prison avec sursis, remis en liberté conditionnelle ou en attente de jugement. Au total, ce sont donc plus de six millions de personnes qui sont sous « main de justice », soit un homme sur vingt, un Noir adulte sur dix, et un jeune Noir de 18 à 35 ans sur trois.
Peut-on comparer cette évolution à celle d’autres pays ?
Aucune société, même l’Union soviétique du temps des goulags, n’a jamais utilisé son système pénal de manière aussi extensive et intensive à la fois. De fait, le taux d'incarcération affiché par les Etats-Unis aujourd’hui, avec 700 détenus pour 100.000 habitants, est proche de ceux affichés par l'Union soviétique à la fin des années 50 et double de celui de l’Afrique du Sud au plus fort de la lutte armée contre le régime d’apartheid, c’est-à-dire dans une situation de guerre civile et raciale. Il est intéressant d’observer que l’Union soviétique a connu une nette décrue carcérale jusqu’à la période de la Perestroïka puisque sa population incarcérée est tombé à environ 350 détenus pour 100 000 habitants en 1989. Depuis l’effondrement de l’Empire soviétique et la transition « démocratique » vers l’économie dite de marché, la Russie a doublé son taux d'incarcération, revenant au taux qu'elle affichait il y a 30 ans. Elle est aujourd'hui repassée juste devant les Etats-Unis avec 800 détenus pour 100 000 habitants. La France et la plupart des pays européens ont des taux d’incarcération oscillant entre 70 et 120 détenus pour 100 000 habitants, soit cinq à douze fois moins que les USA. Mais qui eux aussi ont doublé ou triplé au cours des trois décennies passé, soit depuis l’avênement du chômage de masse et du salariat précaire.
Pour mener à bien cette expansion vertigineuse du système pénal, il a fallu mobiliser des moyens financier et humains sans précédent. Alors que les crédits pour les programmes sociaux, l’éducation et la santé stagnaient ou diminuaient, les budgets de la police, des services judiciaires et de l’administration pénitentiaire ont augmenté très rapidement – plus rapidement même que les crédits militaires sous Reagan et Bush. Durant la décennie 80, par exemple, le gouvernement fédéral diminue de 20 milliards de dollars les nouvelles autorisation de crédits consacrés au logement social ; parallelement les Etats accordent une rallonge de 15 milliards de dollars à leurs administrations pénitentiaires. Au point qu’on peut dire que le programme de logement social aux Etats-Unis, c’est les prisons. Car les établissements pénitentiaires accueillent la même clientèle qui ne trouve plus de logement social à l’extérieur : quatre prisonniers sur cinq sont issus des fractions les plus précaires et marginalisées de la classe ouvrière, avec un niveau d'éducation et un niveau de qualification professionnelle très bas : la moitié des admis en maison d'arrêt aux Etats-Unis n’avaient pas d’emploi à plein temps au moment de leur arrestation ; 5 % seulement ont un niveau scolaire post-secondaire; 15% seulement sont mariés (contre la moitié de leur classe d’âge au niveau national) ; les deux tiers proviennent de familles vivant en dessous de… la moitié du seuil de pauvreté.
Quand Bill Clinton affiche sa fierté de mettre « fin au Big Government », il ne fait pas référence à l’appareil pénal de l’Etat puisque la branche fédérale de l’administration pénitentiaire double ses effectifs et ses budgets durant ses présidences. Au total, les administrations pénitentiaires des cinquante Etats et les quelques trois mille administrations pénitentiaires des comtés, qui gèrent les maisons d’arrêt, comptent plus de 650 000 employés. Ce qui fait d’elles le troisième employeur du pays, juste derrière les deux firmes d’emplois temporaires, Manpower Incorporated et Kelly Services, et juste devant General Motors, la première firme au monde par le chiffre d'affaires. Mais, même en coupant les crédit du secteur social pour alimenter son secteur pénal, l’Etat n’est pas capable seul de faire face au flot de détenus que sa politique hyperrépressive génère : durant la décennie 80, il faut construire en moyenne un établissement pénitentiaire de 1.500 places toutes les semaines. La nécessité matérielle, organisationnelle, et l’idéologie de la « marchandisation » convergent pour pousser à faire appel au secteur privé.
A partir de 1987 émerge un marché de l’emprisonnement à but lucratif qui touche bientôt l’ensemble des biens et services liés à l’enfermement, de la conception des prisons, l’architecture, 5 l’assurance et la construction, à la gestion quotidienne, gardiennage, alimentation, santé, en passant par le montage financier (on passe par le marché obligataire pour obtenir les fonds nécessaires et éviter de se présenter devant les électeurs pour faire augmenter les impots). A la fin des années 90, une vingtaine de firmes se partagent un marché national de 150.000 détenus, soit trois fois la population carcérale de la France et les entreprises leader de cette industrie florissante comptent parmi les investissements les plus rentables sur le marché Nasdaq. L’approvisionnement des établissements en prisonniers lui-même est parfois pris en charge par ces firmes, avec la constitution d’un marché de l’import-export du détenu, puisqu’un certain nombre d’Etats et de comtés ont trop de reclus et cherchent des places tandis que d’autres ont délibérément construit en surcapacité de sorte à pouvoir ensuite vendre leurs « lits » disponibles. C’est ainsi que si vous êtes arrêté et condamné à la prison dans l’Etat d’Hawaï, vous serez envoyé purger votre peine au Texas, avec les conditions de contact avec la famille et donc les chances de réhabilitation qu’on imagine!
Est-on dans le même mécanisme d’effacement de l’Etat social au profit d’un Etat policier et carcéral en France et plus généralement en Europe ? Dans Les Prisons de la misère et dans votre contribution à l’ouvrage collectif La Machine à punir (Dagorno, 2000), vous parlez d’une « voie européenne vers l’Etat pénal »
Les Etats-Unis ont en quelque sorte inventé une nouvelle technique de gestion de la misère qui consiste à la réguler par le biais d’une politique sociale transformée en tremplin vers le travail précaire et d’une politique pénale hyperactive visant à augmenter le prix des stratégies de fuite hors du marché de l’emploi d’insécurité. Il s’agit en apparence d’un retour au 19ème siècle, si l’on considère la dérégulation économique et le démantèlement des protectiosn sociales. Mais elle s’accompagne d’une vraie innovation politique : la formation d'un nouvel État, que je qualifie de libéral-paternaliste, car il est libéral pour les classes moyennes et supérieures, envers lesquelles il pratique le « laisser-faire et laisserpasser » et paternaliste quand il s'agit de gérer les conséquences de la dérégulation économique et sociale vis-à-vis des classes populaires déstabilisées par le retrait de l’Etat social : il entend contrôler et au besoin punir le comportement quotidien des classes précarisées en matière de travail, de famille, de scolarité, de sexualité, etc. Un exemple : dans le Wisconsin, on réduit l’aide sociale à une famille dont les enfants manquente d’assiduité à l’école ; on exclue du logement social un individu qui sort de prison s’il a été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Aux Etats-Unis, cette invention a été rendu possible parce que l’Etat social était peu développé et fragile au départ: il s’agit d’un Etat « charitable », qui a émergé tardivement et distribue des aides catégorielles stigmatisantes, plutôt qu'un Etat social au sens classique du terme, qui offre des soutiens et des services sur une base universaliste (comme les allocations familiales). De sorte qu’il n’y a pas eu de mouvement de résistance, ni de véritable questionnement de cette politique et qu’elle a pu prendre la forme d’un basculement du social vers le pénal. Les pays européens sont dans une situation différente, pour un ensemble de raisons qui ont trait à leur histoire et notamment à l’ancrage plus profond et plus élargi des droits sociaux. En France, l’existence d’un Etat social fort est le produit de deux siècles de luttes sociales adossées à l’héritage de l'absolutisme. Avec l'instauration de la république, l’Etat a institutionnalisé un ensemble de demandes collectives, de droits civiques, économiques et sociaux, le droit au logement, au travail, à l’enseignement libre et gratuit, à la santé, le droit de grève, etc., qui opèrent comme autant de résistances objectives et subjectives à la pénalisation de la misère en ceci qu’ils empêchent qu’on soumette les plus démunis à la logique nue du marché, d’une part, et qu’ils sont défendus par des corps professionnels organisés capables de défendre leur périmètre d’intervention et leur mission.
Deuxième facteur de différence : les sociétés d’Europe continentale ne sont pas baties sur une césure raciale comme l’est la société américaine, née de l’esclavage noir et de l’ethnocide indien. Leur système social n’est pas fondé sur la segmentation et la reproduction séparée de « communautés » qui entrent en compétition dans un champ politique qui les reconnaît comme telles. Aux Etats-Unis, la séparation des communautés limite leur tendance à l’identification mutuelle et fait, par exemple, que les Blancs considèrent que l’emprisonnement massif qui frappe les jeunes Noirs n’est pas un drame national mais un problème qui concerne d’abord (voire uniquement) la communauté noire. Le criminologue norvégien Nils Christie a montré que chaque fois que la logique du « eux et nous » prévaut en matière de châtiment, il est plus facile d’avoir recours aux solutions pénales et d’aggraver les sanctions. Cette logique dualiste n’est pas (encore ?) opérante en France. J’ai été frappé par le fait que, dans le petit drame politico-moral qui s’est joué autour du livre du Docteur Vasseur sur les prisons (Médecin-chef à la Santé), même la droite conservatrice exprimait des positions humanistes classiques : les délinquants potentiels ou actuels font a priori partie du corps social ; ils ne sont pas cet Autre radical qu’on diabolise en faisant ressortir Force de l’Etat social, moindre prégnance de l’idéologie individualiste et utilitariste qui sous-tend la sacralisation du marché, absence de césure ethnoraciale : ces facteurs vont que les pays européens ne peuvent pas passer au « tout pénal » et doivent inventer à taton leur propre voie vers l’Etat pénal, conforme à leur histoire nationale, à leurs structures sociales et à leurs traditions politiques. Pour schématiser, on peut dire que, sur le continent, on observe non pas un basculement du social vers le pénal mais une accentuation conjointe et corrélée des deux formes de gestion de la misère.
Pouvez-vous illustrer ce renforcement simultané de l’Etat social et de l’Etat pénal ?
Dans le cas français, cela consiste, d’un côté, à étendre le filet de protection sociale par le biais du revenu minimum d’insertion, de l’extension de la couverture maladie, et de la multiplication des allocations spécifiques et d’un ensemble de dispositifs dits d’ « insertion », formation professionnelle, « emplois jeunes », contrats emploi-solidarité, stages, etc. De l’autre côté, toutefois, la nouveauté spectaculaire des dix dernières années est l’élargissement et l’intensification des activités policières, judiciaires et pénales spécifiquement ciblées sur des territoires -- les quartiers dits « sensibles » -- c’està- dire sur les populations précarisées qui y résident. On soumet ces quartiers à la surveillance intensifiée de « cellules de veille », à un quadrillage policier redoublé (avec la sédentarisation des CRS), à l’action diligente de « groupes locaux de traitement de la délinquance » chargés de réprimer en « temps réel » les infractions observées. Il y a donc une réactivation du traitement social et du traitement pénal des désordres urbains, le premier servant de cache-sexe au second et lui étant de plus en plus soumis : en encourageant les services sociaux, médicaux, scolaires, etc., de l’Etat à collaborer étroitement avec la police et la justice, on fait d’eux des extensions de l’appareil pénal et on tend à instaurer ce que j’appelle un panoptisme social qui, sous couvert du bien-être des populations démunies, les soumets à un surveillance rapprochée et répressive de plus en plus étroite.
L’Etat consent une débauche d’énergie sans précédent pour détecter et réprimer pénalement la petite et moyenne et délinquance de rue dans les quartiers anciennement ouvriers sous prétexte de restaurer le « droit à la sécurité » des petits, au moment même où il accorde aux grands une impunité quasi-totale. Faut-il rappeler que les mêmes qui entendent appliquer la « tolérance zéro » en bas de la structure des classes montrent la plus grande mansuétude pour la délinquance d’entreprise et pour la criminalité d’Etat, pourtant avérée et infiniment plus grave et couteuse, de l’affaire Elf aux multiples affaires qui impliquent directement le Président de la République ? Une échelle graduée de gestion des actes délictueux se met ainsi en place: par exemple, suivant le type d’acte commis - délinquance économique qui est une délinquance de classe moyenne et donne lieu à une instruction, ou délinquance de rue qui est principalement populaire et se traite principalement par le biais de la comparution immédiate -, les critères de la mise en détention préventive ne sont pas les mêmes ; les options judiciaires offertes aux uns et aux autres sont également divergentes. La multiplication des dispositifs dérogatoires qui ne s’appliquent dans la réalité qu’aux habitants des quartiers pauvres, comme la « composition pénale » (sorte de plea bargain à la française) fait qu’aujourd’hui le droit pénal s’applique différentiellement selon l’origine ethnique et de classe.
Cette application différentielle de la loi s’applique notamment pour tout ce qui concerne les drogues. Les catégories d'origine ouvrière sont très fortement sur-représentées parmi les personnes interpellées pour usage de cannabis, alors qu'il y a une dépénalisation de fait de l'usage des stupéfiants par les classes moyennes et supérieures…
La répression différentielle de l’usage des drogues est en effet un cas flagrant d’une justice à plusieurs vitesses : d’un côté, des jeunes d’origine populaire prennent des peines de prison pour des petites infractions, le plus souvent pour simple détention de cannabis, et là le discours insiste sur l’urgence qu’il y a à sévir; de l’autre, quand telle vedette de cinéma ou de la chanson passe au tribunal pour traffic de poudre de cocaïne, on nous convie à nous émouvoir de la tragédie personnelle qu’elle vit et on souligne derechef la nécessité d’un traitement médical de la dépendance psychotropique.
La loi de 1970 sur les drogues contient l'injonction aux soins, que l’on peut analyser comme une forme de soumission du médical au pénal…
Le problème des drogues est un problème particulier, pour des raisons à la fois techniques et symboliques. Symboliques d’abord : la drogue représente la perte de la responsabilité individuelle, le plaisir à la portée de tous à tout moment, un plaisir qui va à l’encontre de la discipline du travail et de la moralité qui sont l’armature de la société contemporaine. C’est le fondement symbolique de l’ordre social qui est mis en quelque sorte en question par la consommation des drogues – c’est pourquoi de ce point de vue il n’existe pas de « drogue douce ». C’est aussi un problème particulier pour des raisons techniques qui tiennent aux effets réels substances ingérées: la dépendance psychotropique s’appuit sur des phénomènes biophysiologiques avérés – le cerveau ne fonctionne pas de la même manière quand vous prenez du LSD. Tout cela doit être pris en considération. Ce qui veut dire que vouloir traiter le problème de la drogue comme une forme de délinquance parmi d'autres est une erreur à la fois pratique et politique.
Est-ce que le traitement médical de la dépendance psychotropique tend à soumettre le médical au pénal ?
Je ne pense pas qu’on puisse donner une réponse de principe à cette question. Cela dépend du dispositif concret mis en place et de son utilisation et donc il faut faire des recherches précises sur le sujet, libres de tabous politiques et scientifiques habituels. A partir des expériences faites par divers pays européens en matières de dépénalisation et de médicalisation des prises en charge, il faut s’efforcer de comprendre de quelle manière, quand et par quels biais les politiques menées accroissent les chances de vie, l’autonomie, les possibilités de choix des « patients », ou, au contraire, reviennent à faire de la pénalisation douce, à mettre sous tutelle médicale ou éventuellement sous tutelle judiciaire des populations qui sont dépourvues de toute prises sur leur propre leur vie, privées des moyens de gérer leur dépendance psychotropique comme elles le souhaitent.
À tout moment, une société dispose de trois stratégies pour traiter une conduite ou une condition jugée offensante ou dangereuse. La première consiste à la socialiser, c’est-à-dire à agir au niveau des causes sociales et des mécanismes collectifs qui la produisent et la reproduisent, par exemple en construisant des logements pour les sans abri. La seconde technique est la médicalisation : c’est considérer qu’une personne est sans abri parce qu’elle souffre de dépendance vis-à-vis de l’alcool ou de problèmes de santé mentale, et donc chercher un remède médical à un problème qui est par définition perçu comme individuel. La troisième technique est la pénalisation : dans ce cas de figure, on ne se soucie guère de comprendre la situation individuelle et les mécanismes collectifs en jeu; le sans abri est perçu comme un délinquant et se retrouve traité comme tel. Il cesse de l’être dès qu’il est mis en prison. À tout moment, les sociétés peuvent mettre en oeuvre ces trois techniques, selon diverses proportions et pour diverses conditions, pour autant qu'elles aient développé la capacité organisationnelle et idéologique de le faire. Le dosage et le ciblage de ces trois manières de traiter les situations ou les populations dites « à problèmes » est le résultat d’un choix éminemment politique, au sens le plus noble du terme : il engage la conception que nous avons de la vie en collectivité ; il découle et décide du type de société dans laquelle nous vivons et souhaitons vivre. Il importe que ce choix soit fait en conscience et en pleine connaissance des causes et des conséquences, à moyen et long terme, des options qui sont offertes. L’erreur la plus grave consiste ici à croire et à faire croire, comme le voudrait le discours hypersécuritaire qui sature les champ politique et médiatique aujourd’hui, que la pénalisation est la voix royale, voire le seul moyen de restaurer la sécurité et qu’on ne dispose d’aucune alternative.
--------------------------------------------------------------------------------
Sociologue, professeur à l’Université de Californie-Berkeley et chercheur au Centre de sociologie européenne
Naissance à Nîmes. Études à Paris (École des hautes études commerciales) et à Nanterre (sociologie), puis Chapel Hill (Caroline du Nord, États-Unis) et Chicago (où il obtient un doctorat de sociologie). Lauréat de la MacArthur Fellowship (surnommée aux USA " bourse des génies ").
1985. Chercheur à l’université de Chicago, il étudie le ghetto noir ; publie l’École inégale : éléments pour une sociologie de l’école en Nouvelle-Calédonie.
1992. Chercheur au centre de sociologie européenne du Collège de France.
1995. Participe avec Gérard Mauger, Louis Pinto, Christiane Chauviré, au numéro de la revue Critique consacré à Pierre Bourdieu.
1996. Professeur à l’Université de Californie, à Berkeley. Il a également été professeur invité à Rio de Janeiro, à Berlin, à Paris, à New York, à Los Angeles. Publie " Notes tardives sur le marxisme de Bourdieu ", in Actuel Marx, nø 20, " Autour de Pierre Bourdieu "
1999. Publie les Prisons de la misère, éditions Raisons d’agir, 190 pages, 6,10 euros.
2001. Publie Corps et âme, Carnets ethnographiques d’un apprenti boxeur, éditions Agone, 18 euros.
2002. Publie (en italien) Simbiosi Mortale, Neoliberalismo au Stado Penal, éditions Ombre Corte, 140 pages, 12 euros.
2003. À paraître en septembre : Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale, éditions Agone.
--------------------------------------------------------------------------------
Origine : Publications Lecrips net
Réseau Voltaire
Son site : Loïc Wacquant