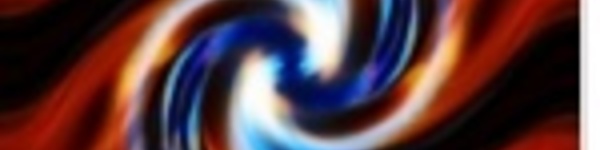“Réorganiser l’offre de soins de première ligne et sensibiliser le public aux problèmes de santé mentale et au bon usage des soins
“Réorganiser l’offre de soins de première ligne avec les médecins généralistes, renforcer les liens avec le dispositif de soins spécialisés et faciliter l’accès aux psychothérapies”
Des propositions concernant les psychothérapies sont abordées, pour la première fois, dans un rapport remis à un Ministre de la Santé.
La demande de psychothérapies est croissante en France, comme dans tous les pays européens. Les auteurs soulignent cette tendance, en proposant une nomenclature qui s’appuie sur le comité d’expertise mis en place par l’Inserm, à la demande de la Direction Générale de la Santé, et qui précise les indications des différentes psychothérapies.
Ils proposent l’établissement d’une liste des professionnels habilités à pratiquer, en définissant les règles de prescription et en proposant une prise en charge par les systèmes de protection sociale. Le rapport insiste sur une offre de soins psychothérapiques qui est, en France, confuse et, surtout, inéquitable, situation à laquelle les auteurs pensent indispensable d’apporter des réponses.
Il s’agit, pour la Mission Nationale d’Appui en Santé Mentale, d’avancées positives et innovantes qui ont été les premières à induire des réactions véhémentes, souvent hostiles.
Faire émerger la question des psychothérapies ne règle pas la question de la définition du champ, du métier et de la formation des intervenants susceptibles d’exercer. La proposition de solvabilisation ne peut plus permettre d’esquiver ces questions. On peut craindre que l’absence de concertation préalable ne rende difficilement applicables les principes avancés.
Les interrogations sur les modes de formation à la psychothérapie sont analogues à celles que l’on pourrait se poser sur les traitements médicamenteux (sujet qui n’a pas été abordé dans le rapport).
Dans la pratique courante des psychiatres, il est artificiel d’isoler voire d’opposer, de façon binaire chimiothérapies et psychothérapies.
Une réflexion/formation pertinente sur la chimiothérapie ne se réduit pas à la prescription de médicaments :
• la chimiothérapie exerce des effets de nature à contrôler, atténuer ou au contraire, amplifier certains comportements et certaines relations à travers son influence sur les symptômes,
• les effets des psychothérapies influencent le fonctionnement cérébral,
• de nombreuses interventions de pratique courante, en psychiatrie, en particulier lors qu’il s’agit de cas graves ou complexes, combinent fréquemment plusieurs approches :
- chimiothérapies et actions psychosociales ou psycho-éducatives, codifiées ou non, peu différentes d’une psychothérapie (par exemple dans le traitement des patients schizophrènes),
- chimiothérapies et psychothérapies effectuées par des praticiens différents,
- interventions psychothérapiques complexes, multifocales, médico-psycho-socio- familiales, associées ou non à une chimiothérapie, mises en oeuvre par une même équipe ou dans le cadre d’un réseau coordonné autour d’un patient.
On peut, sans critiquer les intentions, attirer la réflexion sur de nombreuses difficultés pratiques ou de principe :
La définition trop restrictive des indications psychothérapeutiques aux pathologies peut exclure une grande partie des utilisateurs à propos desquels il existe un continuum et non une opposition, binaire, entre santé et maladie. Le système proposé qui décrit schématiquement quatre situations type et donc une graduation, ne permet pas que soient abordées les situations qui, par leur intensité ou leur complexité débordent les professionnels de première ligne, notamment dans le cadre de l’urgence. À l’inverse nous pensons, comme les rapporteurs, qu’une définition trop vague ouvrirait la porte sans limites et avec une légitimité contestable, surtout si le financement est socialisé.
C’est pourquoi nous proposons que la définition inclue le domaine plus large de la santé, et non exclusivement le soin.
Réserver la psychothérapie aux médecins, spécialistes ou non, et aux psychologues restreint, de fait, la contribution à la psychothérapie de nombreuses professions (infirmiers, éducateurs, travailleurs sociaux) qui se sont formées à différentes écoles de psychothérapie dans des conditions identiques et dans les mêmes instituts ou organismes que les médecins et les psychologues. Cette limite adresse des messages négatifs pour l’avenir de ces professions.
L’accent devrait être mis sur les exigences du cursus de formation et non sur le métier d’origine.
Par ailleurs, il n’existe pas de relation directe entre un niveau élevé de connaissances universitaires (bac + 5 ou 7) et l’aptitude à la psychothérapie. Il n’est pas suffisant d’être docteur en psychologie ou en médecine pour être thérapeute.
Les psychiatres et les psychologues diplômés devraient être inclus dans les professionnels invités à une validation de leur formation à la psychothérapie. Tous n’ont pas acquis les techniques dont la connaissance doit être exigée tandis que les connaissances et les savoir-faire liés aux psychothérapies doivent faire partie de leur formation initiale.
Un niveau universitaire élevé pour accéder à la formation, dont la durée sera assez longue pèse, sur le plan économique, limite l’apprentissage, et donc l’exercice de la psychothérapie, à ceux ou celles qui en ont les moyens ou consentent des sacrifices personnels énormes, ce qui n’est pas sans retentissement sur le caractère élitiste de la pratique et les tarifs pratiqués et, peut être, dans les faits, contraire à l’objectif d’inclure cette offre dans les soins et la santé.
S’agissant de la période transitoire et afin de ne pas fermer le dispositif, il serait utile que tous les professionnels, et pas seulement les psychiatres et les psychologues, qui souhaitent être habilités, puissent l’être en faisant valider leur expertise clinique.
Les accréditeurs doivent-ils être uniquement des praticiens universitaires, de médecine ou de psychologie ? Ce n’est pas dans ces corps que se recrute nécessairement le nombre le plus élevé de psychothérapeutes et que s’observe l’expérience la plus autorisée dans ce domaine
Est-ce que les sociétés de psychanalyse sont, ou non, concernées ? Est-ce que le fait de ne pas être agréé, ou pas encore, ou de ne plus l’être, définit le “non accrédité”, ipso facto, comme un charlatan, en dehors de l’exclusion du remboursement, etc. ?
Le rapport préconise la création d’un psychiatre coordinateur qui évaluerait l’état clinique et les indications thérapeutiques. Il est délicat de séparer cette question du rôle de la première ligne où commence normalement l’évaluation.
La constitution d’un réseau dans un territoire de santé ne doit pas se substituer aux réponses locales dont le réseau ne devrait être que le recours ou la ressource pour la prise en charge de populations ou pour une évaluation ciblée. Sans quoi, sa création risquerait de centraliser un dispositif de consultations d’évaluation.
Le psychiatre coordinateur proposé apparaît investi de deux grandes missions : la régulation, téléphonique ou non, et la détermination et l’orientation vers une offre de consultation (évaluation et accessibilité).
Ces responsabilités impliquent une légitimité et une autorité pour qu’il soit reconnu par tous. Il vaut mieux parler d’une fonction de coordination que d’un coordinateur unique.
L’évaluation conjointe psychiatre/psychologue pour porter l’indication d’une psychothérapie lorsque cette dernière est demandée à un psychologue (comme il est proposé dans le rapport) n’est pas sans poser des problèmes de mise en oeuvre. D’autres formules sont peut-être préférables : contrôle a posteriori, entente préalable avec le médecin/psychologue contrôleur de l’organisme payeur pour une durée et un nombre de séances définis. Compte tenu des demandes exponentielles de psychothérapie, on risquera d’observer une prolifération de consultations d’évaluation par des psychiatres déjà saturés, dont le nombre diminue.
Relevons que le risque d’une évaluation conjointe est aussi de faire porter par le médecin la responsabilité médicolégale du processus alors qu’il ne serait responsable que de l’indication (ou de la contre-indication).
Les auteurs du rapport proposent que l’assurance maladie ne prenne en charge que les psychothérapies qui relèvent du soin.
Cette affirmation risque de renforcer l’idée selon laquelle la psychothérapie pourrait relever du confort et du social. Un financement conjoint des psychothérapies par l’assurance maladie et les mutuelles permettrait d’envisager des forfaitisations annuelles (ou pluriannuelles) de participation contractualisée entre les différents organismes payeurs (en vérifiant une répartition équitable ou en la modifiant a posteriori), pour ne pas avoir à “expertiser” chaque cas.
Au total, la question posée par la place de la psychothérapie dans le domaine des soins et de la santé, ne doit pas faire reculer sur l’importance de cet enjeu, mais attirer l’attention sur la complexité de ses répercussions.
"Proposer une information claire destinée au grand public"
Sur ce thème, à propos duquel des rapports antérieurs ont insisté avec justesse, l’état des lieux actuel est particulièrement éclairant et montre les difficultés à surmonter.
La psychiatrie se présente comme une boîte noire pour le grand public, mais également pour les professionnels. Parmi eux, tous ne font pas corps, les opinions, souvent doctrinaires, s’affrontent, ne permettant pas que soit dégagée une réponse suffisamment claire aux multiples questions qui traversent le champ des troubles mentaux. C’est le premier obstacle à un processus pertinent d’information continue, qui exige un minimum de consensus susceptible de fournir un thésaurus de référence aux professionnels de la communication.
Ce défaut conduit à l’impossibilité de mettre en place une formation à l’information en santé mentale qui s’impose, si l’on veut que le public reçoive une information validée. Cette situation explique en partie, mais elle est déterminante, les contradictions de l’information fournie au grand public, actuellement de faible qualité.
Élaborer une charte de communication avec les journalistes, construire des campagnes d’information, permettrait de lever certains obstacles et d’améliorer l’information, pour mieux communiquer.
Des propositions concernant les psychothérapies sont abordées, pour la première fois, dans un rapport remis à un Ministre de la Santé.
La demande de psychothérapies est croissante en France, comme dans tous les pays européens. Les auteurs soulignent cette tendance, en proposant une nomenclature qui s’appuie sur le comité d’expertise mis en place par l’Inserm, à la demande de la Direction Générale de la Santé, et qui précise les indications des différentes psychothérapies.
Ils proposent l’établissement d’une liste des professionnels habilités à pratiquer, en définissant les règles de prescription et en proposant une prise en charge par les systèmes de protection sociale. Le rapport insiste sur une offre de soins psychothérapiques qui est, en France, confuse et, surtout, inéquitable, situation à laquelle les auteurs pensent indispensable d’apporter des réponses.
Il s’agit, pour la Mission Nationale d’Appui en Santé Mentale, d’avancées positives et innovantes qui ont été les premières à induire des réactions véhémentes, souvent hostiles.
Faire émerger la question des psychothérapies ne règle pas la question de la définition du champ, du métier et de la formation des intervenants susceptibles d’exercer. La proposition de solvabilisation ne peut plus permettre d’esquiver ces questions. On peut craindre que l’absence de concertation préalable ne rende difficilement applicables les principes avancés.
Les interrogations sur les modes de formation à la psychothérapie sont analogues à celles que l’on pourrait se poser sur les traitements médicamenteux (sujet qui n’a pas été abordé dans le rapport).
Dans la pratique courante des psychiatres, il est artificiel d’isoler voire d’opposer, de façon binaire chimiothérapies et psychothérapies.
Une réflexion/formation pertinente sur la chimiothérapie ne se réduit pas à la prescription de médicaments :
• la chimiothérapie exerce des effets de nature à contrôler, atténuer ou au contraire, amplifier certains comportements et certaines relations à travers son influence sur les symptômes,
• les effets des psychothérapies influencent le fonctionnement cérébral,
• de nombreuses interventions de pratique courante, en psychiatrie, en particulier lors qu’il s’agit de cas graves ou complexes, combinent fréquemment plusieurs approches :
- chimiothérapies et actions psychosociales ou psycho-éducatives, codifiées ou non, peu différentes d’une psychothérapie (par exemple dans le traitement des patients schizophrènes),
- chimiothérapies et psychothérapies effectuées par des praticiens différents,
- interventions psychothérapiques complexes, multifocales, médico-psycho-socio- familiales, associées ou non à une chimiothérapie, mises en oeuvre par une même équipe ou dans le cadre d’un réseau coordonné autour d’un patient.
On peut, sans critiquer les intentions, attirer la réflexion sur de nombreuses difficultés pratiques ou de principe :
La définition trop restrictive des indications psychothérapeutiques aux pathologies peut exclure une grande partie des utilisateurs à propos desquels il existe un continuum et non une opposition, binaire, entre santé et maladie. Le système proposé qui décrit schématiquement quatre situations type et donc une graduation, ne permet pas que soient abordées les situations qui, par leur intensité ou leur complexité débordent les professionnels de première ligne, notamment dans le cadre de l’urgence. À l’inverse nous pensons, comme les rapporteurs, qu’une définition trop vague ouvrirait la porte sans limites et avec une légitimité contestable, surtout si le financement est socialisé.
C’est pourquoi nous proposons que la définition inclue le domaine plus large de la santé, et non exclusivement le soin.
Réserver la psychothérapie aux médecins, spécialistes ou non, et aux psychologues restreint, de fait, la contribution à la psychothérapie de nombreuses professions (infirmiers, éducateurs, travailleurs sociaux) qui se sont formées à différentes écoles de psychothérapie dans des conditions identiques et dans les mêmes instituts ou organismes que les médecins et les psychologues. Cette limite adresse des messages négatifs pour l’avenir de ces professions.
L’accent devrait être mis sur les exigences du cursus de formation et non sur le métier d’origine.
Par ailleurs, il n’existe pas de relation directe entre un niveau élevé de connaissances universitaires (bac + 5 ou 7) et l’aptitude à la psychothérapie. Il n’est pas suffisant d’être docteur en psychologie ou en médecine pour être thérapeute.
Les psychiatres et les psychologues diplômés devraient être inclus dans les professionnels invités à une validation de leur formation à la psychothérapie. Tous n’ont pas acquis les techniques dont la connaissance doit être exigée tandis que les connaissances et les savoir-faire liés aux psychothérapies doivent faire partie de leur formation initiale.
Un niveau universitaire élevé pour accéder à la formation, dont la durée sera assez longue pèse, sur le plan économique, limite l’apprentissage, et donc l’exercice de la psychothérapie, à ceux ou celles qui en ont les moyens ou consentent des sacrifices personnels énormes, ce qui n’est pas sans retentissement sur le caractère élitiste de la pratique et les tarifs pratiqués et, peut être, dans les faits, contraire à l’objectif d’inclure cette offre dans les soins et la santé.
S’agissant de la période transitoire et afin de ne pas fermer le dispositif, il serait utile que tous les professionnels, et pas seulement les psychiatres et les psychologues, qui souhaitent être habilités, puissent l’être en faisant valider leur expertise clinique.
Les accréditeurs doivent-ils être uniquement des praticiens universitaires, de médecine ou de psychologie ? Ce n’est pas dans ces corps que se recrute nécessairement le nombre le plus élevé de psychothérapeutes et que s’observe l’expérience la plus autorisée dans ce domaine
Est-ce que les sociétés de psychanalyse sont, ou non, concernées ? Est-ce que le fait de ne pas être agréé, ou pas encore, ou de ne plus l’être, définit le “non accrédité”, ipso facto, comme un charlatan, en dehors de l’exclusion du remboursement, etc. ?
Le rapport préconise la création d’un psychiatre coordinateur qui évaluerait l’état clinique et les indications thérapeutiques. Il est délicat de séparer cette question du rôle de la première ligne où commence normalement l’évaluation.
La constitution d’un réseau dans un territoire de santé ne doit pas se substituer aux réponses locales dont le réseau ne devrait être que le recours ou la ressource pour la prise en charge de populations ou pour une évaluation ciblée. Sans quoi, sa création risquerait de centraliser un dispositif de consultations d’évaluation.
Le psychiatre coordinateur proposé apparaît investi de deux grandes missions : la régulation, téléphonique ou non, et la détermination et l’orientation vers une offre de consultation (évaluation et accessibilité).
Ces responsabilités impliquent une légitimité et une autorité pour qu’il soit reconnu par tous. Il vaut mieux parler d’une fonction de coordination que d’un coordinateur unique.
L’évaluation conjointe psychiatre/psychologue pour porter l’indication d’une psychothérapie lorsque cette dernière est demandée à un psychologue (comme il est proposé dans le rapport) n’est pas sans poser des problèmes de mise en oeuvre. D’autres formules sont peut-être préférables : contrôle a posteriori, entente préalable avec le médecin/psychologue contrôleur de l’organisme payeur pour une durée et un nombre de séances définis. Compte tenu des demandes exponentielles de psychothérapie, on risquera d’observer une prolifération de consultations d’évaluation par des psychiatres déjà saturés, dont le nombre diminue.
Relevons que le risque d’une évaluation conjointe est aussi de faire porter par le médecin la responsabilité médicolégale du processus alors qu’il ne serait responsable que de l’indication (ou de la contre-indication).
Les auteurs du rapport proposent que l’assurance maladie ne prenne en charge que les psychothérapies qui relèvent du soin.
Cette affirmation risque de renforcer l’idée selon laquelle la psychothérapie pourrait relever du confort et du social. Un financement conjoint des psychothérapies par l’assurance maladie et les mutuelles permettrait d’envisager des forfaitisations annuelles (ou pluriannuelles) de participation contractualisée entre les différents organismes payeurs (en vérifiant une répartition équitable ou en la modifiant a posteriori), pour ne pas avoir à “expertiser” chaque cas.
Au total, la question posée par la place de la psychothérapie dans le domaine des soins et de la santé, ne doit pas faire reculer sur l’importance de cet enjeu, mais attirer l’attention sur la complexité de ses répercussions.
"Proposer une information claire destinée au grand public"
Sur ce thème, à propos duquel des rapports antérieurs ont insisté avec justesse, l’état des lieux actuel est particulièrement éclairant et montre les difficultés à surmonter.
La psychiatrie se présente comme une boîte noire pour le grand public, mais également pour les professionnels. Parmi eux, tous ne font pas corps, les opinions, souvent doctrinaires, s’affrontent, ne permettant pas que soit dégagée une réponse suffisamment claire aux multiples questions qui traversent le champ des troubles mentaux. C’est le premier obstacle à un processus pertinent d’information continue, qui exige un minimum de consensus susceptible de fournir un thésaurus de référence aux professionnels de la communication.
Ce défaut conduit à l’impossibilité de mettre en place une formation à l’information en santé mentale qui s’impose, si l’on veut que le public reçoive une information validée. Cette situation explique en partie, mais elle est déterminante, les contradictions de l’information fournie au grand public, actuellement de faible qualité.
Élaborer une charte de communication avec les journalistes, construire des campagnes d’information, permettrait de lever certains obstacles et d’améliorer l’information, pour mieux communiquer.
“Réduire les inégalités de l’offre de soins en psychiatrie, donner un cadre propice à l’efficience, la proximité et la souplesse des soins, aidé par des leviers d’actions innovants”
“Réduire les disparités géographiques en optimisant l’offre de soins en psychiatrie par une meilleure coordination public/privé et sanitaire/médico-social au sein de chaque territoire de santé”.
“Conjuguer politique incitative et anticipation pour une répartition équilibrée en moyens humains sur le territoire”.
- La liberté géographique et sectorielle d’installation, le libre accès aux soins et l’augmentation des demandes, représentent desfacteurs aggravants de la situation actuelle. Succès et désorganisation se conjuguentpour saturer l’offre, notamment dans uncontexte de pénurie médicale prévisible dans les toutes prochaines années, mais déjà perceptible dans le service public et dans certaines zones rurales du territoire ou à la périphérie des mégapoles.
- Les rapporteurs proposent de maintenir une offre médicale suffisante en psychiatrie dans le secteur public, avec des propositions courageuses (6 ETP de médecins spécialistes par secteur).
L’augmentation du numerus clausus doit être conditionnelle ou fléchée, sinon elle ne fera qu’aggraver les inégalités, tout en faisant illusion. Les effets tardifs (+14 ans) d’une telle décision, même si elle est prise immédiatement, ne règlent en rien la situation actuelle de pénurie grave localisée qui doit, elle aussi, amener des réponses énergiques, (dérogations nationales au statut des PH, droit à l’expérimentation régionale) et immédiates, que le rapport évoque. L’Université (médicale comme non médicale) ne peut être exemptée d’une responsabilité d’aménagement du territoire pour des missions de santé publique, quitte à ce que le sanitaire cofinance une partie de la filière d’enseignement et de formation initiale à partir de postes médicaux budgétés et non pourvus.
Ce n’est donc pas seulement le postinternat, mais également l’internat qui doit être développé (ce qui suppose les postes d’enseignant en regard) et sur rémunéré dans les zones en pénurie. Cette mesure coûterait moins cher que de doubler, uniquement, le salaire des praticiens hospitaliers.
Il s’agit de faciliter “l’incubation” puis l’installation sur place de jeunes spécialistes.
Enfin, les auteurs du rapport parlent du recentrage de la psychiatrie sur ses missions spécifiques. Ce point mérite d’être développé car c’est un des enjeux des débats actuels.
Une telle réflexion devrait s’accompagner de la (re)définition de la place et du rôle du médecin psychiatre, dans le service public mais aussi ailleurs, comme facteur de modification de l’équilibre entre les différentes professions de santé et leurs fonctions respectives.
Selon les auteurs du rapport, le maintien du nombre de psychiatres est un préalable à la recherche de l’optimisation de l’offre de soins alors qu’il est rappelé, par ailleurs, que la France figure parmi les pays dont la densité en psychiatres est la plus élevée. Il propose par ailleurs d’engager une réflexion sur les missions de la psychiatrie.
Cette réflexion devrait, à notre avis, être conduite à un niveau national et porter sur le rôle propre du psychiatre au sein d’une équipe pluridisciplinaire (il s’agit d’une réflexion que des équipes, déjà confrontées à la pénurie médicale, ont engagée) et conduire à un objectif quantitatif plus proche de nos voisins occidentaux.
Nous partageons le souci, affirmé, d’une meilleure répartition de l’offre sur le territoire national. De nombreuses mesures incitatives de l’offre constituant une politique volontariste sont ainsi proposées. Mais leur mise en oeuvre ne peut s’effectuer, sans une (re)définition
des missions de service public prioritaires par rapport aux besoins et sans une réflexion sur la gestion de carrière des psychiatres hospitaliers.
La recherche d’une meilleure répartition des moyens ne peut faire, à notre avis l’économie d’une double démarche :
- fixer des clés de répartition, par région ou territoire, des moyens existants et projetés dans les années à venir, qui comprennent les moyens privés et publics et, surtout l’ensemble des ressources (personnels médicaux, soignants, éducatifs, sociaux) qui concourent à la prise en charge des patients ;
- évaluer, dans le même temps, les ressources nécessaires à la mise en oeuvre des missions de base (confiées à une équipe) sur un territoire donné.
L’ensemble des mesures visant à encourager l’implantation des psychiatres dans les zones défavorisées devrait s’accompagner d’une modification de la gestion de carrière des praticiens hospitaliers. Il n’est pas certain, en effet, que la seule évolution démographique, par les départs à la retraite, suffise à créer les opportunités de mobilité indispensables pour rendre acceptables des mesures incitant, même fortement, à s’installer dans des territoires isolés et dotés de peu de moyens, où les conditions de travail sont plus difficiles. Le critère de mobilité, qui a longtemps été la contrainte et l’honneur du corps des psychiatres des hôpitaux, devenus praticiens hospitaliers, pourrait être (ré)introduit, au moins au niveau de la région, dans le déroulement de carrière.
"Harmoniser l’organisation au sein du territoire de santé pour rendre la psychiatrie plus accessible."
Après avoir défini les conditions du maintien du nombre de psychiatres et celles d’une meilleure répartition, les auteurs du rapport proposent d’encourager l’organisation fédérative des secteurs en liaison avec le dispositif libéral, à l’échelon du “territoire de santé”, ce qui correspond à une population d’environ 200 000 habitants, pour garantir l’organisation de la permanence des soins.
Rappelons que l’ordonnance de simplification administrative a supprimé, pour l’avenir, la possibilité de créer des communautés d’établissements, des réseaux coopératifs de santé et des syndicats inter hospitaliers.
Les nouvelles modalités de coopération sanitaire seront la convention, le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) et le réseau de soins. Le GCS n’est plus limité aux seuls établissements de santé (la présence d’au moins un établissement est cependant requise). Le GCS pourra intégrer des établissements médico-sociaux ainsi que des médecins libéraux ou tout autre professionnel ou organisme de santé. Il peut avoir la qualité d’employeur de personnel non médical. Le GCS n’est pas un établissement de santé mais peut assurer les missions d’un établissement et détenir, le cas échéant, des autorisations. Aussi, en ce qu’il pourra servir de support à un réseau ou y participer, le GCS nous paraît devoir être privilégié dans la mise en oeuvre des collaborations entre les différents partenaires à l’échelle du territoire de santé.
Dans un contexte d’évolution du dispositif sectoriel, cette structure juridique de coopération (sur laquelle nous ne disposons pas, par ailleurs, de retour d’expérience), permettrait de promouvoir l’intersectorialité voire d’envisager, de manière expérimentale dans un premier temps (cf. les expériences de syndicat inter hospitalier), la constitution en GCS comme règle d’organisation et d’allocation de ressources. Il s’agit de rompre avec établissements hospitaliers ici spécialisés qui, au fil des opportunités, dégagent, ou non, des ressources au bénéfice d’organisations ou d’activités intersectorielles.
Dans cet ordre d’idées, il serait intéressant de substituer au financement des programmes spécifiques (qui privent trop souvent le secteur des moyens pour remplir sa mission) via l’hôpital, un financement via les GCS.
Le rapport propose la mise en oeuvre d’une “organisation fédérative” et la création d’une “commission territoriale de psychiatrie et de santé mentale” rattachée au conseil sanitaire de secteur, chargée d’élaborer un projet médical de territoire auprès du conseil sanitaire de secteur et d’animer cette fédération d’offre de soins.
On se souvient des débats animés qui avaient accompagné une proposition analogue figurant dans le rapport Piel-Roelandt (“service territorialisé de psychiatrie”). Certains y avaient vu la chronique annoncée de la disparition du secteur de psychiatrie et donc la rupture avec la politique du même nom.
D’autres, au sein de la MNASM, y avaient vu, paradoxalement, le risque d’enfermer la psychiatrie dans des composantes certes plus élargies, mais psychiatrico-psychiatriques, au risque d’exclure un processus dynamique d’intégration à la médecine et à la communauté (cf. le numéro de Pluriels n°28). Ces risques existent toujours.
Il n’est pas certain que la création d’une nouvelle instance, dés lors qu’elle est distincte de celles qui vont émerger dans le nouveau paysage de commissions et comités proposés, tant dans l’ordonnance de simplification administrative que dans le projet de loi relatif à la politique de santé publique, facilite l’intégration des problématiques propres à la santé mentale dans les divers champs sanitaire, social et médico-social. La multiplication des commissions ne constitue pas, même si elle peut contribuer à faciliter ou imposer le repérage, un facteur de cohérence dans l’action avec les partenaires, surtout lorsqu’ils sont également co-financeurs,
D’ores et déjà, l’ordonnance de simplification administrative a supprimé la carte sanitaire au profit d’une définition plus large de l’offre de soins (de la prévention aux soins curatifs et palliatifs), en tenant compte de l’articulation avec la médecine de ville, comme avec le secteur médico-social. Elle a confirmé l’intégration du SROS de psychiatrie au SROS général, la suppression des secteurs sanitaires et le maintien des secteurs psychiatriques.
Le niveau régional comme échelon territorial pertinent pour la définition et la mise en oeuvre des politiques de santé publique.
Le nouveau comité régional de santé publique (cf projet de loi de santé publique) sera chargé de la coordination des stratégies et des actions des différents partenaires.
Les programmes définis par lui, seraient regroupés dans un plan régional de santé publique dont la mise en oeuvre serait assurée par le nouveau groupement régional de santé publique. Il ne faudrait pas que la taille régionale du territoire, seule pertinente pour les programmes macro-sociaux que sont les politiques publiques, limite ou dissolve l’existence de micro-politiques de proximité, à taille humaine, où les interlocuteurs se connaissent, et que continue à traduire la politique de secteur.
En même temps, on ne peut qu’encourager une organisation fédérative souple et ouverte, subdivision fonctionnelle spécialisée au sein d’un ensemble d’actions sanitaires, sociales, médico-sociales à l’échelle du territoire de santé.
b[“Les complémentarités public-privé”
Les auteurs estiment qu’il est nécessaire de lever les obstacles juridiques et financiers au développement des alternatives à l’hospitalisation des établissements privés.
La recherche d’une meilleure optimisation des ressources existantes entre secteur public et secteur privé répond à la nécessité d’assurer une répartition des moyens, des missions et des charges de chacun des deux secteurs, à partir du constat que la contribution des uns et des autres aux orientations fixées par les pouvoirs publics, ces dernières années, avait été supportée inégalement.
Ces propositions concernant l’hospitalisation privée doivent être retenues si l’on veut avancer dans cette voie. Il nous apparaît cependant nécessaire de rappeler, comme préalable, que le financement du secteur privé est mutualisé par les mêmes fonds que le secteur public. L’action commune du public et du privé doit donc s’inscrire à travers de vraies complémentarités, pour remplir des missions de santé publique et répondre aux besoins des patients qui ne sont pas assumés aujourd’hui. Il faut éviter de reproduire, purement et simplement, des activités ou des unités strictement identiques à celles du secteur public, la possibilité d’une “revisitation” des concepts étant fournie à cette occasion, les contraintes et les objectifs restant les mêmes. Développer l’hospitalisation de nuit, de jour ou même des CMP, des CATTP, des unités d’hospitalisation, de post-urgence ou pour des patients sous contrainte, certes, mais en se donnant la possibilité d’innovations et de coopérations originales, de manière telle que cette occasion n’introduise pas une addition répétitive et homéostatique, ajoutant un peu plus de la même situation pour les patients, alors que les ressources sont de plus en plus contraintes. Élargir au privé, c’est développer l’ambulatoire en système ouvert, ce n’est pas uniquement continuer à faire de l’institutionnel dans la tradition.
Les rapporteurs proposent que les praticiens hospitaliers soient statutairement affectés dans des établissements médico-sociaux pour adultes handicapés, et prévoient que tous les établissements médico-sociaux aient l’obligation de passer convention avec un établissement de santé, pour l’organisation de leur couverture médicale.
Ces propositions vont dans le sens, hautement souhaitable d’une véritable psychiatrie de liaison dans le secteur médico-social des adultes handicapés touché par une démédicalisation avancée (proposition constante de la Mission Nationale d’Appui lors de ses interventions sur site).
“Concilier proximité, qualité et moyens financiers pour une prise en charge plus efficiente”.
“Donner au ‘CMP – Ressource Territorial’ (CMP-RT) le rôle pivot du territoire de santé en psychiatrie et santé mentale”.
Les rapporteurs rappellent la circulaire du 14 mars 1990 situant le Centre Médico Psychologique (CMP) de secteur comme pivot des soins qui appelle à une véritable bascule de l’intra vers l’extrahospitalier. Ils proposent la création d’un CMP coordinateur, intitulé “CMP Ressource Territorial” chargé de coordonner les interventions des différents partenaires, siège d’une structure d’accueil, d’information et d’orientation, ouverte 6 jours sur 7.
Ceci implique, à notre avis, de relier les fonctions d’un centre ressources et de régulation/ permanence de la réponse, et de ne pas les séparer de la fonction de coordination identifiable que nous préférons à celle de coordinateur ou de structure fixe identifiés.
Depuis longtemps, la psychiatrie publique n’est plus en situation de monopole, ce qui doit se refléter dans une organisation coordonnée où la place de pivot peut varier en fonction des contextes, des cultures et des ressources locales : CMP pivot d’un territoire de santé comme le stipule le rapport d’étape, fonction tournante d’un CMP à un autre à des conditions rigoureuses, cabinet ou clinique privée coordonnateurs, fonction remplie par une équipe mobile identifiée du territoire de santé, fonction assurée au sein des ressources des urgences du SAU, ou encore via le SAMU Centre 15, etc.
Outre la difficulté qu’il y aurait à financer si cette structure venait à se rajouter au dispositif existant, il n’est pas sûr que la réponse à la continuité des soins et à la proximité réside dans la création d’un niveau supplémentaire, intermédiaire, de régulation.
En revanche, si l’idée de la constitution d’un GCS devait être retenue, nous partageons l’avis des auteurs sur la nécessité de veiller à une information, une disponibilité, une continuité et une proximité accrues. Cela nous paraît plus opérationnel, moins coûteux et plus intégratif si le niveau de participation de chaque partenaire à ces missions de coordination, sous des formes variables et acceptables (cf. supra) est défini au sein du GCS.
“Soutenir l’effort de rapprochement des unités d’hospitalisation dans la cité et faire respecter le niveau requis de qualité et de sécurité dans l’accueil psychiatrique”.
Cette proposition du rapport mérite d’être discutée :
Qu’est-ce qu’une hospitalisation “proche”, dans la pratique ? Maison Blanche, à Neuilly sur Marne, n’est qu’à 12 km des secteurs de Paris desservis, mais les familles qui viennent en transport en commun mettent une heure et demie uniquement pour l’aller, sans compter le coût financier du déplacement. À l’inverse, à Bélair (Ardennes), à Navarre (Eure), au Havre, à Aix, à La Rochelle, pour ne pas parler de Sainte-Anne à Paris, une vingtaine de CHS ou des implantations importantes rattachées à un centre hospitalier général, sont situés dans l’agglomération principale, ce qui n’empêche nullement de nombreux patients de refuser, avec la dernière énergie, pour ceux qui ont vraiment le choix, “d’aller en psychiatrie”. L’éloignement, c’est aussi la stigmatisation dans une structure ad hoc qui permet de construire socialement, familialement et personnellement, une identité de “fou” confrontée à des réponses promiscuitaires et une hôtellerie trop souvent dégradée.
Le contraire d’une erreur n’est pas, nécessairement, une bonne idée. La pénurie médicale, si elle se combine au principe de rattachement de la psychiatrie avecun hôpital général (c’est la bonne idée), lorsque le secteur est unique (c’est la mauvaise), conduit à jeter le bébé avec l’eau du bain et à privilégier, dans la pratique, le retour discutable vers le CHS de référence, éloigné ou non.
C’est ce qui est arrivé à Lillebonne, à Fécamp, à Vernon, à Sedan, c’est ce qui risque d’arriver à Bayeux, Vire, Lisieux, à Fourmies, etc. Citons le rapport de la MNASM à propos de l’Eure : “… Au lieu du développement de l’ambulatoire on assiste à une amplification relative de la réponse hospitalière, source d’aggravation de la crise, car la situation fait converger l’offre vers l’hôpital et la concentre sur un seul site. Au lieu du développement de soins de proximité, seuls susceptibles d’améliorer l’accès et de rompre avec la stigmatisation, des réponses hospitalières lointaines sont confortées. Quelle alternative propose le rapport ? : “Le transfert de la psychiatrie à l’hôpital général, justifié par le besoin de rapprochement avec le somatique, a trouvé ses limites”… Et, un peu plus loin : “la réflexion sur l’architecture de l’hospitalisation temps plein (et non sur le lieu d’implantation) est une vraie nécessité”.
Le dilemme principal est là : si une réflexion sur le périmètre de l’hospitalisation n’est pas engagée et tranchée tout en traitant la crise hospitalière de la psychiatrie (explosion des admissions, saturation des taux d’occupation, croissance rapide des hospitalisations sous contrainte, problèmes de violence et d’insécurité, etc.), des sommes énormes seront englouties dans une modernisation hospitalière légitime mais dont le contour aurait pu être limité, et qui ne serviront pas deux fois, au profit de l’ambulatoire, notamment.
Le rapport propose de poursuivre l’adaptation qualitative et quantitative de l’hospitalisation complète pour alléger la pression actuelle sur les lits et améliorer les conditions d’hospitalisation.
L’adaptation qualitative et quantitative de l’hospitalisation complète ( à moins qu’il ne s’agisse de préconiser tacitement d’augmenter le nombre de lits), ne peut être obtenue par le déploiement spontané d’un excédent observable (et d’ailleurs observé, actuellement, de moins en moins). Il sera accompli par un effort durable et douloureux imposant un changement actif de pratiques et d’organisation.
Si la pratique, dans le domaine des urgences et de l’ambulatoire ne se modifie pas, les équipements des SAU et les CMP/CATTP ne limiteront pas suffisamment le recours à l’hospitalisation. Si la conception de la place du traitement hospitalier et les pratiques qui en découlent, comme son rapport avec l’ambulatoire, ne changent pas, les séjours se raccourciront uniquement pour faire de la place et l’amplification des mécanismes de porte tournante, combinée à la pression générale vers l’hospitalisation, ne compenseront pas les effets du raccourcissement.
La diversification d’aval, médico-sociale, si elle est mise en place de façon respectueuse des besoins des patients qui en relèvent, représente un élément crucial qui constitue le premier levier résolutif de ce dilemme.
Elle est préconisée, à juste titre, par le rapport (cf. infra). Faute d’être mise en place rapidement et énergiquement, la pression sur les lits s’accroîtra, s’accompagnant de demandes de création de lits qui seront obtenues, même lorsque l’on aurait pu apporter d’autres solutions.
Les auteurs développent assez peu ce qui constitue un frein, tant financier que médical, aux changements attendus sur le terrain de la proximité, l’intégration de la psychiatrie aux dispositifs de soins généraux, à la réponse apportée aux besoins exprimés dans le champ de la santé mentale, à savoir le devenir des établissements psychiatriques éloignés de la population qu’ils desservent.
Cette question nous semble devoir faire l’objet d’une politique volontariste, notamment du fait de la crise que l’hôpital traverse aujourd’hui (cf. supra), que les enjeux financiers et la crise de la démographie médicale ne feront qu’amplifier.
La poursuite du développement des alternatives à l’hospitalisation par le redéploiement des lits “excédentaires” n’est qu’un des éléments de la politique à mettre en oeuvre. Il nous paraît pertinent d’y réfléchir à deux fois avant de proposer un ensemble de mesures visant à soutenir l’investissement des sites hospitaliers éloignés de la population desservie, pour des mises à niveau en matière de sécurité et d’hôtellerie souvent associées à des coûts logistiques importants.
L’objectif d’amélioration des conditions d’hébergement, particulièrement préoccupantes dans certains CHS et, à juste titre, dénoncées dans le rapport, doit rejoindre celui de la recherche d’une plus grande proximité.
Il est difficile de démontrer que le coût du maintien de ces structures dans des conditions correctes est inférieur, en définitive, à celui d’un investissement neuf, plus adapté du point de vue hôtelier comme de celui de la qualité de la réponse de proximité.
Aussi, nous défendons plutôt l’idée que le soutien dont doit bénéficier la psychiatrie doit résider d’une part, dans une avance sur investissement pour aider les hôpitaux qui le nécessitent à reconstruire des unités d’hospitalisations au plus près des patients dont ils ont la charge dans des environnements hospitaliers pérennes, tout en maintenant dans le même temps leur activité. Il s’agit, d’autre part, d’améliorer fortement les conditions d’existence matérielle et de fonctionnement des unités installées dans les hôpitaux généraux (situation qui concerne près de 60% des lits de pédopsychiatrie et environ 45% des lits de psychiatrie générale).
À ce titre, la question de l’implantation des lits à l’hôpital général, même si elle n’est pas un problème univoque, ne nous paraît pas avoir fait l’objet de développements suffisants dans le rapport, alors même que ce thème a été abordé dans le chapitre relatif aux coordinations et à la proximité.
Comme nous l’avons dit, les difficultés rencontrées lors de l’implantation de telles unités ne doivent pas conduire à l’abandon pur et simple de ce modèle. Il nous paraît important de mieux définir les conditions auxquelles une intégration, y compris graduée, serait réussie, d’autant plus que la pression croissante sur les temps médicaux risque de déplacer la masse critique médicale des CHS vers les CHG.
Rappelons les arguments qui plaident en faveur d’un tel rapprochement, et qui sont toujours valables : la moindre distance, et donc l’amélioration du confort lors du séjour du patient comme pour sa famille, la moindre stigmatisation de la psychiatrie, la possibilité de réponses graduées pour faciliter la sortie, le rapprochement avec les disciplines somatiques et l’accès à leur plateau technique pour une prise en charge plus globale, la mutualisation des coûts logistiques, la facilitation de la psychiatrie de liaison et de la réponses aux situations d’urgence, mixtes ou non.
“Garantir la permanence de l’offre de soins et une réponse systématique et adaptée à l’urgence psychiatrique”.
Une coordination forte d’une réponse psychiatrique ouverte, comportant l’assistance en cas de crise, en appui du réseau naturel, social ou sanitaire de première ligne (les généralistes), représente une des pistes susceptible de limiter le recours, programmé ou non, à la seconde ligne.
Nous pensons que le développement des urgences psychiatriques, pour aussi légitime qu’il soit, s’il n’appuie pas la première ligne sanitaire, construit une deuxième ligne spécialisée qui se transforme en première et amplifie le recours à l’urgence comme modalité habituelle d’entrée. D’où la nécessité de recourir en priorité à la première ligne alors qu’actuellement c’est l’inverse : la deuxième ligne, urgences hospitalières spécialisées ou non, est plus accessible et offre davantage de garanties générales d’appui que la première, ce qui la fait utiliser massivement.
À partir de la volonté, compréhensible, de limiter un effet mille-feuilles, très consommateur en ressources, les rapporteurs proposent d’implanter sur le site des CHS, le dispositif d’évaluation de post-urgence.
Nous proposons l’inverse : l’implantation à l’hôpital général. Mais, dans notre esprit, il existe une identité entre le protocole de 72 heures et l’existence d’UHCD dédiées, ou non, au sein des urgences, à la psychiatrie, ou par le biais d’un centre de crise adjacent au service des urgences. L’objectif d’une telle implantation de ces structures est double :
- stratégique, afin d’arrimer définitivement la psychiatrie d’urgence au MCO à travers cette organisation et de mettre fin à un développement séparé entre la psychiatrie et la médecine dont la France est l’un des derniers et plus résistants représentants, apartheid légitimé par les uns ou tacitement accepté par les autres,
- fonctionnel, au bénéfice des patients, des familles et du réseau de première ligne qui le réclament en général.
Le rapport d’étape propose que le “protocole de 72 heures” soit distinct de l’accueil aux urgences et puisse être intégré dans la réponse intra-hospitalière sous forme d’unité intersectorielle d’admission, d’hospitalisation de courte durée.
Nous pensons que cette UIA, en mélangeant les fonctions de centre d’accueil et de crise intersectoriel et d’admission au sein d’un hôpital psychiatrique n’est pas fonctionnel : une telle unité est appelée service d’urgence psychiatrique, mais elle ne prévient guère l’hospitalisation car celle-ci est imposée à la structure. Les nouveaux patients subissent un circuit long car ils se présentent, de toute façon, aux urgences de l’hôpital général mais ils sont, d’autant plus facilement, orientés vers le CHS que l’existence d’une UIA au sein de ce dernier précarise, ou rend moins “indispensable”, l’existence d’une réponse satisfaisante aux urgences de l’hôpital général.
Grâce à quoi, le MCO et la psychiatrie continuent à vivre leur existence séparée.
Le renforcement du dispositif d’urgence de première ligne que constituent les médecins généralistes nécessite d’être développé, notamment dans le cadre des coopérations qui doivent s’organiser entre partenaires sur le terrain.
Ce renforcement devra s’accompagner d’actions de formation, destinées aux psychiatres, et axées sur la maîtrise des flux d’entrée dans le dispositif de soins, des mesures de régulation en amont, aux urgences ou dans le tissu de soins primaires. Cette formation est indispensable.
Sauf à répondre à des cas particuliers, il ne semble pas que la solution de l’intégration dans les CHS doive être privilégiée, mais plutôt l’inverse. Si l’on garde l’objectif de prévenir l’hospitalisation, celui-ci s’initie dès l’entrée dans le dispositif. Il est beaucoup plus difficile à atteindre dés lors que le patient est présent à l’hôpital psychiatrique.
En contribuant à l’objectif de désinstitutionalisation, la régulation d’aval du dispositif contribue largement à réduire la pression sur les lits d’hospitalisation complète.
“Garantir la continuité des soins et de l’accompagnement social pour des alternatives à
l’hospitalisation, la mise en place de systèmes coordonnés et la mobilisation utile à la réinsertion”.
Le rapport d’étape recommande de procéder à une évaluation annuelle, par région, du nombre de patients hospitalisés en psychiatrie, qui y séjournent depuis plus d’un an et dont l’hospitalisation ne répond plus à un objectif thérapeutique.
La proposition de développer les alternatives et les actions en amont et en aval de l’hospitalisation prend l’hospitalisation complète comme référence.
Nous pensons que les opérateurs gagneraient à ne pas être psychiatriques, ni même sanitaires.
La question de la réinsertion devrait inclure une réflexion sur la prise en charge précoce des psychoses, après le premier épisode aigu, et la prévention secondaire, pour empêcher ou limiter une désinsertion durable.
Beaucoup de parcours invalidants des schizophrènes trouvent leur source dans une prévention limitée de ces situations.
Sur la réinsertion proprement dite, on doit constater que la psychiatrie a fait peu, tard, et de façon souvent inappropriée. Ce domaine est à l’intersection d’une activité sanitaire (pas seulement psychiatrique) départementale ou régionale, très technique, d’évaluation brève, qui peut également s’effectuer en ambulatoire ou en centre de jour, et d’autres actions locales coordonnées, non psychiatriques et non sanitaires qui, elles, doivent être menées par des acteurs du champ social et du travail normal ou protégé, avec l’appui d’une équipe fixe ou mobile de psychiatrie de liaison qui a acquis ou développé une compétence spécifique. Ces dernières actions doivent être ambulatoires même si doivent y participer des patients hospitalisés. Comment s’entraîner à une vie ou à une activité normales dans un contexte aussi peu approprié qu’un hôpital ou un service psychiatrique ?
Le rapport propose de développer la création de MAS.
La nécessité pour les CHS de maintenir une activité sur leur site a souvent entraîné la création de MAS ou d’autres réponses d’accueil protégé.
Nos observations nous poussent à recommander une externalisation systématique dans la cité, une graduation entre des réponses individuelles, semi-collectives ou collectives, mais à taille humaine (10-15 places au maximum), un opérateur indépendant de la psychiatrie et du sanitaire même s’il en reçoit, contractuellement, des prestations importantes.
Si cette création est bénéfique aux patients; son financement, par une partie des moyens hospitaliers redéployés correspondant, ne doit pas priver l’hôpital des moyens nécessaires à la modernisation des structures ni surtout au développement des alternatives.
Pour autant, la création de places supplémentaires dans ces structures d’accueil protégé est indispensable et appelle, bien évidemment des financements supplémentaires.
“Multiplier les partenariats avec les acteurs directs et indirects, afin d’organiser une complémentarité indispensable dans le cas des personnes atteintes d’un handicap psychique”.
Le constat est unanimement partagé : les personnes qui se trouvent en situation de handicap du fait de troubles psychiques graves et persistants ne trouvent pas, actuellement, les réponses adaptées à leurs besoins en termes d’insertion sociale et professionnelle, en complément des soins qui doivent continuer à leur être prodigués et en bonne articulation avec ceux-ci.
Face à cette situation, les pouvoirs publics préconisent un dépassement des frontières entre les secteurs sanitaire et médico-social, en levant les obstacles juridiques à une prise en charge conjointe.
La reconnaissance de la notion de handicap psychique représente un tournant primordial.
Les rapporteurs avancent, pour ces personnes, un ensemble de mesures qui concourent à l’amélioration de la qualité de leur vie et de leur statut social, qu’il conviendra de rapprocher de celles proposées dans le cadre du Plan Handicap. Une telle reconnaissance favorise bien entendu, une meilleure insertion sociale des handicapés.
Cette orientation récente des politiques publiques dans le domaine de la santé mentale n’aurait pas été possible sans la lente émergence du concept, porté initialement par les associations de familles de malades mentaux c’est à dire l’UNAFAM, et des associations d’usagers, dans l’objectif, tout à fait explicite, de “faire exister une population” et, corrélativement, d’apporter des solutions à leurs besoins, en les différenciant de celle des déficients intellectuels.
Dans le langage commun, le terme de handicap présente le lourd inconvénient d’induire une vision réductrice de stabilité de situation qui ne s’adapte pas au parcours, aux formes très variables, de ces personnes, même si elles auront recours durablement au système de santé. Le terme de handicap traduit cependant les difficultés qu’elles rencontrent dans leur accès à différents biens ou ressources, en l’occurrence l’insertion sociale et professionnelle, difficultés que la société réduit avec l’émergence du droit à compensation.
La dénomination la moins inappropriée pour définir cette population est bien celle de personnes qui se trouvent en situation de handicap du fait de troubles psychiques graves et persistants. Handicap psychique est un terme utilisé par commodité mais également parce qu’il s’impose de plus en plus, malgré l’opposition de ceux qui y voient une volonté de négation de la maladie mentale ou bien des raisons exclusivement économiques tendant à restreindre le champ de la psychiatrie.
La personne handicapée psychique continue d’être une personne malade qui supporte encore un désavantage social du fait de ses troubles mentaux. Sa maladie lui donne droit aux soins, et son handicap à une protection sociale permettant de le compenser au mieux, afin de garantir une vie la plus proche possible de la normale.
Tous les projets d’accompagnement des personnes handicapées psychiques doivent donc comporter les deux dimensions : sanitaire et sociale. Malgré le cadre budgétaire contraint dans lequel les dépenses consacrées aux différentes activités de soin et de prévention évoluent, on notera la permanence, ces dernières années, de la volonté des pouvoirs publics de soutenir les projets et les actions visant à l’insertion professionnelle de ces personnes .
“La définition d’un cadre partenarial entre le secteur sanitaire et le secteur médicosocial”
nous semble, comme aux rapporteurs, indispensable même si elle ne règle pas, au fond, la question de l’origine du financement.
Affirmer la nécessité du maintien des moyens indispensables au fonctionnement de la psychiatrie peut contredire la volonté affichée de participer au financement de structures médico-sociales et sousentendre la possibilité de les créer ex nihilo.
Il restera, par ailleurs, à définir les modalités d’articulation entre les nouveaux “Comité Régional d’Organisation Sanitaire” et “Comité Régional d’Organisation Social et Médico-social” nés de la division de l’ancien CROS, dans l’ordonnance de simplification administrative.
“Conjuguer politique incitative et anticipation pour une répartition équilibrée en moyens humains sur le territoire”.
- La liberté géographique et sectorielle d’installation, le libre accès aux soins et l’augmentation des demandes, représentent desfacteurs aggravants de la situation actuelle. Succès et désorganisation se conjuguentpour saturer l’offre, notamment dans uncontexte de pénurie médicale prévisible dans les toutes prochaines années, mais déjà perceptible dans le service public et dans certaines zones rurales du territoire ou à la périphérie des mégapoles.
- Les rapporteurs proposent de maintenir une offre médicale suffisante en psychiatrie dans le secteur public, avec des propositions courageuses (6 ETP de médecins spécialistes par secteur).
L’augmentation du numerus clausus doit être conditionnelle ou fléchée, sinon elle ne fera qu’aggraver les inégalités, tout en faisant illusion. Les effets tardifs (+14 ans) d’une telle décision, même si elle est prise immédiatement, ne règlent en rien la situation actuelle de pénurie grave localisée qui doit, elle aussi, amener des réponses énergiques, (dérogations nationales au statut des PH, droit à l’expérimentation régionale) et immédiates, que le rapport évoque. L’Université (médicale comme non médicale) ne peut être exemptée d’une responsabilité d’aménagement du territoire pour des missions de santé publique, quitte à ce que le sanitaire cofinance une partie de la filière d’enseignement et de formation initiale à partir de postes médicaux budgétés et non pourvus.
Ce n’est donc pas seulement le postinternat, mais également l’internat qui doit être développé (ce qui suppose les postes d’enseignant en regard) et sur rémunéré dans les zones en pénurie. Cette mesure coûterait moins cher que de doubler, uniquement, le salaire des praticiens hospitaliers.
Il s’agit de faciliter “l’incubation” puis l’installation sur place de jeunes spécialistes.
Enfin, les auteurs du rapport parlent du recentrage de la psychiatrie sur ses missions spécifiques. Ce point mérite d’être développé car c’est un des enjeux des débats actuels.
Une telle réflexion devrait s’accompagner de la (re)définition de la place et du rôle du médecin psychiatre, dans le service public mais aussi ailleurs, comme facteur de modification de l’équilibre entre les différentes professions de santé et leurs fonctions respectives.
Selon les auteurs du rapport, le maintien du nombre de psychiatres est un préalable à la recherche de l’optimisation de l’offre de soins alors qu’il est rappelé, par ailleurs, que la France figure parmi les pays dont la densité en psychiatres est la plus élevée. Il propose par ailleurs d’engager une réflexion sur les missions de la psychiatrie.
Cette réflexion devrait, à notre avis, être conduite à un niveau national et porter sur le rôle propre du psychiatre au sein d’une équipe pluridisciplinaire (il s’agit d’une réflexion que des équipes, déjà confrontées à la pénurie médicale, ont engagée) et conduire à un objectif quantitatif plus proche de nos voisins occidentaux.
Nous partageons le souci, affirmé, d’une meilleure répartition de l’offre sur le territoire national. De nombreuses mesures incitatives de l’offre constituant une politique volontariste sont ainsi proposées. Mais leur mise en oeuvre ne peut s’effectuer, sans une (re)définition
des missions de service public prioritaires par rapport aux besoins et sans une réflexion sur la gestion de carrière des psychiatres hospitaliers.
La recherche d’une meilleure répartition des moyens ne peut faire, à notre avis l’économie d’une double démarche :
- fixer des clés de répartition, par région ou territoire, des moyens existants et projetés dans les années à venir, qui comprennent les moyens privés et publics et, surtout l’ensemble des ressources (personnels médicaux, soignants, éducatifs, sociaux) qui concourent à la prise en charge des patients ;
- évaluer, dans le même temps, les ressources nécessaires à la mise en oeuvre des missions de base (confiées à une équipe) sur un territoire donné.
L’ensemble des mesures visant à encourager l’implantation des psychiatres dans les zones défavorisées devrait s’accompagner d’une modification de la gestion de carrière des praticiens hospitaliers. Il n’est pas certain, en effet, que la seule évolution démographique, par les départs à la retraite, suffise à créer les opportunités de mobilité indispensables pour rendre acceptables des mesures incitant, même fortement, à s’installer dans des territoires isolés et dotés de peu de moyens, où les conditions de travail sont plus difficiles. Le critère de mobilité, qui a longtemps été la contrainte et l’honneur du corps des psychiatres des hôpitaux, devenus praticiens hospitaliers, pourrait être (ré)introduit, au moins au niveau de la région, dans le déroulement de carrière.
"Harmoniser l’organisation au sein du territoire de santé pour rendre la psychiatrie plus accessible."
Après avoir défini les conditions du maintien du nombre de psychiatres et celles d’une meilleure répartition, les auteurs du rapport proposent d’encourager l’organisation fédérative des secteurs en liaison avec le dispositif libéral, à l’échelon du “territoire de santé”, ce qui correspond à une population d’environ 200 000 habitants, pour garantir l’organisation de la permanence des soins.
Rappelons que l’ordonnance de simplification administrative a supprimé, pour l’avenir, la possibilité de créer des communautés d’établissements, des réseaux coopératifs de santé et des syndicats inter hospitaliers.
Les nouvelles modalités de coopération sanitaire seront la convention, le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) et le réseau de soins. Le GCS n’est plus limité aux seuls établissements de santé (la présence d’au moins un établissement est cependant requise). Le GCS pourra intégrer des établissements médico-sociaux ainsi que des médecins libéraux ou tout autre professionnel ou organisme de santé. Il peut avoir la qualité d’employeur de personnel non médical. Le GCS n’est pas un établissement de santé mais peut assurer les missions d’un établissement et détenir, le cas échéant, des autorisations. Aussi, en ce qu’il pourra servir de support à un réseau ou y participer, le GCS nous paraît devoir être privilégié dans la mise en oeuvre des collaborations entre les différents partenaires à l’échelle du territoire de santé.
Dans un contexte d’évolution du dispositif sectoriel, cette structure juridique de coopération (sur laquelle nous ne disposons pas, par ailleurs, de retour d’expérience), permettrait de promouvoir l’intersectorialité voire d’envisager, de manière expérimentale dans un premier temps (cf. les expériences de syndicat inter hospitalier), la constitution en GCS comme règle d’organisation et d’allocation de ressources. Il s’agit de rompre avec établissements hospitaliers ici spécialisés qui, au fil des opportunités, dégagent, ou non, des ressources au bénéfice d’organisations ou d’activités intersectorielles.
Dans cet ordre d’idées, il serait intéressant de substituer au financement des programmes spécifiques (qui privent trop souvent le secteur des moyens pour remplir sa mission) via l’hôpital, un financement via les GCS.
Le rapport propose la mise en oeuvre d’une “organisation fédérative” et la création d’une “commission territoriale de psychiatrie et de santé mentale” rattachée au conseil sanitaire de secteur, chargée d’élaborer un projet médical de territoire auprès du conseil sanitaire de secteur et d’animer cette fédération d’offre de soins.
On se souvient des débats animés qui avaient accompagné une proposition analogue figurant dans le rapport Piel-Roelandt (“service territorialisé de psychiatrie”). Certains y avaient vu la chronique annoncée de la disparition du secteur de psychiatrie et donc la rupture avec la politique du même nom.
D’autres, au sein de la MNASM, y avaient vu, paradoxalement, le risque d’enfermer la psychiatrie dans des composantes certes plus élargies, mais psychiatrico-psychiatriques, au risque d’exclure un processus dynamique d’intégration à la médecine et à la communauté (cf. le numéro de Pluriels n°28). Ces risques existent toujours.
Il n’est pas certain que la création d’une nouvelle instance, dés lors qu’elle est distincte de celles qui vont émerger dans le nouveau paysage de commissions et comités proposés, tant dans l’ordonnance de simplification administrative que dans le projet de loi relatif à la politique de santé publique, facilite l’intégration des problématiques propres à la santé mentale dans les divers champs sanitaire, social et médico-social. La multiplication des commissions ne constitue pas, même si elle peut contribuer à faciliter ou imposer le repérage, un facteur de cohérence dans l’action avec les partenaires, surtout lorsqu’ils sont également co-financeurs,
D’ores et déjà, l’ordonnance de simplification administrative a supprimé la carte sanitaire au profit d’une définition plus large de l’offre de soins (de la prévention aux soins curatifs et palliatifs), en tenant compte de l’articulation avec la médecine de ville, comme avec le secteur médico-social. Elle a confirmé l’intégration du SROS de psychiatrie au SROS général, la suppression des secteurs sanitaires et le maintien des secteurs psychiatriques.
Le niveau régional comme échelon territorial pertinent pour la définition et la mise en oeuvre des politiques de santé publique.
Le nouveau comité régional de santé publique (cf projet de loi de santé publique) sera chargé de la coordination des stratégies et des actions des différents partenaires.
Les programmes définis par lui, seraient regroupés dans un plan régional de santé publique dont la mise en oeuvre serait assurée par le nouveau groupement régional de santé publique. Il ne faudrait pas que la taille régionale du territoire, seule pertinente pour les programmes macro-sociaux que sont les politiques publiques, limite ou dissolve l’existence de micro-politiques de proximité, à taille humaine, où les interlocuteurs se connaissent, et que continue à traduire la politique de secteur.
En même temps, on ne peut qu’encourager une organisation fédérative souple et ouverte, subdivision fonctionnelle spécialisée au sein d’un ensemble d’actions sanitaires, sociales, médico-sociales à l’échelle du territoire de santé.
b[“Les complémentarités public-privé”
Les auteurs estiment qu’il est nécessaire de lever les obstacles juridiques et financiers au développement des alternatives à l’hospitalisation des établissements privés.
La recherche d’une meilleure optimisation des ressources existantes entre secteur public et secteur privé répond à la nécessité d’assurer une répartition des moyens, des missions et des charges de chacun des deux secteurs, à partir du constat que la contribution des uns et des autres aux orientations fixées par les pouvoirs publics, ces dernières années, avait été supportée inégalement.
Ces propositions concernant l’hospitalisation privée doivent être retenues si l’on veut avancer dans cette voie. Il nous apparaît cependant nécessaire de rappeler, comme préalable, que le financement du secteur privé est mutualisé par les mêmes fonds que le secteur public. L’action commune du public et du privé doit donc s’inscrire à travers de vraies complémentarités, pour remplir des missions de santé publique et répondre aux besoins des patients qui ne sont pas assumés aujourd’hui. Il faut éviter de reproduire, purement et simplement, des activités ou des unités strictement identiques à celles du secteur public, la possibilité d’une “revisitation” des concepts étant fournie à cette occasion, les contraintes et les objectifs restant les mêmes. Développer l’hospitalisation de nuit, de jour ou même des CMP, des CATTP, des unités d’hospitalisation, de post-urgence ou pour des patients sous contrainte, certes, mais en se donnant la possibilité d’innovations et de coopérations originales, de manière telle que cette occasion n’introduise pas une addition répétitive et homéostatique, ajoutant un peu plus de la même situation pour les patients, alors que les ressources sont de plus en plus contraintes. Élargir au privé, c’est développer l’ambulatoire en système ouvert, ce n’est pas uniquement continuer à faire de l’institutionnel dans la tradition.
Les rapporteurs proposent que les praticiens hospitaliers soient statutairement affectés dans des établissements médico-sociaux pour adultes handicapés, et prévoient que tous les établissements médico-sociaux aient l’obligation de passer convention avec un établissement de santé, pour l’organisation de leur couverture médicale.
Ces propositions vont dans le sens, hautement souhaitable d’une véritable psychiatrie de liaison dans le secteur médico-social des adultes handicapés touché par une démédicalisation avancée (proposition constante de la Mission Nationale d’Appui lors de ses interventions sur site).
“Concilier proximité, qualité et moyens financiers pour une prise en charge plus efficiente”.
“Donner au ‘CMP – Ressource Territorial’ (CMP-RT) le rôle pivot du territoire de santé en psychiatrie et santé mentale”.
Les rapporteurs rappellent la circulaire du 14 mars 1990 situant le Centre Médico Psychologique (CMP) de secteur comme pivot des soins qui appelle à une véritable bascule de l’intra vers l’extrahospitalier. Ils proposent la création d’un CMP coordinateur, intitulé “CMP Ressource Territorial” chargé de coordonner les interventions des différents partenaires, siège d’une structure d’accueil, d’information et d’orientation, ouverte 6 jours sur 7.
Ceci implique, à notre avis, de relier les fonctions d’un centre ressources et de régulation/ permanence de la réponse, et de ne pas les séparer de la fonction de coordination identifiable que nous préférons à celle de coordinateur ou de structure fixe identifiés.
Depuis longtemps, la psychiatrie publique n’est plus en situation de monopole, ce qui doit se refléter dans une organisation coordonnée où la place de pivot peut varier en fonction des contextes, des cultures et des ressources locales : CMP pivot d’un territoire de santé comme le stipule le rapport d’étape, fonction tournante d’un CMP à un autre à des conditions rigoureuses, cabinet ou clinique privée coordonnateurs, fonction remplie par une équipe mobile identifiée du territoire de santé, fonction assurée au sein des ressources des urgences du SAU, ou encore via le SAMU Centre 15, etc.
Outre la difficulté qu’il y aurait à financer si cette structure venait à se rajouter au dispositif existant, il n’est pas sûr que la réponse à la continuité des soins et à la proximité réside dans la création d’un niveau supplémentaire, intermédiaire, de régulation.
En revanche, si l’idée de la constitution d’un GCS devait être retenue, nous partageons l’avis des auteurs sur la nécessité de veiller à une information, une disponibilité, une continuité et une proximité accrues. Cela nous paraît plus opérationnel, moins coûteux et plus intégratif si le niveau de participation de chaque partenaire à ces missions de coordination, sous des formes variables et acceptables (cf. supra) est défini au sein du GCS.
“Soutenir l’effort de rapprochement des unités d’hospitalisation dans la cité et faire respecter le niveau requis de qualité et de sécurité dans l’accueil psychiatrique”.
Cette proposition du rapport mérite d’être discutée :
Qu’est-ce qu’une hospitalisation “proche”, dans la pratique ? Maison Blanche, à Neuilly sur Marne, n’est qu’à 12 km des secteurs de Paris desservis, mais les familles qui viennent en transport en commun mettent une heure et demie uniquement pour l’aller, sans compter le coût financier du déplacement. À l’inverse, à Bélair (Ardennes), à Navarre (Eure), au Havre, à Aix, à La Rochelle, pour ne pas parler de Sainte-Anne à Paris, une vingtaine de CHS ou des implantations importantes rattachées à un centre hospitalier général, sont situés dans l’agglomération principale, ce qui n’empêche nullement de nombreux patients de refuser, avec la dernière énergie, pour ceux qui ont vraiment le choix, “d’aller en psychiatrie”. L’éloignement, c’est aussi la stigmatisation dans une structure ad hoc qui permet de construire socialement, familialement et personnellement, une identité de “fou” confrontée à des réponses promiscuitaires et une hôtellerie trop souvent dégradée.
Le contraire d’une erreur n’est pas, nécessairement, une bonne idée. La pénurie médicale, si elle se combine au principe de rattachement de la psychiatrie avecun hôpital général (c’est la bonne idée), lorsque le secteur est unique (c’est la mauvaise), conduit à jeter le bébé avec l’eau du bain et à privilégier, dans la pratique, le retour discutable vers le CHS de référence, éloigné ou non.
C’est ce qui est arrivé à Lillebonne, à Fécamp, à Vernon, à Sedan, c’est ce qui risque d’arriver à Bayeux, Vire, Lisieux, à Fourmies, etc. Citons le rapport de la MNASM à propos de l’Eure : “… Au lieu du développement de l’ambulatoire on assiste à une amplification relative de la réponse hospitalière, source d’aggravation de la crise, car la situation fait converger l’offre vers l’hôpital et la concentre sur un seul site. Au lieu du développement de soins de proximité, seuls susceptibles d’améliorer l’accès et de rompre avec la stigmatisation, des réponses hospitalières lointaines sont confortées. Quelle alternative propose le rapport ? : “Le transfert de la psychiatrie à l’hôpital général, justifié par le besoin de rapprochement avec le somatique, a trouvé ses limites”… Et, un peu plus loin : “la réflexion sur l’architecture de l’hospitalisation temps plein (et non sur le lieu d’implantation) est une vraie nécessité”.
Le dilemme principal est là : si une réflexion sur le périmètre de l’hospitalisation n’est pas engagée et tranchée tout en traitant la crise hospitalière de la psychiatrie (explosion des admissions, saturation des taux d’occupation, croissance rapide des hospitalisations sous contrainte, problèmes de violence et d’insécurité, etc.), des sommes énormes seront englouties dans une modernisation hospitalière légitime mais dont le contour aurait pu être limité, et qui ne serviront pas deux fois, au profit de l’ambulatoire, notamment.
Le rapport propose de poursuivre l’adaptation qualitative et quantitative de l’hospitalisation complète pour alléger la pression actuelle sur les lits et améliorer les conditions d’hospitalisation.
L’adaptation qualitative et quantitative de l’hospitalisation complète ( à moins qu’il ne s’agisse de préconiser tacitement d’augmenter le nombre de lits), ne peut être obtenue par le déploiement spontané d’un excédent observable (et d’ailleurs observé, actuellement, de moins en moins). Il sera accompli par un effort durable et douloureux imposant un changement actif de pratiques et d’organisation.
Si la pratique, dans le domaine des urgences et de l’ambulatoire ne se modifie pas, les équipements des SAU et les CMP/CATTP ne limiteront pas suffisamment le recours à l’hospitalisation. Si la conception de la place du traitement hospitalier et les pratiques qui en découlent, comme son rapport avec l’ambulatoire, ne changent pas, les séjours se raccourciront uniquement pour faire de la place et l’amplification des mécanismes de porte tournante, combinée à la pression générale vers l’hospitalisation, ne compenseront pas les effets du raccourcissement.
La diversification d’aval, médico-sociale, si elle est mise en place de façon respectueuse des besoins des patients qui en relèvent, représente un élément crucial qui constitue le premier levier résolutif de ce dilemme.
Elle est préconisée, à juste titre, par le rapport (cf. infra). Faute d’être mise en place rapidement et énergiquement, la pression sur les lits s’accroîtra, s’accompagnant de demandes de création de lits qui seront obtenues, même lorsque l’on aurait pu apporter d’autres solutions.
Les auteurs développent assez peu ce qui constitue un frein, tant financier que médical, aux changements attendus sur le terrain de la proximité, l’intégration de la psychiatrie aux dispositifs de soins généraux, à la réponse apportée aux besoins exprimés dans le champ de la santé mentale, à savoir le devenir des établissements psychiatriques éloignés de la population qu’ils desservent.
Cette question nous semble devoir faire l’objet d’une politique volontariste, notamment du fait de la crise que l’hôpital traverse aujourd’hui (cf. supra), que les enjeux financiers et la crise de la démographie médicale ne feront qu’amplifier.
La poursuite du développement des alternatives à l’hospitalisation par le redéploiement des lits “excédentaires” n’est qu’un des éléments de la politique à mettre en oeuvre. Il nous paraît pertinent d’y réfléchir à deux fois avant de proposer un ensemble de mesures visant à soutenir l’investissement des sites hospitaliers éloignés de la population desservie, pour des mises à niveau en matière de sécurité et d’hôtellerie souvent associées à des coûts logistiques importants.
L’objectif d’amélioration des conditions d’hébergement, particulièrement préoccupantes dans certains CHS et, à juste titre, dénoncées dans le rapport, doit rejoindre celui de la recherche d’une plus grande proximité.
Il est difficile de démontrer que le coût du maintien de ces structures dans des conditions correctes est inférieur, en définitive, à celui d’un investissement neuf, plus adapté du point de vue hôtelier comme de celui de la qualité de la réponse de proximité.
Aussi, nous défendons plutôt l’idée que le soutien dont doit bénéficier la psychiatrie doit résider d’une part, dans une avance sur investissement pour aider les hôpitaux qui le nécessitent à reconstruire des unités d’hospitalisations au plus près des patients dont ils ont la charge dans des environnements hospitaliers pérennes, tout en maintenant dans le même temps leur activité. Il s’agit, d’autre part, d’améliorer fortement les conditions d’existence matérielle et de fonctionnement des unités installées dans les hôpitaux généraux (situation qui concerne près de 60% des lits de pédopsychiatrie et environ 45% des lits de psychiatrie générale).
À ce titre, la question de l’implantation des lits à l’hôpital général, même si elle n’est pas un problème univoque, ne nous paraît pas avoir fait l’objet de développements suffisants dans le rapport, alors même que ce thème a été abordé dans le chapitre relatif aux coordinations et à la proximité.
Comme nous l’avons dit, les difficultés rencontrées lors de l’implantation de telles unités ne doivent pas conduire à l’abandon pur et simple de ce modèle. Il nous paraît important de mieux définir les conditions auxquelles une intégration, y compris graduée, serait réussie, d’autant plus que la pression croissante sur les temps médicaux risque de déplacer la masse critique médicale des CHS vers les CHG.
Rappelons les arguments qui plaident en faveur d’un tel rapprochement, et qui sont toujours valables : la moindre distance, et donc l’amélioration du confort lors du séjour du patient comme pour sa famille, la moindre stigmatisation de la psychiatrie, la possibilité de réponses graduées pour faciliter la sortie, le rapprochement avec les disciplines somatiques et l’accès à leur plateau technique pour une prise en charge plus globale, la mutualisation des coûts logistiques, la facilitation de la psychiatrie de liaison et de la réponses aux situations d’urgence, mixtes ou non.
“Garantir la permanence de l’offre de soins et une réponse systématique et adaptée à l’urgence psychiatrique”.
Une coordination forte d’une réponse psychiatrique ouverte, comportant l’assistance en cas de crise, en appui du réseau naturel, social ou sanitaire de première ligne (les généralistes), représente une des pistes susceptible de limiter le recours, programmé ou non, à la seconde ligne.
Nous pensons que le développement des urgences psychiatriques, pour aussi légitime qu’il soit, s’il n’appuie pas la première ligne sanitaire, construit une deuxième ligne spécialisée qui se transforme en première et amplifie le recours à l’urgence comme modalité habituelle d’entrée. D’où la nécessité de recourir en priorité à la première ligne alors qu’actuellement c’est l’inverse : la deuxième ligne, urgences hospitalières spécialisées ou non, est plus accessible et offre davantage de garanties générales d’appui que la première, ce qui la fait utiliser massivement.
À partir de la volonté, compréhensible, de limiter un effet mille-feuilles, très consommateur en ressources, les rapporteurs proposent d’implanter sur le site des CHS, le dispositif d’évaluation de post-urgence.
Nous proposons l’inverse : l’implantation à l’hôpital général. Mais, dans notre esprit, il existe une identité entre le protocole de 72 heures et l’existence d’UHCD dédiées, ou non, au sein des urgences, à la psychiatrie, ou par le biais d’un centre de crise adjacent au service des urgences. L’objectif d’une telle implantation de ces structures est double :
- stratégique, afin d’arrimer définitivement la psychiatrie d’urgence au MCO à travers cette organisation et de mettre fin à un développement séparé entre la psychiatrie et la médecine dont la France est l’un des derniers et plus résistants représentants, apartheid légitimé par les uns ou tacitement accepté par les autres,
- fonctionnel, au bénéfice des patients, des familles et du réseau de première ligne qui le réclament en général.
Le rapport d’étape propose que le “protocole de 72 heures” soit distinct de l’accueil aux urgences et puisse être intégré dans la réponse intra-hospitalière sous forme d’unité intersectorielle d’admission, d’hospitalisation de courte durée.
Nous pensons que cette UIA, en mélangeant les fonctions de centre d’accueil et de crise intersectoriel et d’admission au sein d’un hôpital psychiatrique n’est pas fonctionnel : une telle unité est appelée service d’urgence psychiatrique, mais elle ne prévient guère l’hospitalisation car celle-ci est imposée à la structure. Les nouveaux patients subissent un circuit long car ils se présentent, de toute façon, aux urgences de l’hôpital général mais ils sont, d’autant plus facilement, orientés vers le CHS que l’existence d’une UIA au sein de ce dernier précarise, ou rend moins “indispensable”, l’existence d’une réponse satisfaisante aux urgences de l’hôpital général.
Grâce à quoi, le MCO et la psychiatrie continuent à vivre leur existence séparée.
Le renforcement du dispositif d’urgence de première ligne que constituent les médecins généralistes nécessite d’être développé, notamment dans le cadre des coopérations qui doivent s’organiser entre partenaires sur le terrain.
Ce renforcement devra s’accompagner d’actions de formation, destinées aux psychiatres, et axées sur la maîtrise des flux d’entrée dans le dispositif de soins, des mesures de régulation en amont, aux urgences ou dans le tissu de soins primaires. Cette formation est indispensable.
Sauf à répondre à des cas particuliers, il ne semble pas que la solution de l’intégration dans les CHS doive être privilégiée, mais plutôt l’inverse. Si l’on garde l’objectif de prévenir l’hospitalisation, celui-ci s’initie dès l’entrée dans le dispositif. Il est beaucoup plus difficile à atteindre dés lors que le patient est présent à l’hôpital psychiatrique.
En contribuant à l’objectif de désinstitutionalisation, la régulation d’aval du dispositif contribue largement à réduire la pression sur les lits d’hospitalisation complète.
“Garantir la continuité des soins et de l’accompagnement social pour des alternatives à
l’hospitalisation, la mise en place de systèmes coordonnés et la mobilisation utile à la réinsertion”.
Le rapport d’étape recommande de procéder à une évaluation annuelle, par région, du nombre de patients hospitalisés en psychiatrie, qui y séjournent depuis plus d’un an et dont l’hospitalisation ne répond plus à un objectif thérapeutique.
La proposition de développer les alternatives et les actions en amont et en aval de l’hospitalisation prend l’hospitalisation complète comme référence.
Nous pensons que les opérateurs gagneraient à ne pas être psychiatriques, ni même sanitaires.
La question de la réinsertion devrait inclure une réflexion sur la prise en charge précoce des psychoses, après le premier épisode aigu, et la prévention secondaire, pour empêcher ou limiter une désinsertion durable.
Beaucoup de parcours invalidants des schizophrènes trouvent leur source dans une prévention limitée de ces situations.
Sur la réinsertion proprement dite, on doit constater que la psychiatrie a fait peu, tard, et de façon souvent inappropriée. Ce domaine est à l’intersection d’une activité sanitaire (pas seulement psychiatrique) départementale ou régionale, très technique, d’évaluation brève, qui peut également s’effectuer en ambulatoire ou en centre de jour, et d’autres actions locales coordonnées, non psychiatriques et non sanitaires qui, elles, doivent être menées par des acteurs du champ social et du travail normal ou protégé, avec l’appui d’une équipe fixe ou mobile de psychiatrie de liaison qui a acquis ou développé une compétence spécifique. Ces dernières actions doivent être ambulatoires même si doivent y participer des patients hospitalisés. Comment s’entraîner à une vie ou à une activité normales dans un contexte aussi peu approprié qu’un hôpital ou un service psychiatrique ?
Le rapport propose de développer la création de MAS.
La nécessité pour les CHS de maintenir une activité sur leur site a souvent entraîné la création de MAS ou d’autres réponses d’accueil protégé.
Nos observations nous poussent à recommander une externalisation systématique dans la cité, une graduation entre des réponses individuelles, semi-collectives ou collectives, mais à taille humaine (10-15 places au maximum), un opérateur indépendant de la psychiatrie et du sanitaire même s’il en reçoit, contractuellement, des prestations importantes.
Si cette création est bénéfique aux patients; son financement, par une partie des moyens hospitaliers redéployés correspondant, ne doit pas priver l’hôpital des moyens nécessaires à la modernisation des structures ni surtout au développement des alternatives.
Pour autant, la création de places supplémentaires dans ces structures d’accueil protégé est indispensable et appelle, bien évidemment des financements supplémentaires.
“Multiplier les partenariats avec les acteurs directs et indirects, afin d’organiser une complémentarité indispensable dans le cas des personnes atteintes d’un handicap psychique”.
Le constat est unanimement partagé : les personnes qui se trouvent en situation de handicap du fait de troubles psychiques graves et persistants ne trouvent pas, actuellement, les réponses adaptées à leurs besoins en termes d’insertion sociale et professionnelle, en complément des soins qui doivent continuer à leur être prodigués et en bonne articulation avec ceux-ci.
Face à cette situation, les pouvoirs publics préconisent un dépassement des frontières entre les secteurs sanitaire et médico-social, en levant les obstacles juridiques à une prise en charge conjointe.
La reconnaissance de la notion de handicap psychique représente un tournant primordial.
Les rapporteurs avancent, pour ces personnes, un ensemble de mesures qui concourent à l’amélioration de la qualité de leur vie et de leur statut social, qu’il conviendra de rapprocher de celles proposées dans le cadre du Plan Handicap. Une telle reconnaissance favorise bien entendu, une meilleure insertion sociale des handicapés.
Cette orientation récente des politiques publiques dans le domaine de la santé mentale n’aurait pas été possible sans la lente émergence du concept, porté initialement par les associations de familles de malades mentaux c’est à dire l’UNAFAM, et des associations d’usagers, dans l’objectif, tout à fait explicite, de “faire exister une population” et, corrélativement, d’apporter des solutions à leurs besoins, en les différenciant de celle des déficients intellectuels.
Dans le langage commun, le terme de handicap présente le lourd inconvénient d’induire une vision réductrice de stabilité de situation qui ne s’adapte pas au parcours, aux formes très variables, de ces personnes, même si elles auront recours durablement au système de santé. Le terme de handicap traduit cependant les difficultés qu’elles rencontrent dans leur accès à différents biens ou ressources, en l’occurrence l’insertion sociale et professionnelle, difficultés que la société réduit avec l’émergence du droit à compensation.
La dénomination la moins inappropriée pour définir cette population est bien celle de personnes qui se trouvent en situation de handicap du fait de troubles psychiques graves et persistants. Handicap psychique est un terme utilisé par commodité mais également parce qu’il s’impose de plus en plus, malgré l’opposition de ceux qui y voient une volonté de négation de la maladie mentale ou bien des raisons exclusivement économiques tendant à restreindre le champ de la psychiatrie.
La personne handicapée psychique continue d’être une personne malade qui supporte encore un désavantage social du fait de ses troubles mentaux. Sa maladie lui donne droit aux soins, et son handicap à une protection sociale permettant de le compenser au mieux, afin de garantir une vie la plus proche possible de la normale.
Tous les projets d’accompagnement des personnes handicapées psychiques doivent donc comporter les deux dimensions : sanitaire et sociale. Malgré le cadre budgétaire contraint dans lequel les dépenses consacrées aux différentes activités de soin et de prévention évoluent, on notera la permanence, ces dernières années, de la volonté des pouvoirs publics de soutenir les projets et les actions visant à l’insertion professionnelle de ces personnes .
“La définition d’un cadre partenarial entre le secteur sanitaire et le secteur médicosocial”
nous semble, comme aux rapporteurs, indispensable même si elle ne règle pas, au fond, la question de l’origine du financement.
Affirmer la nécessité du maintien des moyens indispensables au fonctionnement de la psychiatrie peut contredire la volonté affichée de participer au financement de structures médico-sociales et sousentendre la possibilité de les créer ex nihilo.
Il restera, par ailleurs, à définir les modalités d’articulation entre les nouveaux “Comité Régional d’Organisation Sanitaire” et “Comité Régional d’Organisation Social et Médico-social” nés de la division de l’ancien CROS, dans l’ordonnance de simplification administrative.
Mieux dépister et mieux traiter les troubles psychiques des enfants et des adolescents, mieux promouvoir leur santé mentale
Les propositions qui concernent la psychiatrie infanto-juvénile bénéficient, en principe, des idées générales développées dans la première partie du rapport : réduction des inégalités, coordination accrue public-privé, sanitaire- médico-social et, plus généralement, développement du réseau.
Nous ne pouvons être qu’en accord avec tout ceci. Le projet de “CMP Ressources Territorial” s’applique-t-il également à l’organisation de la psychiatrie infanto-juvénile ? Ce point mériterait d’être précisé pour prolonger, le cas échéant, la discussion, de même que la question du coordinateur ou référent territorial, centre de ressources à lui tout seul, à propos duquel les mêmes questions qu’en psychiatrie générale se posent.
Nous partageons les principes de description des différents niveaux de prévention, leurs objectifs et leur organisation, clairs et précis.
Les rapporteurs traitent de la prévention généralisée et s’appuient sur l’expertise de l’I.NS.E.R.M. soutenue par l’I.N.P.E.S.
Le caractère unilatéral de cette référence nous paraît restrictif et ne reflète pas suffisamment le choc culturel entre des modèles anglo-saxons et une approche psycho dynamique qui prévaut très largement, en France( ce que le rapport reconnaît).
Une telle opposition est parfois caricaturée de façon binaire : d’un côté les tenants “d’une pédopsychiatrie scientiste”, centrée sur le symptôme, le comportement, parfois les médicaments, acontextuelle, anhistorique, déniant la subjectivité voire l’intersubjectivité, dont le modèle prévalent repose sur un réductionnisme neurobiologique, et qui n’intègre pas l’apport de la classification française des maladies mentales de l’enfant et de l’adolescent (c’est nous qui caricaturons).
À l’opposé, existerait une pédopsychiatrie s’appuyant sur des modèles irréfutables, déniant l’accroissement continu des connaissances dans les domaines du développement cérébral et de la génétique, aux résultats insuffisamment appuyés sur des classifications et des travaux internationaux, sur des preuves, n’autorisant pas un dialogue scientifique avec la communauté des chercheurs (nous caricaturons également).
Depuis trente ans, une partie majoritaire de la pédopsychiatrie publique française, comprenant une partie du champ universitaire actuel, a été formée, de façon assez homogène, dans le “modèle français”, initié autour des professeurs Lebovici et Misès, à la Fondation Vallée, au Centre Alfred Binet, Boulevard Brune, etc. Les professionnels qui représentent cette approche sont sur la défensive. Ils s’estiment non reconnus, malgré un travail de terrain et une recherche clinique de durée et d’ampleur considérables, par une partie moins nombreuse mais dont l’influence s’accroît, principalement universitaire, qui représente le modèle actuel dominant des appareils d’enseignement et de recherche, clinique et scientifique.
Ces dilemmes, que nous amplifions et simplifions de manière caricaturale, traversent bruyamment la pédopsychiatrie française.
Il nous semble nécessaire de continuer le débat, en le dépassant, de créer ou recréer les conditions institutionnelles équitables qui permettent de l’approfondir et, pourquoi pas, d’en rechercher les synergies.
Davantage encore qu’en psychiatrie générale, la question de la psychothérapie se pose en pédopsychiatrie, tant y prédominent les contextes ambulatoires et y sont importants les traitements non pharmacologiques.
Cette question ne peut se réduire à l’accréditation ou à l’évaluation des psychothérapies.
Elle impose également que les approches subjectives ou intersubjectives continuent d’être étudiées également, c’est à dire incluses, dans la recherche scientifique.
C’est pourquoi, nous privilégions un modèle intégré bio-psycho-social dans lequel chaque élément du tryptique est respecté par les deux autres et réciproquement, et s’enrichit de leurs apports. L’alternative qui nous est actuellement proposée dans la profession ne comporte que des réductionnismes : bio-médical, susceptible, comme nous l’avons dit, d’écarter de la recherche le psychisme et l’environnement ; subjectiviste, au risque d’écarter l’organique, le cerveau et l’environnement du sujet, et social, au risque de limiter la prise en compte des pathologies et des vulnérabilités en les diluant dans leur environnement.
Ces questions de modèle univoque peuvent se retrouver dans les lieux de répit dont la formulation est concise. Elle est obscurcie par son insertion dans des propositions concernant la petite enfance.
S’agit-il de lieux de séparation, pour que les jeunes se “reposent” de leurs parents, ou bien du “respite care” des anglo-saxons, qui concerne davantage le fardeau familial de la maladie d’un proche et les modalités de son allègement, notion bien développée dans ces pays mais moins utilisée, malgré son importance, en France ? On pourrait continuer à propos des instruments de dépistage à inclure dans tous les bilans effectués en milieu scolaire, comme des “programmes éprouvés” à mettre en place systématiquement en pédiatrie.
La concision du propos et la pertinence des propositions peuvent faire craindre qu’elles ne soient relativisées par la référence à un modèle univoque.
La proposition qui est faite de renforcer le dispositif de la psychiatrie infanto-juvénile mériterait sans doute d’être prolongée, par exemple, par l’identification d’un programme de prévention réunissant, amplifiant et donnant cohérence à ce qui est déjà effectué sur le terrain. Quels territoires sont concernés ? Un ou plusieurs intersecteurs, le territoire de santé auquel il est fait référence au début du rapport ? Par l’intermédiaire de quels acteurs? avec quels métiers? quelles formations? pour quel type de prévention, etc. ?
Les problématiques de l’autisme et des psychoses infantiles, le suicide de l’adolescent, les troubles du comportement alimentaire, les pathologies de l’agir, la question de la maltraitance et les abus sexuels n’apparaissent pas dans le rapport.
Certaines ont fait l’objet de contributions distinctes et non spécifiques de la psychiatrie : “l’autisme”, “agir aux racines de la violence”, etc. D’autres font l’objet de conférences de consensus.
La question du clivage entre les secteurs sanitaire et médico-social n’apparaît pas non plus, bien qu’elle pose des problèmes aussi graves qu’en psychiatrie générale : transfert de charge du sanitaire vers le médico-social, qui se reflète dans la désinstitutionnalisation marquée du secteur pédopsychiatrique, missions et périmètre de la psychiatrie infanto juvénile, complémentarités à construire entre les deux champs tandis que le secteur médico-social se démédicalise, métiers, formations, sources de financement, etc.
La dernière proposition est consacrée à l’amélioration du fonctionnement des structures confrontées à une augmentation des demandes. Elle comprend de nombreuses mesures qui, en elles-mêmes, ne posent pas de problèmes. On peut toutefois se demander si elles répondent directement à l’objectif fixé qui impose d’examiner, par exemple, une organisation différente de l’accueil ambulatoire et un équilibre donnant une part moins défavorable aux réponses non programmées.
On peut donc constater qu’il s’agit d’un travail où l’on parle à nouveau, dans un rapport consacré à la psychiatrie, de la pédopsychiatrie comme domaine spécifique et où l’on souligne l’importance première donnée à la prévention et à la promotion de la santé mentale. Cela suffit à conférer à l’ensemble des propositions un bilan réellement saillant et positif.
Nous ne pouvons être qu’en accord avec tout ceci. Le projet de “CMP Ressources Territorial” s’applique-t-il également à l’organisation de la psychiatrie infanto-juvénile ? Ce point mériterait d’être précisé pour prolonger, le cas échéant, la discussion, de même que la question du coordinateur ou référent territorial, centre de ressources à lui tout seul, à propos duquel les mêmes questions qu’en psychiatrie générale se posent.
Nous partageons les principes de description des différents niveaux de prévention, leurs objectifs et leur organisation, clairs et précis.
Les rapporteurs traitent de la prévention généralisée et s’appuient sur l’expertise de l’I.NS.E.R.M. soutenue par l’I.N.P.E.S.
Le caractère unilatéral de cette référence nous paraît restrictif et ne reflète pas suffisamment le choc culturel entre des modèles anglo-saxons et une approche psycho dynamique qui prévaut très largement, en France( ce que le rapport reconnaît).
Une telle opposition est parfois caricaturée de façon binaire : d’un côté les tenants “d’une pédopsychiatrie scientiste”, centrée sur le symptôme, le comportement, parfois les médicaments, acontextuelle, anhistorique, déniant la subjectivité voire l’intersubjectivité, dont le modèle prévalent repose sur un réductionnisme neurobiologique, et qui n’intègre pas l’apport de la classification française des maladies mentales de l’enfant et de l’adolescent (c’est nous qui caricaturons).
À l’opposé, existerait une pédopsychiatrie s’appuyant sur des modèles irréfutables, déniant l’accroissement continu des connaissances dans les domaines du développement cérébral et de la génétique, aux résultats insuffisamment appuyés sur des classifications et des travaux internationaux, sur des preuves, n’autorisant pas un dialogue scientifique avec la communauté des chercheurs (nous caricaturons également).
Depuis trente ans, une partie majoritaire de la pédopsychiatrie publique française, comprenant une partie du champ universitaire actuel, a été formée, de façon assez homogène, dans le “modèle français”, initié autour des professeurs Lebovici et Misès, à la Fondation Vallée, au Centre Alfred Binet, Boulevard Brune, etc. Les professionnels qui représentent cette approche sont sur la défensive. Ils s’estiment non reconnus, malgré un travail de terrain et une recherche clinique de durée et d’ampleur considérables, par une partie moins nombreuse mais dont l’influence s’accroît, principalement universitaire, qui représente le modèle actuel dominant des appareils d’enseignement et de recherche, clinique et scientifique.
Ces dilemmes, que nous amplifions et simplifions de manière caricaturale, traversent bruyamment la pédopsychiatrie française.
Il nous semble nécessaire de continuer le débat, en le dépassant, de créer ou recréer les conditions institutionnelles équitables qui permettent de l’approfondir et, pourquoi pas, d’en rechercher les synergies.
Davantage encore qu’en psychiatrie générale, la question de la psychothérapie se pose en pédopsychiatrie, tant y prédominent les contextes ambulatoires et y sont importants les traitements non pharmacologiques.
Cette question ne peut se réduire à l’accréditation ou à l’évaluation des psychothérapies.
Elle impose également que les approches subjectives ou intersubjectives continuent d’être étudiées également, c’est à dire incluses, dans la recherche scientifique.
C’est pourquoi, nous privilégions un modèle intégré bio-psycho-social dans lequel chaque élément du tryptique est respecté par les deux autres et réciproquement, et s’enrichit de leurs apports. L’alternative qui nous est actuellement proposée dans la profession ne comporte que des réductionnismes : bio-médical, susceptible, comme nous l’avons dit, d’écarter de la recherche le psychisme et l’environnement ; subjectiviste, au risque d’écarter l’organique, le cerveau et l’environnement du sujet, et social, au risque de limiter la prise en compte des pathologies et des vulnérabilités en les diluant dans leur environnement.
Ces questions de modèle univoque peuvent se retrouver dans les lieux de répit dont la formulation est concise. Elle est obscurcie par son insertion dans des propositions concernant la petite enfance.
S’agit-il de lieux de séparation, pour que les jeunes se “reposent” de leurs parents, ou bien du “respite care” des anglo-saxons, qui concerne davantage le fardeau familial de la maladie d’un proche et les modalités de son allègement, notion bien développée dans ces pays mais moins utilisée, malgré son importance, en France ? On pourrait continuer à propos des instruments de dépistage à inclure dans tous les bilans effectués en milieu scolaire, comme des “programmes éprouvés” à mettre en place systématiquement en pédiatrie.
La concision du propos et la pertinence des propositions peuvent faire craindre qu’elles ne soient relativisées par la référence à un modèle univoque.
La proposition qui est faite de renforcer le dispositif de la psychiatrie infanto-juvénile mériterait sans doute d’être prolongée, par exemple, par l’identification d’un programme de prévention réunissant, amplifiant et donnant cohérence à ce qui est déjà effectué sur le terrain. Quels territoires sont concernés ? Un ou plusieurs intersecteurs, le territoire de santé auquel il est fait référence au début du rapport ? Par l’intermédiaire de quels acteurs? avec quels métiers? quelles formations? pour quel type de prévention, etc. ?
Les problématiques de l’autisme et des psychoses infantiles, le suicide de l’adolescent, les troubles du comportement alimentaire, les pathologies de l’agir, la question de la maltraitance et les abus sexuels n’apparaissent pas dans le rapport.
Certaines ont fait l’objet de contributions distinctes et non spécifiques de la psychiatrie : “l’autisme”, “agir aux racines de la violence”, etc. D’autres font l’objet de conférences de consensus.
La question du clivage entre les secteurs sanitaire et médico-social n’apparaît pas non plus, bien qu’elle pose des problèmes aussi graves qu’en psychiatrie générale : transfert de charge du sanitaire vers le médico-social, qui se reflète dans la désinstitutionnalisation marquée du secteur pédopsychiatrique, missions et périmètre de la psychiatrie infanto juvénile, complémentarités à construire entre les deux champs tandis que le secteur médico-social se démédicalise, métiers, formations, sources de financement, etc.
La dernière proposition est consacrée à l’amélioration du fonctionnement des structures confrontées à une augmentation des demandes. Elle comprend de nombreuses mesures qui, en elles-mêmes, ne posent pas de problèmes. On peut toutefois se demander si elles répondent directement à l’objectif fixé qui impose d’examiner, par exemple, une organisation différente de l’accueil ambulatoire et un équilibre donnant une part moins défavorable aux réponses non programmées.
On peut donc constater qu’il s’agit d’un travail où l’on parle à nouveau, dans un rapport consacré à la psychiatrie, de la pédopsychiatrie comme domaine spécifique et où l’on souligne l’importance première donnée à la prévention et à la promotion de la santé mentale. Cela suffit à conférer à l’ensemble des propositions un bilan réellement saillant et positif.
La santé mentale doit se doter d’un cadre spécifiquement adapté à la prise en charge des troubles psychiatriques des personnes âgées
Le rapport préconise une psycho-gériatrie à la hauteur des besoins et insiste sur quelques propositions, notamment : la promotion d’une filière de soins géronto-psychiatrique, pluridisciplinaire, la spécialisation de la prise en charge des troubles psychiatriques dans les établissements et le renforcement de la continuité des soins entre structures sanitaires et non sanitaires, le développement de la prévention en particulier dans la cadre du maintien à domicile des personnes âgées, etc..
Le concept de santé mentale apparaît parfaitement adapté à la personne âgée puisqu’il s’agit d’une approche globale concernant l’ensemble de la personne avec ses composantes psychique et somatique.
L’objectif est le maintien de la maîtrise, par la personne elle-même, de son existence au sein de l’entourage habituel (famille, collectivité, etc.), par une limitation préventive de l’isolement, une préservation du lien entre générations, une réelle appartenance à la collectivité comportant l’expérience de garder une utilité. La santé mentale des personnes âgées concerne donc la société dans son ensemble(cf Pluriels n°40 “La santé mentale des personnes âgées”).
On peut raisonnablement penser que l’émergence d’une psycho-gériatrie à la hauteur des besoins rencontrés, et qui s’impose, rappellera celle de la psychiatrie infanto-juvénile. Les modalités en seront- elles identiques ?
La catastrophe sanitaire de cet été ne cesse de provoquer de nombreux commentaires.
Un point, pourtant majeur, demeure peu ou pas souligné : la part déterminante des troubles psychopathologiques, si fréquents chez les personnes âgées.
Un tiers des 12.000 personnes qui se donnent la mort chaque année, en France, sont des personnes âgées de plus de 60 ans.
L’avance en âge ne fait pas disparaître les situations de détresse psychique ni les maladies mentales, c’est même l’inverse. Les adultes malades mentaux vieillissent mal, leur morbidité et leur mortalité sont plus élevés que dans la population générale.
Les adultes sans antécédents peuvent présenter des troubles mentaux dont le début est tardif. De tels problèmes de santé publique sont majeurs mais sans conséquences remarquées. Le sujet reste le plus souvent tabou.
Pour les personnes âgées souffrant de troubles mentaux, on ne dira jamais assez qu’elles sont le plus souvent isolées, et qu’elles vivent puis meurent là où elles se trouvent : à domicile, où elles résident le plus souvent, dans les foyers résidence, les maisons de retraite (EHPA) et les unités de long séjour (UHPAD).
La santé mentale doit s’inscrire dans les volets consacrés aux personnes âgées des SROS et contribuer à l’évolution du dispositif, notamment en garantissant des soins psychiatriques dans les maisons de retraite, comportant l’assurance d’une facilité d’accès à l’hospitalisation en psychiatrie, dans ses unités adaptées, en cas de nécessité; en rendant possible l’intervention à domicile d’équipes psychiatriques spécialisées; en valorisant cette mobilité (VAD pycho-gériatriques); en faisant émerger, comme mode d’organisation de la réponse, des intersecteurs de psychiatrie de la personne âgée. Ils existent à Limoges, Marseille, Lyon, Nice, Pau ou dans le Sud Yvelines.
Dans le contexte actuel, on perçoit l’intérêt d’une filière de formation permettant de disposer de psychiatres compétents en psychiatrie de la personne âgée.
Trop souvent les équipes de ces unités de géronto-psychiatrie, axées sur l’acuité, se défont du fait de la pénibilité du travail et de l’épuisement professionnel qui en résulte.
Indépendamment de la question du niveau de dotation en personnel requis pour ces unités qui est bien souvent trop faible, il convient de s’interroger sur les façons de rendre ces structures plus attractives.
Le concept de santé mentale apparaît parfaitement adapté à la personne âgée puisqu’il s’agit d’une approche globale concernant l’ensemble de la personne avec ses composantes psychique et somatique.
L’objectif est le maintien de la maîtrise, par la personne elle-même, de son existence au sein de l’entourage habituel (famille, collectivité, etc.), par une limitation préventive de l’isolement, une préservation du lien entre générations, une réelle appartenance à la collectivité comportant l’expérience de garder une utilité. La santé mentale des personnes âgées concerne donc la société dans son ensemble(cf Pluriels n°40 “La santé mentale des personnes âgées”).
On peut raisonnablement penser que l’émergence d’une psycho-gériatrie à la hauteur des besoins rencontrés, et qui s’impose, rappellera celle de la psychiatrie infanto-juvénile. Les modalités en seront- elles identiques ?
La catastrophe sanitaire de cet été ne cesse de provoquer de nombreux commentaires.
Un point, pourtant majeur, demeure peu ou pas souligné : la part déterminante des troubles psychopathologiques, si fréquents chez les personnes âgées.
Un tiers des 12.000 personnes qui se donnent la mort chaque année, en France, sont des personnes âgées de plus de 60 ans.
L’avance en âge ne fait pas disparaître les situations de détresse psychique ni les maladies mentales, c’est même l’inverse. Les adultes malades mentaux vieillissent mal, leur morbidité et leur mortalité sont plus élevés que dans la population générale.
Les adultes sans antécédents peuvent présenter des troubles mentaux dont le début est tardif. De tels problèmes de santé publique sont majeurs mais sans conséquences remarquées. Le sujet reste le plus souvent tabou.
Pour les personnes âgées souffrant de troubles mentaux, on ne dira jamais assez qu’elles sont le plus souvent isolées, et qu’elles vivent puis meurent là où elles se trouvent : à domicile, où elles résident le plus souvent, dans les foyers résidence, les maisons de retraite (EHPA) et les unités de long séjour (UHPAD).
La santé mentale doit s’inscrire dans les volets consacrés aux personnes âgées des SROS et contribuer à l’évolution du dispositif, notamment en garantissant des soins psychiatriques dans les maisons de retraite, comportant l’assurance d’une facilité d’accès à l’hospitalisation en psychiatrie, dans ses unités adaptées, en cas de nécessité; en rendant possible l’intervention à domicile d’équipes psychiatriques spécialisées; en valorisant cette mobilité (VAD pycho-gériatriques); en faisant émerger, comme mode d’organisation de la réponse, des intersecteurs de psychiatrie de la personne âgée. Ils existent à Limoges, Marseille, Lyon, Nice, Pau ou dans le Sud Yvelines.
Dans le contexte actuel, on perçoit l’intérêt d’une filière de formation permettant de disposer de psychiatres compétents en psychiatrie de la personne âgée.
Trop souvent les équipes de ces unités de géronto-psychiatrie, axées sur l’acuité, se défont du fait de la pénibilité du travail et de l’épuisement professionnel qui en résulte.
Indépendamment de la question du niveau de dotation en personnel requis pour ces unités qui est bien souvent trop faible, il convient de s’interroger sur les façons de rendre ces structures plus attractives.
Réformer l’espace médico-judiciaire, en réactualisant certaines dispositions de la loi du 27 juin 1990 relative à l’hospitalisation sous contrainte, en insérant une obligation de soins sous conditions et en optimisant la prise en charge psychiatr
Les rapporteurs proposent d’améliorer le fonctionnement des CDHP vers plus d’autonomie, et d’élargir leur champs de compétence.
Le renforcement des prérogatives des CDHP apparaît inévitable, cependant le développement souhaité vers des sujets relatifs à l’éthique et aux libertés risque d’interférer avec certaines instances des établissements : Conseil d’Administration (: présence des usagers et des familles), Commission médicale, Comité Technique d’Établissement, Médiateur, etc.. Les modalités de saisine, et le caractère obligatoire ou non des recommandations devront être précisés. Plus généralement, parce qu’elles visent à rompre avec la marginalisation actuelle, les propositions faites imposent la clarté quant à une CDHP travaillant en réseau, tout en étant partie prenante de la vie des institutions. Il conviendra de veiller à ne pas mettre en place une instance de plus.
Les aménagements proposés par les rapporteurs, concernant l’extension des dispositions de la loi du 27 juin 1990 aux établissements privés, l’information des professionnels l’allègement des autorisations de sorties par la créations des “sorties de proximité”, la clarification de l’utilisation des sorties d’essai de longue durée, l’harmonisation de la périodicité des certificats légaux (par la suppression du deuxième certificat lors de l’admission en HDT) ne posent pas de problème à nos yeux.
Les thèmes qui concernent l’ouverture ou la fermeture des unités, la défaillance des tiers, des malades et de leurs familles nous paraissent beaucoup plus sensibles.
La liberté d’aller et venir repose sur l’ouverture de l’unité pour les patients hospitalisés, mais aussi et surtout sur le développement, pour les patients hospitalisés sous contrainte, de protocoles définissant les modalités de soins si l’unité est fermée (en introduisant des critères d’entrée, des règles du séjour, des critères de sortie). Cette liberté est une des libertés fondamentales garanties par notre constitution, elle ne peut souffrir de restrictions que dûment justifiées (et non de privation).
Concernant la défaillance du tiers, les auteurs proposent qu’un certificat soit rédigé par un psychiatre ne dépendant pas de l’établissement où doit être hospitalisé le patient pour éviter une hospitalisation d’office.
Il nous semble que le risque que le dispositif soit alourdi, notamment en cas d’urgence est réel. D’autres solutions ont déjà été proposées : une admission sous contrainte, et une sortie sur avis médical obligatoire.
L’amélioration des dispositions relatives au contenu et à la communication du dossier médical figure parmi les propositions de réforme de l’espace médico-judiciaire, comme si la communication du dossier ne pouvait être qu’une source automatique de conflit et non pas un espace, supplémentaire, de garantie, donc de droit et de liberté, pour le malade. Si l’on adopte ce point de vue, la question de la communication du dossier ne peut qu’être abordée restrictivement, le décideur ultime étant le seul médecin. La possibilité d’une rétroactivité, avec l’introduction possible d’un tiers, ici la CDHP, nous semble intéressante.
Concernant les personnes sous main de justice, nous partageons le sens général des propositions qui visent à améliorer leur prise en charge et à étendre l’application des mesures de suivi socio-judiciaire aux délinquants ayant une “composante psychopathologique préoccupante”, sous réserve que cette notion soit approfondie.
Par ailleurs, il nous semble nécessaire de clarifier les missions des experts médicojudiciaires : est-il un spécialiste à temps plus ou moins complet et ou un praticien de secteur ? La question du temps passé en expertise doit être abordée clairement.
Enfin, la proposition de faire aboutir la réforme de la loi du 3 janvier 1968 sur les incapables majeurs permet de rappeler que celle-ci ne prévoit aucune tutelle à la personne. Le tuteur ne peut intervenir pour les actes personnels importants qu’en tenant compte, chaque fois que cela est possible, de l’avis de la personne protégée, sous le contrôle du juge des tutelles.
L’orientation prise, jusqu’ici, par le Ministère chargé de la Justice, a été de définir une nouvelle mesure de protection, moins invalidante, sans incapacité civile, tout en rappelant certains principes fondamentaux : nécessité stricte, impossibilité de recourir à des procédures de droit commun, réversibilité, respect de la dignité des personnes, harmonisation du financement.
L’évaluation médico-sociale, qui serait introduite dans les procédures civiles, pourrait être accompagnée socialement.
De même, la décision d’attribution des montants de compensation serait fondée sur une évaluation objective des besoins de la personne. La compensation porterait sur l’orientation en établissement (y compris sanitaire), la capacité à travailler, les aides. Elle serait fixée par une équipe médico-sociale de proximité.
Le renforcement des prérogatives des CDHP apparaît inévitable, cependant le développement souhaité vers des sujets relatifs à l’éthique et aux libertés risque d’interférer avec certaines instances des établissements : Conseil d’Administration (: présence des usagers et des familles), Commission médicale, Comité Technique d’Établissement, Médiateur, etc.. Les modalités de saisine, et le caractère obligatoire ou non des recommandations devront être précisés. Plus généralement, parce qu’elles visent à rompre avec la marginalisation actuelle, les propositions faites imposent la clarté quant à une CDHP travaillant en réseau, tout en étant partie prenante de la vie des institutions. Il conviendra de veiller à ne pas mettre en place une instance de plus.
Les aménagements proposés par les rapporteurs, concernant l’extension des dispositions de la loi du 27 juin 1990 aux établissements privés, l’information des professionnels l’allègement des autorisations de sorties par la créations des “sorties de proximité”, la clarification de l’utilisation des sorties d’essai de longue durée, l’harmonisation de la périodicité des certificats légaux (par la suppression du deuxième certificat lors de l’admission en HDT) ne posent pas de problème à nos yeux.
Les thèmes qui concernent l’ouverture ou la fermeture des unités, la défaillance des tiers, des malades et de leurs familles nous paraissent beaucoup plus sensibles.
La liberté d’aller et venir repose sur l’ouverture de l’unité pour les patients hospitalisés, mais aussi et surtout sur le développement, pour les patients hospitalisés sous contrainte, de protocoles définissant les modalités de soins si l’unité est fermée (en introduisant des critères d’entrée, des règles du séjour, des critères de sortie). Cette liberté est une des libertés fondamentales garanties par notre constitution, elle ne peut souffrir de restrictions que dûment justifiées (et non de privation).
Concernant la défaillance du tiers, les auteurs proposent qu’un certificat soit rédigé par un psychiatre ne dépendant pas de l’établissement où doit être hospitalisé le patient pour éviter une hospitalisation d’office.
Il nous semble que le risque que le dispositif soit alourdi, notamment en cas d’urgence est réel. D’autres solutions ont déjà été proposées : une admission sous contrainte, et une sortie sur avis médical obligatoire.
L’amélioration des dispositions relatives au contenu et à la communication du dossier médical figure parmi les propositions de réforme de l’espace médico-judiciaire, comme si la communication du dossier ne pouvait être qu’une source automatique de conflit et non pas un espace, supplémentaire, de garantie, donc de droit et de liberté, pour le malade. Si l’on adopte ce point de vue, la question de la communication du dossier ne peut qu’être abordée restrictivement, le décideur ultime étant le seul médecin. La possibilité d’une rétroactivité, avec l’introduction possible d’un tiers, ici la CDHP, nous semble intéressante.
Concernant les personnes sous main de justice, nous partageons le sens général des propositions qui visent à améliorer leur prise en charge et à étendre l’application des mesures de suivi socio-judiciaire aux délinquants ayant une “composante psychopathologique préoccupante”, sous réserve que cette notion soit approfondie.
Par ailleurs, il nous semble nécessaire de clarifier les missions des experts médicojudiciaires : est-il un spécialiste à temps plus ou moins complet et ou un praticien de secteur ? La question du temps passé en expertise doit être abordée clairement.
Enfin, la proposition de faire aboutir la réforme de la loi du 3 janvier 1968 sur les incapables majeurs permet de rappeler que celle-ci ne prévoit aucune tutelle à la personne. Le tuteur ne peut intervenir pour les actes personnels importants qu’en tenant compte, chaque fois que cela est possible, de l’avis de la personne protégée, sous le contrôle du juge des tutelles.
L’orientation prise, jusqu’ici, par le Ministère chargé de la Justice, a été de définir une nouvelle mesure de protection, moins invalidante, sans incapacité civile, tout en rappelant certains principes fondamentaux : nécessité stricte, impossibilité de recourir à des procédures de droit commun, réversibilité, respect de la dignité des personnes, harmonisation du financement.
L’évaluation médico-sociale, qui serait introduite dans les procédures civiles, pourrait être accompagnée socialement.
De même, la décision d’attribution des montants de compensation serait fondée sur une évaluation objective des besoins de la personne. La compensation porterait sur l’orientation en établissement (y compris sanitaire), la capacité à travailler, les aides. Elle serait fixée par une équipe médico-sociale de proximité.
Développer la démarche qualité et les actions de formation dans tous les secteurs de psychiatrie et de la santé mentale, en initiant l’évaluation des pratiques
“Développer la qualité et soutenir l’élaboration de bonnes pratiques en lien avec l’ANAES et l’INSERM”.
Les auteurs du rapport encouragent la définition de recommandations de bonnes pratiques et le développement de l’accréditation par son extension, notamment, au secteur libéral.
Il nous apparaît important que la culture de l’évaluation et de la démarche qualité diffuse à tous les niveaux. À ce titre, tout programme de santé ou action de coopération devrait inclure une définition des objectifs à atteindre, des moyens mis en oeuvre et d’indicateurs de résultats, la fréquence et la nature des évaluations qui serviront à confirmer, ajuster ou infirmer les actions qui auront été définies ou réalisées.
“Renforcer la formation initiale et continue des différents intervenants”.
Les rapporteurs proposent de promouvoir les formations initiales conjointes à tous les professionnels du champs de la santé mentale.
La formation des psychiatres, telle qu’elle a été rénovée au milieu des années quatrevingt ou même tout récemment, repose sur un modèle exclusivement médical de la maladie mentale qui s’oppose, de façon binaire, à la santé, alors que toute l’expérience de la clinique ambulatoire montre l’importance d’un continuum gradué d’états intermédiaires entre santé et maladie. Ce modèle n’inclut rien, ou très peu, sauf à travers des séminaires facultatifs, du domaine croissant des psychothérapies ou des questions d’organisation, stratégies et management des systèmes de soins.
En ce qui concerne la clinique et les aspects relationnels (pratique d’un entretien, suivi, etc.), beaucoup d’internes se plaignent d’une absence de formation et d’un compagnonnage insuffisant ou inadéquat.
Les réunions cliniques de service et les réunions de synthèse ne dépassent souvent, ni les problèmes de nosographie ni ceux de chimiothérapie. Le travail de supervision est rare sauf en psychiatrie infanto-juvénile, notamment parce que ni la nomenclature ni les budgets hospitaliers n’autorisent une intervention extérieure et régulière.
Le psychiatre en formation n’a que rarement l’occasion d’apprendre le soin ambulatoire, pourtant représentatif de 80% des files actives dans le secteur public et de presque 100% dans le secteur privé, et ce soin n’est enseigné que dans le cadre hospitalier. L’organisation des stages par semestres, justifiée par l’éclectisme nécessaire des lieux de soins, n’autorise guère, au delà de quelques semaines, l’expérience d’un suivi régulier des patients et donc la responsabilité et l’exploitation des résultats des traitements.
Il ne va pas de soi qu’il suffit d’être psychiatre pour être psychothérapeute.
Certes, le fait de voir longtemps et souvent des patients stimule l’écoute et les qualités relationnelles, mais ne le garantit nullement. Il s’agit de conditions nécessaires mais non suffisantes. L’acquisition de cette expérience de base doit donc être distinguée d’une formation (et non seulement d’un enseignement) inséparable d’une supervision individuelle ou collective pendant une certaine durée (beaucoup d’organismes, à l’échelon européen, et quels que soient les modèles de psychothérapie, préconisent l’équivalent d’une vingtaine de jours minimum par an, pendant au moins trois voire quatre ans), auprès d’un institut public ou privé, agréé ou reconnu, permettant la validation attestée d’une formation. Selon nous, tout psychiatre en formation devrait, pendant son cursus, et sauf à renoncer à une activité reconnue de psychothérapeute, pouvoir se former au moins à un modèle de psychothérapie. Il en est de même pour obtenir la valence d’opérateur en santé mentale (organisation, stratégie et management des systèmes ou programmes de soins). L’apprentissage à la gestion, à l’administration et au management manquent à la formation des praticiens hospitaliers, qu’ils soient chef de service ou non, et les oblige à apprendre sur le tas. Mais on ne leur apprend pas davantage la politique et l’organisation des urgences, les actions de prévention, la constitution, la conduite et l’évaluation d’une filière de soins programmée pour les adolescents, pour ne prendre que quelques exemples.
Les psychologues représentent, certainement, un enjeu très important dans une évolution qui devrait leur ouvrir de nombreuses perspectives. Ils subissent, toutefois, deux handicaps qui limitent singulièrement un recrutement plus ample : leur statut hospitalier, comportant un tiers-temps qui les marginalise, leur formation initiale, peu orientée vers les préoccupations et les contraintes des services de soins. Le fait enfin, qu’en dehors de quelques rares privilégiés, leur véritable formation clinique commence après l’acquisition du diplôme de psychologie clinique. Ne pourrait-on imaginer un métissage des formations, reliant les différentes facultés et l’hôpital, sous forme d’un internat de psychologie comme en Espagne, avec des stages de longue durée, encadrés et validants?
Les infirmiers occupent une place croissante et légitime dans le travail ambulatoire.
Selon nous, leur apprentissage initial devrait être complété, afin que la formation psychiatrique de ceux qui se destinent à cette spécialité soit à la hauteur de leur formation somatique améliorée.
Ce déficit semble moins marqué dans la formation initiale des travailleurs sociaux et des éducateurs.
Ceci implique également, que l’accès aux psychothérapies et à la fonction d’opérateur en santé mentale ne soit pas fermée, par principe, à l’ensemble de ces métiers.
On pourrait penser à la création de chaires intitulées “santé mentale et actions psychosociales” où il serait question de médecine, de psychologie, de sociologie et de santé publique. Iil existe, de par le monde, des chaires de psychiatrie communautaire.
Outre l’aspect symbolique, cette démarche volontariste pourrait initier un processus favorable pour l’ensemble des métiers (en partenariat avec les facultés de sciences humaines pour les psychologues), identifier et inventorier les programmes, les formateurs, ou passer convention avec eux ou leurs organisations, lancer les appels d’offre, délivrer un label aux formations, etc.
Une formule alternative pourrait consister à créer un Institut national de formation aux métiers et aux pratiques en santé mentale, résolument interprofessionnel, y compris dans sa direction pédagogique, comportant des antennes régionales. L’École Nationale de la Santé Publique (ENSP) pourrait également se voir confier un rôle.
Dans tous les cas, il s’agirait de décloisonner, en les renouvelant radicalement, les pratiques et les métiers, sans renoncer à leur spécificité de base, tout en reconnaissant au psychiatre une place modernisée et équilibrée au sein du dispositif public de santé mentale.
Les auteurs du rapport encouragent la définition de recommandations de bonnes pratiques et le développement de l’accréditation par son extension, notamment, au secteur libéral.
Il nous apparaît important que la culture de l’évaluation et de la démarche qualité diffuse à tous les niveaux. À ce titre, tout programme de santé ou action de coopération devrait inclure une définition des objectifs à atteindre, des moyens mis en oeuvre et d’indicateurs de résultats, la fréquence et la nature des évaluations qui serviront à confirmer, ajuster ou infirmer les actions qui auront été définies ou réalisées.
“Renforcer la formation initiale et continue des différents intervenants”.
Les rapporteurs proposent de promouvoir les formations initiales conjointes à tous les professionnels du champs de la santé mentale.
La formation des psychiatres, telle qu’elle a été rénovée au milieu des années quatrevingt ou même tout récemment, repose sur un modèle exclusivement médical de la maladie mentale qui s’oppose, de façon binaire, à la santé, alors que toute l’expérience de la clinique ambulatoire montre l’importance d’un continuum gradué d’états intermédiaires entre santé et maladie. Ce modèle n’inclut rien, ou très peu, sauf à travers des séminaires facultatifs, du domaine croissant des psychothérapies ou des questions d’organisation, stratégies et management des systèmes de soins.
En ce qui concerne la clinique et les aspects relationnels (pratique d’un entretien, suivi, etc.), beaucoup d’internes se plaignent d’une absence de formation et d’un compagnonnage insuffisant ou inadéquat.
Les réunions cliniques de service et les réunions de synthèse ne dépassent souvent, ni les problèmes de nosographie ni ceux de chimiothérapie. Le travail de supervision est rare sauf en psychiatrie infanto-juvénile, notamment parce que ni la nomenclature ni les budgets hospitaliers n’autorisent une intervention extérieure et régulière.
Le psychiatre en formation n’a que rarement l’occasion d’apprendre le soin ambulatoire, pourtant représentatif de 80% des files actives dans le secteur public et de presque 100% dans le secteur privé, et ce soin n’est enseigné que dans le cadre hospitalier. L’organisation des stages par semestres, justifiée par l’éclectisme nécessaire des lieux de soins, n’autorise guère, au delà de quelques semaines, l’expérience d’un suivi régulier des patients et donc la responsabilité et l’exploitation des résultats des traitements.
Il ne va pas de soi qu’il suffit d’être psychiatre pour être psychothérapeute.
Certes, le fait de voir longtemps et souvent des patients stimule l’écoute et les qualités relationnelles, mais ne le garantit nullement. Il s’agit de conditions nécessaires mais non suffisantes. L’acquisition de cette expérience de base doit donc être distinguée d’une formation (et non seulement d’un enseignement) inséparable d’une supervision individuelle ou collective pendant une certaine durée (beaucoup d’organismes, à l’échelon européen, et quels que soient les modèles de psychothérapie, préconisent l’équivalent d’une vingtaine de jours minimum par an, pendant au moins trois voire quatre ans), auprès d’un institut public ou privé, agréé ou reconnu, permettant la validation attestée d’une formation. Selon nous, tout psychiatre en formation devrait, pendant son cursus, et sauf à renoncer à une activité reconnue de psychothérapeute, pouvoir se former au moins à un modèle de psychothérapie. Il en est de même pour obtenir la valence d’opérateur en santé mentale (organisation, stratégie et management des systèmes ou programmes de soins). L’apprentissage à la gestion, à l’administration et au management manquent à la formation des praticiens hospitaliers, qu’ils soient chef de service ou non, et les oblige à apprendre sur le tas. Mais on ne leur apprend pas davantage la politique et l’organisation des urgences, les actions de prévention, la constitution, la conduite et l’évaluation d’une filière de soins programmée pour les adolescents, pour ne prendre que quelques exemples.
Les psychologues représentent, certainement, un enjeu très important dans une évolution qui devrait leur ouvrir de nombreuses perspectives. Ils subissent, toutefois, deux handicaps qui limitent singulièrement un recrutement plus ample : leur statut hospitalier, comportant un tiers-temps qui les marginalise, leur formation initiale, peu orientée vers les préoccupations et les contraintes des services de soins. Le fait enfin, qu’en dehors de quelques rares privilégiés, leur véritable formation clinique commence après l’acquisition du diplôme de psychologie clinique. Ne pourrait-on imaginer un métissage des formations, reliant les différentes facultés et l’hôpital, sous forme d’un internat de psychologie comme en Espagne, avec des stages de longue durée, encadrés et validants?
Les infirmiers occupent une place croissante et légitime dans le travail ambulatoire.
Selon nous, leur apprentissage initial devrait être complété, afin que la formation psychiatrique de ceux qui se destinent à cette spécialité soit à la hauteur de leur formation somatique améliorée.
Ce déficit semble moins marqué dans la formation initiale des travailleurs sociaux et des éducateurs.
Ceci implique également, que l’accès aux psychothérapies et à la fonction d’opérateur en santé mentale ne soit pas fermée, par principe, à l’ensemble de ces métiers.
On pourrait penser à la création de chaires intitulées “santé mentale et actions psychosociales” où il serait question de médecine, de psychologie, de sociologie et de santé publique. Iil existe, de par le monde, des chaires de psychiatrie communautaire.
Outre l’aspect symbolique, cette démarche volontariste pourrait initier un processus favorable pour l’ensemble des métiers (en partenariat avec les facultés de sciences humaines pour les psychologues), identifier et inventorier les programmes, les formateurs, ou passer convention avec eux ou leurs organisations, lancer les appels d’offre, délivrer un label aux formations, etc.
Une formule alternative pourrait consister à créer un Institut national de formation aux métiers et aux pratiques en santé mentale, résolument interprofessionnel, y compris dans sa direction pédagogique, comportant des antennes régionales. L’École Nationale de la Santé Publique (ENSP) pourrait également se voir confier un rôle.
Dans tous les cas, il s’agirait de décloisonner, en les renouvelant radicalement, les pratiques et les métiers, sans renoncer à leur spécificité de base, tout en reconnaissant au psychiatre une place modernisée et équilibrée au sein du dispositif public de santé mentale.
Développer la recherche en psychiatrie
Le rapport d’étape propose un soutien réel et concret aux modalités pertinentes de la recherche, qui concernent les champs de la psychiatrie et de la santé mentale.
Nous partageons complètement le souci d’amplifier tout ce qui concerne l’épidémiologie, avec la proposition d’un groupement d’intérêt scientifique sur ce thème, la recherche médico-économique, et la mise en place d’études de cohorte d’enfants et d’adultes, comme une recherche clinique évaluative, en favorisant l’augmentation du nombre de chercheurs, avec un tissu de cliniciens sensibilisés à la recherche par le moyen d’un DIM renforcé par l’aspect Evaluation et Recherche (“DIMRE”).
Pour favoriser un dialogue entre cliniciens et chercheurs, il est proposé, et nous y sommes tout à fait favorables, la délivrance de “valences universitaires de recherche”, la possibilité d’actions de recherches temporaires et des activités mixtes, tant il est vrai qu’on ne peut pas tout faire en même temps, à savoir soigner, faire de la recherche et enseigner.
La faiblesse de la recherche clinique en France est dûe à deux facteurs principaux :
- d’une part les cliniciens ne sont pas portés à faire de la recherche parce que le temps qu’ils devraient y consacrer n’est pas compensé,
- d’autre part parce que les universitaires qui en sont chargés de préfèrent se tourner vers des recherches soit fondamentales relevant des neuro-sciences, soit pharmacologiques fortement influencées par les laboratoires pharmaceutiques.
Cela pousse les institutions qui représentent la recherche à être de plus en plus coupées de la pratique de soin et àcontribuer peu, en dehors des médicaments, aux progrès de la discipline .
Par ailleurs, l’organisation sectorisée favorise peu la constitution de cohortes homogènes de malades. Le développement intéressant des PHRC (programmes hospitaliers de recherche clinique) favorise trop les laboratoires déjà existant et les jeunes chercheurs des équipes déjà reconnues.
Ils favorisent moins l’émergence de nouveaux chercheurs
Nous partageons complètement le souci d’amplifier tout ce qui concerne l’épidémiologie, avec la proposition d’un groupement d’intérêt scientifique sur ce thème, la recherche médico-économique, et la mise en place d’études de cohorte d’enfants et d’adultes, comme une recherche clinique évaluative, en favorisant l’augmentation du nombre de chercheurs, avec un tissu de cliniciens sensibilisés à la recherche par le moyen d’un DIM renforcé par l’aspect Evaluation et Recherche (“DIMRE”).
Pour favoriser un dialogue entre cliniciens et chercheurs, il est proposé, et nous y sommes tout à fait favorables, la délivrance de “valences universitaires de recherche”, la possibilité d’actions de recherches temporaires et des activités mixtes, tant il est vrai qu’on ne peut pas tout faire en même temps, à savoir soigner, faire de la recherche et enseigner.
La faiblesse de la recherche clinique en France est dûe à deux facteurs principaux :
- d’une part les cliniciens ne sont pas portés à faire de la recherche parce que le temps qu’ils devraient y consacrer n’est pas compensé,
- d’autre part parce que les universitaires qui en sont chargés de préfèrent se tourner vers des recherches soit fondamentales relevant des neuro-sciences, soit pharmacologiques fortement influencées par les laboratoires pharmaceutiques.
Cela pousse les institutions qui représentent la recherche à être de plus en plus coupées de la pratique de soin et àcontribuer peu, en dehors des médicaments, aux progrès de la discipline .
Par ailleurs, l’organisation sectorisée favorise peu la constitution de cohortes homogènes de malades. Le développement intéressant des PHRC (programmes hospitaliers de recherche clinique) favorise trop les laboratoires déjà existant et les jeunes chercheurs des équipes déjà reconnues.
Ils favorisent moins l’émergence de nouveaux chercheurs
Conclusion
Dans le rapport, les propositions des auteurs ne font que peu de place aux moyens financiers indispensables à la mise en oeuvre de ce qui constituerait un plan pour un dispositif efficace de santé mentale. La question des ressources est ainsi renvoyée à une étape ultérieure.
Si nous partageons leur avis quand ils affirment que le niveau de ressources consacré à la prise en charge de la santé mentale doit être suffisant, il nous semble que cela ne peut se faire sans examiner si les moyens dédiés aux nécessaires évolutions du dispositif ne doivent pas, tout d’abord, être dégagés par une restructuration plus affirmée des unités d’hospitalisation éloignées de leur zone de desserte, au fonctionnement coûteux, qui concentrent encore environ 70 à 80% des moyens.
A défaut d’un tel examen, on peut craindre que ce segment de l’activité sanitaire qui ne s’est pas encore, pleinement, engagé dans une logique tarifaire comme le MCO, ne serve de variable d’ajustement et ne dégage pas les moyens de son développement, dans un contexte budgétaire très contraint.
Il est donc urgent, comme le réclament les auteurs du rapport, qu’un système d’information médico-économique adapté soit mis en oeuvre et que les propositions relatives au co-financement pour le secteur médico-social soient approfondies avec les collectivités territoriales concernées.
La conduite concomitante de ces actions est probablement la seule manière de garantir le financement des évolutions souhaitées.
En s’inscrivant toujours mieux dans le dispositif général de soins existant, la psychiatrie doit aussi trouver sa part dans les enveloppes dédiées aux priorités nationales : urgences, personnes âgées, handicap etc. À défaut, la crise que connaît l’hôpital, aujourd’hui, encouragera le repli sur soi pour protéger les ressources, plutôt qu’un travail ambulatoire en réseau, seul garant, à nos yeux, d’une prise en charge globale du patient.
Source: revue Pluriels n° 41 Janvier 2004
Pluriels
La Lettre de la Mission Nationale d’Appui à la Santé Mentale
• Directeur de la publication : G. MASSÉ
• Comité de rédaction : Christian BONAL, MNASM ; Martine MANDOPOULOS-CLEMENTE, Directeur adjoint EPS Ville Evrard ; Mme ERMATINGER BODEN-HAUSEN, UNAFAM ; Carole FESTA (MNASM) ; Mme FINKELSTEIN, FNAPSY ; Jean FURTOS, Praticien Hospitalier ; Marcel JAEGER, Directeur de l’IRTF ; Alain JOURDAIN, Enseignant chercheur à l’ENSP ; Serge KANNAS, MNASM ; Raymond LEPOUTRE, MNASM ; Jean-Claude MIE, directeur honoraire ; François MOUSSON, Infirmier général ASM 13 ; Eric PIEL, Praticien Hospitalier ; Sarah SARAGOUSSI, Chargée de mission, Maison Blanche.
“Pluriels”, 5 avenue d’Italie, 75013 Paris -
N° de téléphone : 01.53.94.56.90 -
N° de télécopie : 01.53.94.56.99.
Vous pouvez trouver tous les numéros parus de “Pluriels” sur le site :
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr
Accueil : Revues psychiatriques-Pluriels
Pour lire sur la Mission nationale d'appui en santé mentale, rendez-vous à la rubrique "Mailings", "Diverses structures"
Si nous partageons leur avis quand ils affirment que le niveau de ressources consacré à la prise en charge de la santé mentale doit être suffisant, il nous semble que cela ne peut se faire sans examiner si les moyens dédiés aux nécessaires évolutions du dispositif ne doivent pas, tout d’abord, être dégagés par une restructuration plus affirmée des unités d’hospitalisation éloignées de leur zone de desserte, au fonctionnement coûteux, qui concentrent encore environ 70 à 80% des moyens.
A défaut d’un tel examen, on peut craindre que ce segment de l’activité sanitaire qui ne s’est pas encore, pleinement, engagé dans une logique tarifaire comme le MCO, ne serve de variable d’ajustement et ne dégage pas les moyens de son développement, dans un contexte budgétaire très contraint.
Il est donc urgent, comme le réclament les auteurs du rapport, qu’un système d’information médico-économique adapté soit mis en oeuvre et que les propositions relatives au co-financement pour le secteur médico-social soient approfondies avec les collectivités territoriales concernées.
La conduite concomitante de ces actions est probablement la seule manière de garantir le financement des évolutions souhaitées.
En s’inscrivant toujours mieux dans le dispositif général de soins existant, la psychiatrie doit aussi trouver sa part dans les enveloppes dédiées aux priorités nationales : urgences, personnes âgées, handicap etc. À défaut, la crise que connaît l’hôpital, aujourd’hui, encouragera le repli sur soi pour protéger les ressources, plutôt qu’un travail ambulatoire en réseau, seul garant, à nos yeux, d’une prise en charge globale du patient.
Source: revue Pluriels n° 41 Janvier 2004
Pluriels
La Lettre de la Mission Nationale d’Appui à la Santé Mentale
• Directeur de la publication : G. MASSÉ
• Comité de rédaction : Christian BONAL, MNASM ; Martine MANDOPOULOS-CLEMENTE, Directeur adjoint EPS Ville Evrard ; Mme ERMATINGER BODEN-HAUSEN, UNAFAM ; Carole FESTA (MNASM) ; Mme FINKELSTEIN, FNAPSY ; Jean FURTOS, Praticien Hospitalier ; Marcel JAEGER, Directeur de l’IRTF ; Alain JOURDAIN, Enseignant chercheur à l’ENSP ; Serge KANNAS, MNASM ; Raymond LEPOUTRE, MNASM ; Jean-Claude MIE, directeur honoraire ; François MOUSSON, Infirmier général ASM 13 ; Eric PIEL, Praticien Hospitalier ; Sarah SARAGOUSSI, Chargée de mission, Maison Blanche.
“Pluriels”, 5 avenue d’Italie, 75013 Paris -
N° de téléphone : 01.53.94.56.90 -
N° de télécopie : 01.53.94.56.99.
Vous pouvez trouver tous les numéros parus de “Pluriels” sur le site :
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr
Accueil : Revues psychiatriques-Pluriels
Pour lire sur la Mission nationale d'appui en santé mentale, rendez-vous à la rubrique "Mailings", "Diverses structures"